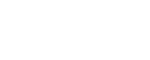Critiques

Né en 1953, Mike Bidlo est un artiste américain qui a fait ses classes à Columbia et à l’université de l’Illinois de Chicago. Il pratique la peinture, la sculpture et la performance. Mike Bidlo, considéré comme un artiste post moderne, a bâti sa carrière sur la « re » création et l’appropriation des œuvres d’autres artistes, reproduisant le travail de chacun. La particularité des reproductions de Bidlo c’est qu’elles cherchent à imiter précisément, exactement, l’image, l’échelle et les matériaux de leur source. D’autre part, Bidlo ne travaille pas à partir de l’original de l’œuvre, mais à partir de reproductions de l’original, ce qui rend ses pièces deux fois retirées de leur source.
Mike Bidlo est un artiste qui appartient au courant que l’on nomme Appropriationniste (artistes apparus au début des années 80 qui misent sur la prise de possession par la copie des œuvres d’autrui.) (1) C’est un mouvement qui reste informel (on n’a pas de manifeste) mais qui a tout de même un objectif : la remise en cause des notions d’ « auteur », d’ « originalité », de « nouveauté », si chères à l’Art depuis la Renaissance.(2) ![]() Si Bidlo considère sa démarche artistique comme politique, nous allons voir qu’elle est aussi ontologique.
Si Bidlo considère sa démarche artistique comme politique, nous allons voir qu’elle est aussi ontologique.
(1) La citation, l’emprunt, existe dans l’Histoire de l’Art depuis ces commencements. Les romains ont bien imités les copies grecques des oeuvres, Manet s’est inspiré de Titien pour peindre l’Olympia, Braque comme Picasso s’inspirent largement des Arts premiers au cours de la période cubiste, Marcel Duchamp empreinte au réel et ne fait que déplacer des objets de contexte puis les signe dans ses ready-mades. Les appropriationnistes se situent dans une ligne logique d’interrogations sur toutes ces notions d’auteur, plagiat, copie, inspiration, emprunt, mention, etc. Mais dans un sens bien plus radical.
(2) Avant la Renaissance, au Moyen-Age donc, on considère que le seul auteur est Dieu. Et les écrivains penseurs poètes etc. retranscrivent par écrit la pensée divine mais en aucun cas peut-on considérer qu’il existe un tiers auteur que le Créateur. Pour aller plus loin : Paul Vignaux. Philosophie au Moyen-Age. Vrin, 2004.
![]() Born in 1953, Mike Bidlo is an American artist who studied at Columbia and at the Illinois university of Chicago. He practices painting, sculpture and performance. Mike Bidlo, considered a post-modern artist, has built his career on the « re » creation and appropriation of the works of other artists, reproducing the work of each. The peculiarity of Bidlo’s reproductions is that they seek to imitate precisely, exactly, the image, the scale and the materials of their source. On the other hand, Bidlo does not work from the original of the work, but from reproductions of the original, which makes his pieces twice removed from their origin.
Born in 1953, Mike Bidlo is an American artist who studied at Columbia and at the Illinois university of Chicago. He practices painting, sculpture and performance. Mike Bidlo, considered a post-modern artist, has built his career on the « re » creation and appropriation of the works of other artists, reproducing the work of each. The peculiarity of Bidlo’s reproductions is that they seek to imitate precisely, exactly, the image, the scale and the materials of their source. On the other hand, Bidlo does not work from the original of the work, but from reproductions of the original, which makes his pieces twice removed from their origin.
Mike Bidlo is an artist who belongs to what we call Appropriationism (artists appeared in the early 80s who bet on taking possession by copying the works of others.) (1) It’s a movement that remains informal (we does not have a manifesto) but which nevertheless has an objective: questioning notions of « author », « originality », « novelty », so dear to Art since Renaissance. (2) ![]() If Bidlo considers his artistic approach as political, we will see that it’s also ontological.
If Bidlo considers his artistic approach as political, we will see that it’s also ontological.
(2) Before the Renaissance, in the Middle Ages, it was considered that the only author was God. And writers thinkers poets etc. transcribed divine thought in writing but in no case can we consider that it exists an author other than the Creator. To go further: Paul Vignaux. Philosophy in the Middle Ages. Vrin, 2004.



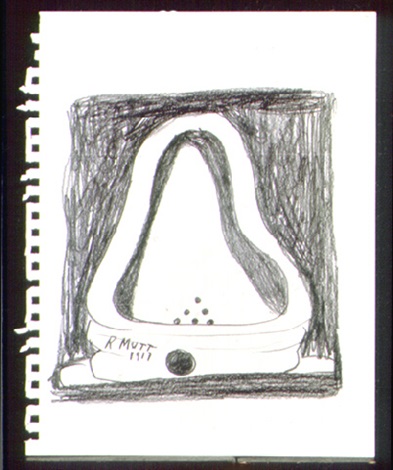
Bidlo est sans doute l’artiste le plus dénué d’identité visuelle. Lorsqu’on l’interroge sur les raisons qui l’ont poussé à adopter l’appropriation comme méthode, il met en avant des motivations politiques. L’appropriation, selon lui, doit permettre de diffuser la culture à travers toutes les classes de la société, y compris les classes les plus défavorisées. L’artiste indique en effet que les chefs-d’œuvre de l’art moderne, victimes de leur sacralisation, restent trop souvent cachés chez leur propriétaire, ou dans des musées souvent hors de portée, voire dans des pays étrangers.(3)
Les faire voyager dans des expositions reste une solution peu utilisée, dans la mesure où leur déplacement implique des frais importants, et le risque de vol ou dégradation se voit multiplié. Bidlo entend bien faire changer cette situation. L’une des œuvres de Bidlo est intitulée Un poulet dans chaque marmite et un Pollock dans chaque salon. (4) Ce titre pourrait, de toute évidence, servir de formule à son action. L’ambition de Bidlo est donc simple : il s’agit avant tout de (re-)produire les chefs-d’œuvre pour les diffuser largement, et les vendre à moindre frais. Ses copies sont généralement vendues au prix de 10 000 euros.
Bidlo met parfois en scène le partage égalitaire de l’art dans des performances en distribuant littéralement des parts de ses œuvres. Notamment avec Painting Blue Poles (5), une performance qui a eu lieu sur les marches du Metropolitan Museum de New York en 1982 où une fois l’œuvre réalisée, le plasticien a divisé la peinture en petits morceaux qu’il a ensuite distribué au public. (6) Quelque peu utopiste, on ne peut que rétorquer que la copie existait avant le mouvement Appropriationniste et que l’interroger relance les débats en Histoire de l’Art de multiples manières.
Comme il le confiait en 2010 au New-York Times à Nadine Rubin Nathan : « Si vous voulez devenir aussi grand que Warhol l’a été dans le domaine de l’art, alors vous devez avoir des générations plus jeunes qui explorent votre travail et essaient de le comprendre comme un langage. » (7) En cela le projet semble assez réussi puisque ses oeuvres ne cessent de questionner jeunes plasticiens et théoriciens.
(3) Selon le philosophie italien marxiste Gramsci, lutte culturelle et lutte sociale vont de pair. L’accès à l’art cristallise les injustices sociales d’une époque. Voir Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcere. Einaudi, 2014.
(4) Cette performance est une citation directe à un slogan de 1928 du président américain en devenir Herbert Hoover (en poste de 1929 à 1933 pendant la Grande Dépression) : « Un poulet dans chaque marmite et deux voitures dans chaque garage ». Ce slogan a d’autant plus marqué l’imaginaire américain qu’Hoover était d’origine très modeste et très vite orphelin. Faisant fortune dans l’industrie minière, il incarne à merveille le rêve américain. Voir « A Chicken for Every Pot, » The New York Times, 30 October 1928
(5) de Blue Poles, 1952 oeuvre de Jackson Pollock. Huile, émail, peinture aluminium, verre sur toile, National Gallery of Australia, Canberra © Pollock-Krasner Foundation. Sous licence ARS/Copyright Agency.
(6) L’Appropriationnisme tâche de court-circuiter cela en reproduisant au strict identique des chefs-d’oeuvres de l’Histoire de l’Art et ainsi mettre à mal le monde de l’art, rendant caduque le marché des oeuvres uniques, tout en faisant vaciller la signification de l’Oeuvre.
(7) https://archive.nytimes.com/tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/07/02/asked-answered-mike-bidlo/?_r=0
![]() Bidlo is arguably the artist most devoid of visual identity. When asked about the reasons that led him to adopt appropriation as a method, he puts forward political motivations. Appropriation, according to him, must allow culture to be spread across all classes of society, including the most disadvantaged classes. The artist indicates in fact that masterpieces of modern art, victims of their sacralization, too often remain hidden with their owner, or in museums often out of reach, or even in foreign countries.
Bidlo is arguably the artist most devoid of visual identity. When asked about the reasons that led him to adopt appropriation as a method, he puts forward political motivations. Appropriation, according to him, must allow culture to be spread across all classes of society, including the most disadvantaged classes. The artist indicates in fact that masterpieces of modern art, victims of their sacralization, too often remain hidden with their owner, or in museums often out of reach, or even in foreign countries.
Having them travelling in exhibitions remains a solution that is little used, since their displacement involves significant costs, and the risk of theft or degradation is multiplied. Bidlo intends to change this situation. One of Bidlo’s works is titled A Chicken in Each Pot and a Pollock in Each Living Room (4). This title could obviously serve as a formula for his action. Bidlo’s ambition is therefore simple: above all, it is a question of (re) producing masterpieces in order to distribute them widely, and sell them at low cost. Its copies are generally sold at a price of 10,000 euros.
Bidlo sometimes stages the egalitarian sharing of art in performances by literally distributing shares of his works. Notably with Painting Blue Poles (5), a performance which took place on the steps of the Metropolitan Museum in New York in 1982 where once the work was completed, the visual artist divided the painting into small pieces which he then distributed to the audience. (6) Somewhat utopian, we can only retort that the copy existed before the Appropriationist movement and that questioning it revives debates in Art History in multiple ways.
As he told the New York Times in 2010 to Nadine Rubin Nathan: « If you want to become as big as Warhol became in the field of art, then you have to have younger generations exploring your work and try to understand it as a language. » (7) The project seems quite successful since its works continue to question young visual artists and theorists.
(3) According to the Italian Marxist philosopher Gramsci, cultural struggle and social struggle go hand in hand. Access to art crystallizes the social injustices of an era. See Antonio Gramsci, Quaderni dal Carcere. Einaudi, 2014.
(4) This performance is a direct quote from a 1928 slogan of future US President Herbert Hoover (in office from 1929 to 1933 during the Great Depression): « A chicken in every pot and two cars in every garage ». This slogan had all the more impact on the American imagination because Hoover was of very modest origin and very quickly became an orphan. Making his fortune in the mining industry, he perfectly embodies the American dream. See “A Chicken for Every Pot,” The New York Times, October 30, 1928
(5) From Blue Poles, 1952 work by Jackson Pollock. Oil, enamel, aluminum paint, glass on canvas, National Gallery of Australia, Canberra © Pollock-Krasner Foundation. Licensed by ARS/Copyright Agency.
(6) Appropriationism attempts to short-circuit this by reproducing masterpieces of Art History exactly identically and thus undermine the world of art, making the market for unique works obsolete, while making the meaning of the Work waver.
(7) https://archive.nytimes.com/tmagazine.blogs.nytimes.com/2010/07/02/asked-answered-mike-bidlo/?_r=0
- © Not de Chirico (Metaphysical Interior with Workshop, 1948), 1989 – 1990
- © Not Picasso (Self-Portrait: Yo Picasso, 1901), 1986
- © Not Warhol (Marilyn), 1984
- © The Fountain Drawings (#1886 from the , 1993 – 1997
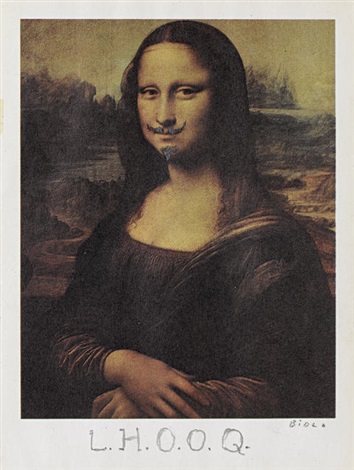
© (Not) Duchamp’s, 1987
Bidlo est de tous les appropriationnistes celui qui s’apparente le plus à un faussaire. Ses œuvres sont des copies conformes des originaux. Dans son travail, on se retrouve face à un degré zéro d’invention. Pour autant, ses œuvres peuvent être interprétées comme une célébration de la disparition de la notion d’auteur. Après la course effrénée à la nouveauté, à la rupture, constatée notamment au début du XXe siècle dans les Avant-gardes (8), avec Bidlo, le temps semble être suspendu. C’est un peu comme si la recherche du nouveau, qui avait été un des éléments moteurs de la Modernité, venaient soudainement buter sur l’évidence de l’épuisement des possibles en matière d’invention artistique.
Bidlo, lors de ses reproductions, titre ses œuvres en plaçant un « not » devant le nom de l’artiste qu’il copie. Le titre fait figure ici d’acte de destitution signifiant que les formes appartiennent à tout le monde et pas seulement aux artistes qui les ont signées. Le « not » suivi d’un nom d’auteur induit l’idée que le premier auteur de l’œuvre ne saurait revendiquer la pleine et entière paternité des images et des styles que Bidlo, ou un autre, redonne à voir.
On peut aussi comprendre ce que « not » remet en question dans le statut de l’artiste. Picasso, par exemple, n’a pas inventé Les Demoiselles d’Avignon ex nihilo comme on l’a vu plus haut. Il a mis à profit sa connaissance conjointe de la statuaire ibérique primitive et des masques congolais de façon à les intégrer dans une composition relativement unifiée. Jusqu’à une date récente, peu d’artistes, néanmoins, ont accepté de reconnaître leur dû. Pourtant, une toile c’est avant tout le résultat de tout ce qui a été créé précédemment, et à partir de quoi l’artiste va créer à son tour.
En intitulant « Not Picasso » une œuvre qui ressemble très précisément à un Picasso, Mike Bidlo ouvre en quelque sorte l’œuvre à l’altérité qui l’habite ; il invite le spectateur à dresser l’inventaire des emprunts à travers lesquels l’œuvre s’est constituée. On est ici dans un questionnement ontologique. Peut-on considérer une œuvre indépendamment de l’artiste qui l’a créé ? Est-ce que l’œuvre a une vie indépendamment de son créateur ? Quels artefacts précèdent le surgissement, la création d’un autre et quelle valeur leur apporter ? Le titre que leur confère Bidlo vient en tout cas lever le doute sur l’attribution et la valeur de reconnaissance de dette, ainsi que sur la vie d’une œuvre qui ne saurait se limiter à une simple exécution première.
(8) Le changement en art est condition créative, l’Art ne saurait se satisfaire du retour du même. C’est ainsi que l’on rompt avec la tradition et épouse la Modernité. Ajoutons d’Arthur Rimbaud (« poète d’une civilisation non encore apparue » d’après René Char : « Il faut être absolument moderne. » Une Saison en Enfer, Rimbaud, Oeuvres, Paris, Classiques Garnier, 1960. p. 241. René Char, Recherche de la Base et du Sommet, Paris, Gallimard, 1965, p. 102.
![]() Bidlo is of all the appropriationists the one who most closely looks like a forger. His works are exact copies of the originals. In his work, we find ourselves facing a zero degree of invention. However, his works can be interpreted as a celebration of the disappearance of the notion of author. After the frantic race for novelty, for rupture, noted notably at the beginning of the 20th century in the Avant-gardes (8), with Bidlo, time seems to stand still. It’s a bit as if the search for the new, which had been one of the driving forces of Modernity, suddenly came up against the evidence of the exhaustion of possibilities in terms of artistic invention.
Bidlo is of all the appropriationists the one who most closely looks like a forger. His works are exact copies of the originals. In his work, we find ourselves facing a zero degree of invention. However, his works can be interpreted as a celebration of the disappearance of the notion of author. After the frantic race for novelty, for rupture, noted notably at the beginning of the 20th century in the Avant-gardes (8), with Bidlo, time seems to stand still. It’s a bit as if the search for the new, which had been one of the driving forces of Modernity, suddenly came up against the evidence of the exhaustion of possibilities in terms of artistic invention.
Bidlo, during reproductions, titles his works by placing a « not » in front of the artist’s name which it copies. The title appears here as an act of dismissal meaning that the forms belong to everyone and not only to the artists who signed them. The « not » followed by an author’s name induces the idea that the first author of the work cannot claim the full and entire authorship of the images and styles that Bidlo, or anyone else, put back in sight.
We can also understand what « not » questions regarding the status of the artist. Picasso, for example, did not invented Les Demoiselles d’Avignon ex nihilo as we understood in the introduction. He made use of his joint knowledge of primitive Iberian statuary and Congolese masks so as to integrate them into a relatively unified composition. Until recently, few artists, however, have agreed to acknowledge their due. However, a canvas is above all the result of everything that has been created previously, and from which the artist will create in turn.
By titling « Not Picasso » a work that very precisely looks exactly like a Picasso, Mike Bidlo in a way opens the work of art to the otherness that inhabits it; he invites the viewer to draw up an inventory of the loans through which the work was built up. We are here in an ontological questioning. Can we consider a work independently of the artist who created it? Does the work have a life independently from its creator? What artifacts precede the emergence, the creation of another and what value can be brought to them? The title that Bidlo gives them comes in any case to remove the doubt about the attribution and has value of acknowledgment of debt, as well as on the life of a work which cannot be limited to a simple first execution.
(8) Change in art is a creative condition, Art cannot be satisfied with the return of the same. This is how we break with tradition and embrace Modernity. Let us add from Arthur Rimbaud (« poet of a civilization that has not yet appeared » according to René Char: « One must be absolutely modern. » Une Saison en Enfer, Rimbaud, Oeuvres, Paris, Classiques Garnier, 1960. p. 241. René Char, Research of the Base and the Summit, Paris, Gallimard, 1965, p. 102.

© Not Pollock, 1980 – 1989
Arrêt sur une œuvre (DRIPPINGS de Pollocks) : Contrairement aux autres œuvres de Bidlo, les « Not Pollock » ne sont pas des copies traits pour traits. Il s’agit plutôt d’une sorte de remake improvisé. L’artiste a travaillé une année entière pour arriver à saisir le geste de Pollock, s’aidant des vidéos d’Hans Namuth. (9)
« Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. J’ai beaucoup pratiqué. J’ai traqué autant de Pollock réels qu’il était possible de trouver de façon à examiner de près comment ils avaient été réalisés. En essayant de reproduire la gestuelle de Pollock, j’ai découvert que sa ligne était une sorte de calligraphie cursive qui pouvait être apprise comme la méthode Palmer. Après un an d’essais et d’erreurs, j’ai appris à contrôler la viscosité, la disposition en couches successives et les différentes façons selon lesquelles la peinture frappe et est absorbée par la surface de la toile ». (10)
Il faut noter que Bidlo a dû négocier avec les réalités du XXème finissant. Les couleurs utilisées par Pollock ne sont plus commercialisées. Et il faut donc les imiter par d’autres moyens : « Etant donné que le Duco n’est plus commercialisé, j’ai dû avoir recours à une peinture à l’émail achetée à la quincaillerie et j’ai dû reconstituer de façon approximative la palette de chaque peinture de Pollock ». (11)
L’intérêt d’une réactivation des drippings (12) de Pollock se trame dans une relecture : au moment où Pollock a présenté ses premiers drippings, le style dominant en Amérique était une sorte de Cubisme Synthétique, (13) ou de surréalisme finissant. Ceux-ci formaient donc la toile de fond du champ énonciatif dans lequel devait intervenir Pollock. En marge des « énoncés » de Pollock, il y avait aussi l’expressionnisme abstrait naissant (Mark Rothko, Willem de Kooning, etc.) Lorsque Bidlo réactive les œuvres de Pollock, le champ énonciatif a totalement changé.
C’est cette fois le néo-expressionnisme de Schnabel (14) qui est dominant. Dans l’intervalle de temps séparant Pollock de Bidlo, il y a eu le Pop Art, le Minimalisme, l’Art Conceptuel et ceux-ci viennent interférer avec la lecture que l’on peut faire du dripping. Force est donc de faire de « Not Pollock » une lecture contextuelle : on peut voir en lui une critique du Néo-Expressionnisme de Schnabel qui resservait à cette époque les poncifs de l’expressionnisme.
Alors que le Pollock original était une apologie de la créativité libéré de toutes entraves formelles européennes, l’œuvre de Bidlo semble tourner en dérision la spontanéité expressionniste en la répétant. Une même forme peut donc véhiculer des sens totalement opposées dès lors qu’elle est remise en scène à des moments différents de l’histoire. La difficulté avec ce type de travail et, partant, ce qui fait son intérêt et ses limites, tient au contraste théorique entre ce que le discours appropriationniste définit comme critique en pratique des notions d’auteur et d’originalité (comme garanties traditionnelles de la valeur marchande et symbolique des œuvres).
Et l’évidence du statut allégorique de leurs œuvres, comme l’a démontré en 1980 Craig Owens: « Les manipulations auxquelles ces artistes soumettent ces images visent à les vider de leur résonance, de leur signification, du sens qu’elles revendiquent de façon autoritaire (…) Si sa pratique résulte d’un vide dans le champ des possibles de la création, d’une certaine manière elle les vide aussi de leur aura, et de leur signification première. (15) Voir peut être de leur intérêt même ?
Alors, crise de l’aura? Oui, si cette notion définit et est définie par le caractère unique, authentique et original, reconnu dans la matérialité et le mode d’exposition spécifiques à une œuvre d’art, ce qui n’est plus le cas dans sa reproduction dégradée et/ou redimensionnée et ré-encadrée. Non, car dans le même temps l’œuvre originale existe toujours matériellement quelque part et n’est pas en soi dégradée, à moins qu’on ne réduise son existence et son éventuelle portée à toutes ses reproductions- dégradations et à tous ses usages. Ce serait donc uniquement sur le plan de l’image que l’affaire se jouerait ?
(9) https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo
(10) « Mike Bidlo talks to Robert Rosenblum », Artforum International, vol.XLI, n°8, avril 2003.
(11) Ibid.
(12) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dripping/26815
(13) Le cubisme synthétique se caractérise par une plus grande utilisation de la couleur mais aussi l’ajout de divers collages, papiers, objets, dépassant le stricte cadre du bidimensionnel.
(14) Peu connu en France, pour aller plus loin : https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cj6eLg
(15) Craig Owens, « The Allegorical Impulse : Towards a Theory of Postmodernism », October, n°12, printemps 1980.
![]() Stop on a work (DRIPPINGS by Pollocks): Unlike the other works by Bidlo, « Not Pollock » are not line copies for lines. It’s more like an improvised remake. The artist worked an entire year to capture Pollock’s gesture with Hans Namuth videos. (9)
Stop on a work (DRIPPINGS by Pollocks): Unlike the other works by Bidlo, « Not Pollock » are not line copies for lines. It’s more like an improvised remake. The artist worked an entire year to capture Pollock’s gesture with Hans Namuth videos. (9)
« It is not as simple as it seems. I have practiced a lot. I have tracked down as many real Pollocks as I could find so as to take a close look at how they were made. Trying to reproduce Pollock’s gestures, I discovered that his line was a kind of cursive calligraphy that could be learned like the Palmer method. After a year of trial and error, I learned to control the viscosity, the arrangement in successive layers and the different ways in which the paint strikes and is absorbed by the surface of the canvas. » (10)
It should be noted that the artist had to negotiate with the realities of the late twentieth century. The colors used by Pollock are no longer sold. And so you have to imitate them in other ways: « Since the Duco is no longer sold, I had to use an enamel paint purchased from the hardware store and I had to roughly reconstruct the palette of each Pollock paint. » (11)
The interest of a reactivation of Pollock drippings (12) is woven into a re-reading: at the time when Pollock presented his first drippings, the dominant style in America was a kind of Synthetic Cubism, (13) or ending surrealism. These therefore formed the backdrop for the enunciative field in which Pollock was to intervene. In addition to Pollock’s statements, there was also emerging abstract expressionism (Mark Rothko, Willem de Kooning, etc.) When Bidlo reactivates Pollock’s works, the enunciative field has completely changed.
In this time it was Schnabel’s neo-expressionism (14) that was dominant. In the time between Pollock and Bidlo, there has been Pop Art, Minimalism, Conceptual Art and these interfere with the reading that can be done with dripping. It’s therefore necessary to make « Not Pollock » a contextual reading: we can see in it a critique of Schnabel’s Neo-Expressionism which at that time remade clichés of expressionism.
While the original Pollock was an apology for creativity freed from all formal European shackles, Bidlo’s work seems to mock expressionist spontaneity by repeating it. The same form can therefore convey completely opposite meanings as soon as it is re-staged at different times in history. The difficulty with this type of work and, therefore, what makes it interesting and its limits, is due to the theoretical contrast between what, for example, the appropriationist discourse defines as critical in practice of the notions of author and originality (as traditional guarantees of the market and symbolic value of the works).
And the evidence of the allegorical status of their works, as demonstrated in 1980 by Craig Owens: « Manipulations to which these artists submit these images aim to empty them of their resonance, of their meaning, the meaning they claim in an authoritarian way (…) If its practice results from a void in the field of creation possibilities, in a certain way it also empties them of their aura, and of their primary meaning. » (15) Maybe from their own interest too ?
So, is it an aura crisis? Yes, if this notion defines and is defined by the unique, authentic and original character, recognized in the materiality and the mode of exposure specific to a work of art, which is no longer the case in its degraded reproduction and / or resized and re-framed. No, because at the same time the original work still exists materially somewhere and is not in itself degraded, unless we reduce its existence and its possible scope to all its reproductions-degradations and to all its uses. It would therefore be only in terms of image that the case would play out ?
(9) https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo
(10) « Mike Bidlo talks to Robert Rosenblum », Artforum International, vol.XLI, n°8, avril 2003.
(11) Ibid.
(12) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dripping/26815
- © Untitled (not Pollock),1983

Galerie





© Alessandro Lucioni/Gorunway.com /AP /SIPA /Ines Manaï /AsiaTypek /Morgan O’Donovan /WWDImaxtree /Dior
Pour le printemps/ été 2020, Maria Grazia Chiuri a choisi d’honorer la soeur de Christian Dior, très peu connue du grand public, Catherine, à qui il avait d’ailleurs dédié la création de son parfum iconique « Miss Dior ». Le tout accompagné en musique par la bande originale The Tree of Life d’Alexandre Desplat et Across the Universe des Beatles.
Féministe et engagée dans la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale (Catherine Dior est arrêtée par la Gestapo et torturée en 1944 ; refusant de parler, elle est déportée au camp de Drancy puis à Ravensbrück. Elle est finalement libérée à Dresde, en 1945 (1)), elle n’en demeure pas moins attachée à sa féminité et à des occupations typiquement genrée. Sa passion ? Le jardinage. Un hobbie que l’on retrouve dans une des pièces majeures du vestiaire de la Maison, la jupe tulipe. Et un goût pour les fleurs décliné en une collection entière aux embruns de cottage.
Cette atmosphère très jardinière on la retrouve dans chaque silhouette mais aussi dans le décor voulu par la designer.e soit : des feuillages, dans une pépinière botanique, de la toile de Jouy, du raphia, des fleurs séchées en broderies ou en teintures, du bois, des treillis de jardin, ect. De petits fanions de papiers ont été disposés sur les arbres plantant le décor où on peut lire « planting for future », planter pour le futur. Ou une aspiration à inscrire l’héritage de Maison dans les préoccupations plus contemporaines.
Le principal élément de cette collection c’est la toile de Jouy, matériau signifiant chez Christian Dior, qui semble trouver ici toute sa cohérence ; tantôt à rayures, tantôt à carreaux, elle est la matière principale des costumes présentés. La femme Dior est une femme-fleur habillée de robes en mousseline brodées de feuilles et de fleurs, agrémentées de minuscules perles et portées avec des colliers en bois. Le sac Dior a également été retravaillé avec des motifs de feuilles. Les chapeaux sont en paille, les perforations sur certains vêtements représentent des nids abeilles, espèces en voie de disparition.
Les cardigans de cachemire sont « tachés » de couleurs végétales – selon la technique d’une artisane italienne qui applique les pétales sur le tissu humide avant de les retirer et d’y contempler leur empreinte. Pour cette collection Maria Grazia Chuiri a collaboré avec les équipes du Grand Herbier du Musée d’Histoire Naturelle de Paris et y a puisé les motifs de sa collection.
« Seule la nature et la diversité peuvent nous libérer. Il me semblait indispensable d’inscrire notre héritage au cœur des enjeux actuels. Les fleurs et les plantes ne sont pas simplement des ornements décoratifs, ils sont l’essence de notre environnement. Nous avons le devoir d’en prendre soin, aujourd’hui plus que jamais » (2), explique-t-elle aux journalistes en coulisses.
Quid de ces motifs tye and dye ? La designer fait ici référence à Monte Verità (3), une communauté située en Suisse, composées d’artistes et de penseurs (surtout des utopistes) qui au début du XXème siècle souhaitait vivre en harmonie avec la Nature.
Dans cette mouvance, MGC (4) a choisi de réutiliser des vestes déjà vues dans des saisons précédentes, à l’instar de la veste bar, des robes patineuses en pied de coq, des jupons de tulle, ou encore du Saddle (5). Des silhouettes très féminines et bucoliques en somme revisitées : « Nous voulons proposer des créations qui ne se démodent pas au bout d’une saison et, à travers les défilés, nous montrons aux clientes comment les mixer pour les réactualiser. C’est aussi ça, la durabilité Dior. » (6)
Un défilé qui veut porter haut les valeurs de l’écologie avec la création d’un arboretum de 164 arbres de plusieurs espèces différentes sur la pelouse de l’hippodrome de Longchamp, où chaque arbre, choisi par le collectif Coloco (7) – composé d’urbanistes et de paysagistes – sera replanté en Ile-de-France. La Nature est bien au coeur de ce défilé et plus largement au coeur de la profession où chacun se targue de recycler ses matériaux, de créer des vêtements durables, d’avoir une empreinte carbone faible, ou encore d’avoir signé le Fashion Pact (8). Peut être l’aube d’une façon toute autre d’envisager l’industrie textile, une des industries les plus polluantes au monde. (9)
(1) https://www.liberation.fr/culture/livres/miss-dior-dame-soeur-de-christian-20211027_X4Q3WDP34VFQ7PP4E4O7GWBO5I/
(2) https://www.marieclaire.fr/defiles-printemps-ete-2020-dans-le-jardin-inclusif-de-dior,1324772.asp
(3) Pour aller plus loin : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/lsd-la-serie-documentaire/monte-verita-une-reforme-de-la-vie-sur-la-montagne-3295822
(4) Maria Grazia Chiuri
(5) Créé par John Galliano en 1999 pour sa collection Christian Dior prêt-à-porter printemps-été 2001, inspiré par l’univers équestre (on reconnait aisément la forme de selle de cheval que le sac adopte).
(6) https://madame.lefigaro.fr/style/fashion-week-paris-defile-dior-la-croisade-green-des-femmes-250919-167185
(7) Pour aller plus loin : https://www.coloco.org/
(8) https://www.thefashionpact.org/?lang=fr
(9) La mode est l’une des industries les plus polluantes au monde, derrière notamment l’industrie pétrolière et l’élevage intensif. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/09/01/co2-eau-microplastique-la-mode-est-l-une-des-industries-les-plus-polluantes-du-monde_5505091_4355770.html





![]() For spring/ summer 2020, Maria Grazia Chiuri chose to honor Christian Dior’s sister, little known to the general public, Catherine, to whom he dedicated the creation of her iconic perfume « Miss Dior ». All accompanied in music by the soundtrack The Tree of Life by Alexandre Desplat and Across the Universe by The Beatles.
For spring/ summer 2020, Maria Grazia Chiuri chose to honor Christian Dior’s sister, little known to the general public, Catherine, to whom he dedicated the creation of her iconic perfume « Miss Dior ». All accompanied in music by the soundtrack The Tree of Life by Alexandre Desplat and Across the Universe by The Beatles.
Feminist and engaged in the Resistance during the Second World War (Catherine Dior was arrested by the Gestapo and tortured in 1944; refusing to speak, she was deported to the Drancy camp then to Ravensbrück. She was finally released in Dresden, in 1945), she is nonetheless feminine. Her passion ? Gardening. A hobby that we find in one of the major pieces of the House’s wardrobe, the tulip skirt.
This very garden-like atmosphere is found in the collection but also in the decor desired by the designer.e too: foliage, in a botanical garden, Jouy canvas, raffia, dried flowers in embroidery or dyeing, some wood, garden trellis, ect. Small flags of paper were placed on the trees setting the scene where we can read « planting for future ».
The main element of this collection is the Jouy canvas, a material dear to the House of Dior, which seems to find its consistency here; sometimes striped, sometimes checkered, it is the main material of the costumes presented. The Dior woman is a flower woman dressed in chiffon dresses embroidered with leaves and flowers, embellished with tiny pearls and worn with wooden necklaces. The Dior bag has also been reworked with leaf patterns. The hats are made of straw, the perforations on certain garments represent honeycombs, an endangered species whose fate is crucial for the circle of life.
Cashmere cardigans are « stained » in plant colors – the technique of an Italian craftswoman who applies the petals to the damp fabric before removing them and gazing at their imprint. Maria Grazia Chiuiri collaborated with the teams of the Grand Herbier of the Museum of Natural History in Paris to draw patterns for her collection.
“Only nature and diversity can set us free. It seemed essential to put our heritage at the heart of today’s challenges. Flowers and plants are not just decorative ornaments, they are the essence of our environment. We have a duty to take care of it, today more than ever” says MGC.
What about these tie and dye patterns? The designer was referring to Monte Verità, a community located in Switzerland, composed of artists and thinkers (especially utopians) who at the beginning of the 20th century wanted to live in harmony with nature far away from cities.
In this movement, Maria has chosen to reuse jackets already seen in previous seasons, like the bar jacket, the skater dresses at the foot of the rooster, the petticoat in tulle, the Saddle very feminine and bucolic silhouettes revisited: “We want to offer creations that do not go out of fashion after a season and, through the fashion shows, we show customers how to mix them to update them. This is also Dior durability.”































































































Critiques

© Photo issue du défilé de Junkai Huang, étudiant au Fashion Institute Museum. Février 2020. Source: Bennett Raglin / Getty
Le Blackface aujourd’hui, c’est une pratique jugée raciste qui consiste à se grimer en Noir, notamment lors d’un Carnaval. À l’origine, soit dès le XVIIIème siècle, le blackface c’étaient des hommes Noirs qui caricaturaient habilement les hommes Blancs lors de comédies où les spectateurs étaient à la fois blancs et noirs, mais majoritairement blancs. Ces derniers d’ailleurs ne connaissaient pas exactement le sens caché de ces parodies, puisque ces hommes noirs divertissant leurs maitres a priori à leurs propres dépends, caricaturaient en fait le comportement de leurs oppresseurs. Plus tard, des hommes blancs se sont mis à caricaturer les hommes noirs ; un des plus connu d’entre eux se nommait Thomas D. Rice et performait dans ce qu’on appelait alors des minstrel show, soit des spectacles américains où jouaient des acteurs blancs se noircissant le visage (blackface).
![]() Blackface today is a deemed racist practice which consists of making up in black, especially during a Carnival. Originally, in the 18th century, the blackface were black men who skillfully caricatured white men in comedies where the spectators were both white and black, but mostly white. The latter, moreover, did not know exactly the hidden meaning of these parodies, since these black men entertaining their masters a priori at their own expense, in fact caricatured the behavior of their oppressors. Later, white men began to caricature black men; one of the best known of them was named Thomas D. Rice and performed in what was then called minstrel shows, American shows in which white actors blackened their faces played (blackface).
Blackface today is a deemed racist practice which consists of making up in black, especially during a Carnival. Originally, in the 18th century, the blackface were black men who skillfully caricatured white men in comedies where the spectators were both white and black, but mostly white. The latter, moreover, did not know exactly the hidden meaning of these parodies, since these black men entertaining their masters a priori at their own expense, in fact caricatured the behavior of their oppressors. Later, white men began to caricature black men; one of the best known of them was named Thomas D. Rice and performed in what was then called minstrel shows, American shows in which white actors blackened their faces played (blackface).

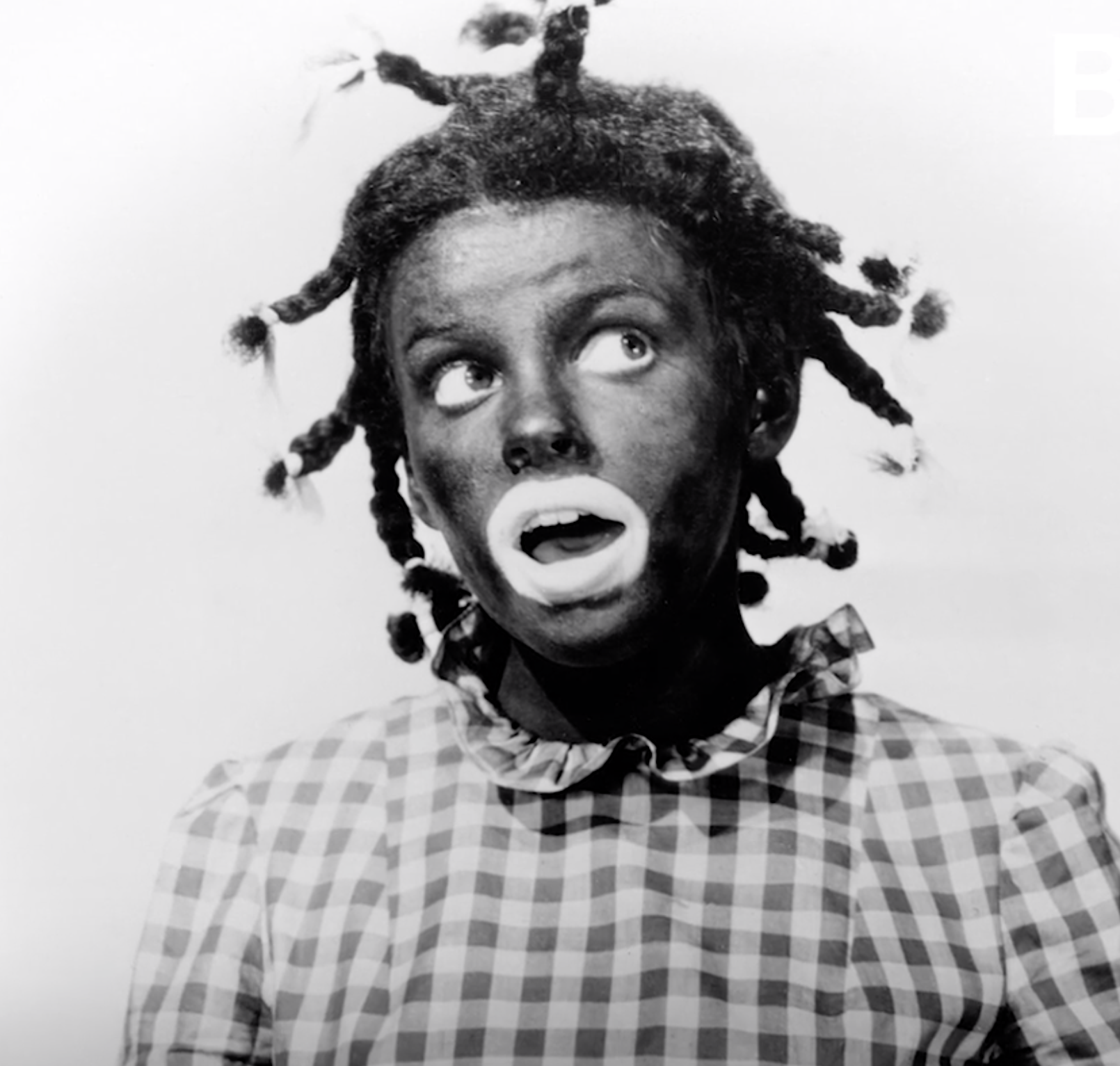


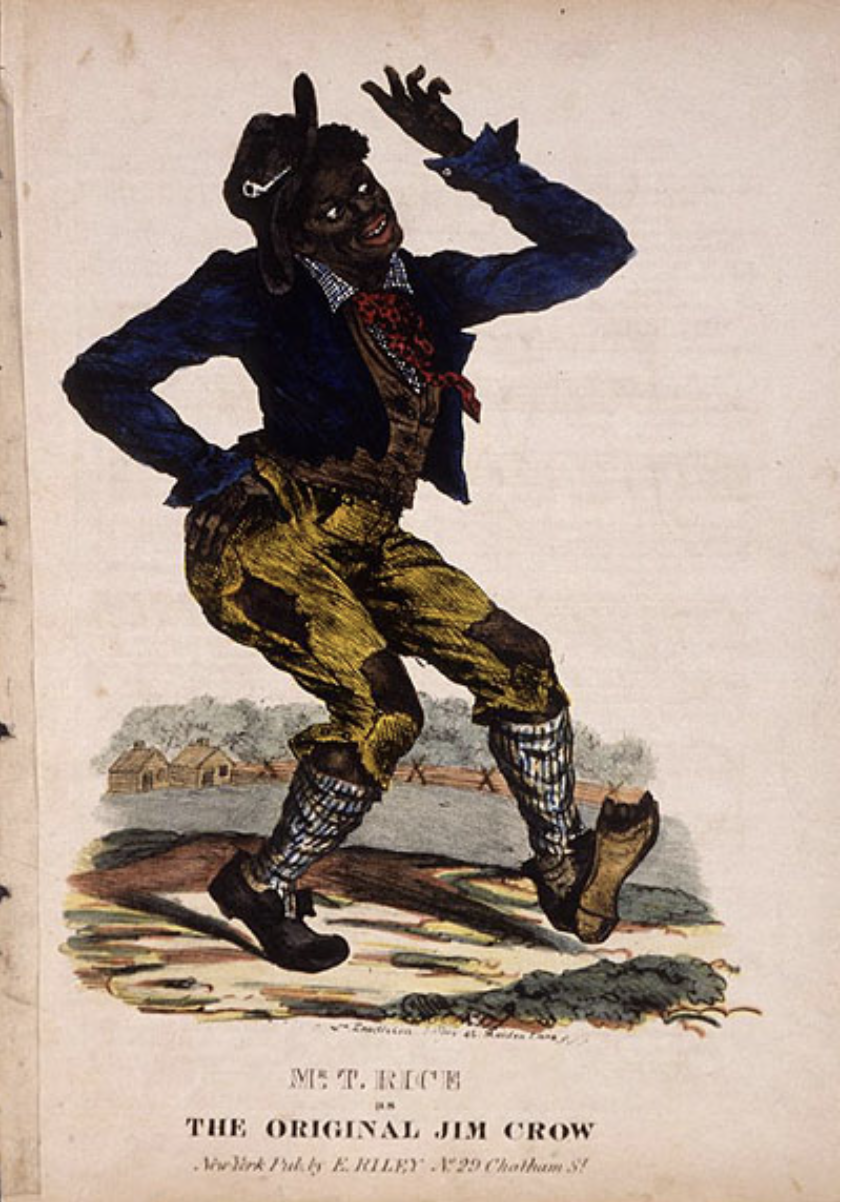
© Getty image
© Personnage Jim Crow de Thomas D. Rice.— Institute for Advanced Technology in the Humanities at the University of Virginia
Après la Guerre de Sécession, les Noirs eux-mêmes reprendront ce genre de la comédie. Les hommes Noirs de ces spectacles apparaissaient généralement comme comme des gens stupides, superstitieux, mais joyeux et doués pour la danse et la musique. Préconçus encore dans notre inconscient collectif jusqu’à il y a peu, dans cette idée que les Noirs avaient « le rythme dans la peau ». Un exemple parmi tant d’autres, Thomas D. Rice, lorsqu’il se grimait, empruntait le nom de Jim Crow, dès 1828. Il avait été inspiré par la musique et la danse d’un homme noir handicapé qu’il avait rencontré à Cincinnati, dans l’Ohio, qui s’appelait alors Jim Cuff ou Jim Crow. La chanson du spectacle intitulée Jump Jim Crow fut un très grand succès si bien que Thomas Rice en fit une tournée dans tous les Etats-Unis.
![]() After the Civil War, blacks themselves will resume this genre of comedy. Black men in these shows generally appeared to be stupid, superstitious, but cheerful people who were good at dancing and music. Pre-conceived in our collective unconscious until recently, with the idea that black people had « rhythm in their skin ». One example among many, Thomas D. Rice, when he made up, borrowed the name Jim Crow, in 1828. He had been inspired by the music and the dance of a handicapped black man whom he had met in Cincinnati, Ohio, which was then called Jim Cuff or Jim Crow. The song in the show called Jump Jim Crow was a huge success, so much so that Thomas Rice toured it throughout the United States.
After the Civil War, blacks themselves will resume this genre of comedy. Black men in these shows generally appeared to be stupid, superstitious, but cheerful people who were good at dancing and music. Pre-conceived in our collective unconscious until recently, with the idea that black people had « rhythm in their skin ». One example among many, Thomas D. Rice, when he made up, borrowed the name Jim Crow, in 1828. He had been inspired by the music and the dance of a handicapped black man whom he had met in Cincinnati, Ohio, which was then called Jim Cuff or Jim Crow. The song in the show called Jump Jim Crow was a huge success, so much so that Thomas Rice toured it throughout the United States.
Revenons-en à aujourd’hui : La semaine dernière, le 7 février, un étudiant du nom de Junkai Huang a présenté sa collection de fin d’année en vue de l’obtention de son diplôme, au Fashion Institute of Technology, ces pendant la fashion week de New-York. Sa collection était accessoirisée de très larges oreilles blanches ou noires de part et d’autre du visage des mannequins, de bouche exubérante à l’instar des caricatures des bouches d’hommes et / ou femmes noires, et des sourcils très touffus rappelant ceux des singes. Le point de départ de sa collection ? Une volonté de mettre en avant les traits parmi les plus laids du corps humain.
![]() Getting back to today: Last week, February 7, a student named Junkai Huang presented his graduation collection for graduation at the Fashion Institute of Technology during New York fashion week. His collection was accessorized with very large white or black ears on either side of the models’ faces, exuberant mouths like caricatures of the mouths of black men and / or women, and very bushy eyebrows reminiscent of those of monkeys. The starting point for his collection? A desire to highlight some of the ugliest features of the human body.
Getting back to today: Last week, February 7, a student named Junkai Huang presented his graduation collection for graduation at the Fashion Institute of Technology during New York fashion week. His collection was accessorized with very large white or black ears on either side of the models’ faces, exuberant mouths like caricatures of the mouths of black men and / or women, and very bushy eyebrows reminiscent of those of monkeys. The starting point for his collection? A desire to highlight some of the ugliest features of the human body.

« Les accessoires utilisés pendant le spectacle étaient destinés à refléter les caractéristiques de mon corps et à percevoir leurs proportions élargies, qui devraient être célébrées et embrassées », a déclaré Junkai Huang.
Sur la photo Junkai Huang © Junkai Huang
L’intention ne présentait pas de velléités racistes, selon Junkai Huang ; pourtant une mannequin, Amy Lefevre (portant ci-dessous une tenue orange et blanche) a refusé de porter ces oripeaux qu’elle a jugé, déjà, raciste. Il faut dire que le jeune designer en herbe les avait non pas fabriqué mais acheté sur Amazon en dernière minute, dans la catégorie « oreilles de singes » & autres. Après le tollé général, la Présidente du FIT, Joyce Brown, décrivait la situation ainsi : « Actuellement, il ne semble pas que l’intention originale de la conception, de l’utilisation d’accessoires ou de la direction créative du show était de faire une allusion raciale. Cependant, il est désormais évident que cela a été le résultat », a-t-elle poursuivi. « Pour cela, nous nous excusons auprès de ceux qui ont participé au show, aux étudiants et à quiconque qui aurait été offensé par ce qu’ils ont vu. »
![]() “The accessories used during the show were intended to be reflections of my own body features and perceptions of their enlarged proportions, which should be celebrated and embraced,” Junkai Huang said.
“The accessories used during the show were intended to be reflections of my own body features and perceptions of their enlarged proportions, which should be celebrated and embraced,” Junkai Huang said.
On the picture Junkai Huang © Junkai Huang
The intention was not racist, according to Junkai Huang; yet a model, Amy Lefevre (wearing an orange and white outfit below) refused to wear these clothes that she already considered racist. It must be said that the young aspiring designer had not manufactured them but bought them on Amazon at the last minute, in the category « monkey ears » & others. After the outcry, FIT President Joyce Brown described the situation as follows: « Currently, it does not seem that the original intention of the design, the use of accessories or the creative direction of the show was to make a racial allusion. However, it is now evident that this was the result, ”she continued. “For this, we apologize to those who participated in the show, to the students and to anyone who might have been offended by what they saw. »








Alors, que penser ? Etait-ce réellement raciste, considéré que le blackface est autant une moquerie de très mauvais goût sur les hommes noirs que sur les hommes blancs, bien que ces derniers l’aient ignorés ? La mode doit-elle accepter les injonctions de la doxa et les jugements moraux sur ses artefacts ? L’étudiant designer était-il sincère dans sa non intention de paraître raciste ?
Réponse : le scandale des blackfaces à travers le monde date d’il y a peu, cet étudiant n’a pu l’ignorer ou passer à côté. Et si tel a été le cas, travailler dans un domaine où la culture est en jeu n’autorise pas à l’ignorance de ce genre d’enjeux.
Ensuite, les blackfaces ayant pu viser hommes blancs ou noirs, il demeure que ceux qui ont eu à en souffrir ont été ces hommes noirs, ces esclaves afro-américains. Les artifices utilisés par l’étudiant sont bien ceux qui servent à comparer les populations noires à des singes (…)
Ce à quoi on peut ajouter que la mode répond aux injonctions sociétales, et si elle fait et a fait longtemps scandale dans l’histoire, ce genre de scandale raciste est encadré par la loi dans nombre de pays du monde – dont la France. Donc si ce n’est pas légal cela n’a pas lieu d’être.
Enfin et pour en revenir à Junkai Huang, son idée de départ de créer une mode « moche » apparait comme étant très intéressante à de multiples niveaux, mais son exécution a été définitivement ratée. Sans compter que plus personne ne s’intéresse à ses vêtements, et que son message originel est devenu maintenant illisible, inaudible. Il demeure qu’il aura fait la Une pendant plusieurs jours et comme on dit souvent « Bad press is still press ». Mais pas sure qu’il se remette de celle-ci ; soyons indulgent, il n’est encore qu’un étudiant fraichement diplômé. Reste que si la communauté internationale s’émeut du travail raté d’un étudiant, c’est que l’atmosphère reste très fébrile quant à ces problématiques…
![]() So, what to think? Was it really racist, considering that blackface is as much a mockery of very bad taste on black men as on white men, although the latter have ignored it? Should fashion accept the injunctions of the doxa and the moral judgments on its artefacts? Was the student designer sincere in his non intention to appear racist?
So, what to think? Was it really racist, considering that blackface is as much a mockery of very bad taste on black men as on white men, although the latter have ignored it? Should fashion accept the injunctions of the doxa and the moral judgments on its artefacts? Was the student designer sincere in his non intention to appear racist?
Answer: the scandal of black faces around the world dates from a short time ago, this student could not ignore it or miss it. And if that has been the case, working in an area where culture is at stake does not allow ignorance of these kinds of issues.
Then, the blackfaces having been able to target white or black men, it remains that those who had to suffer from it were these black men, these African-American slaves. The devices used by the student are those used to compare black populations to monkeys (…)
To which we can add that fashion responds to societal injunctions, and if it has been and has been a scandal for a long time in history, this kind of racist scandal is regulated by law in many countries of the world – including France. So if it is not legal it does not have to be.
Finally and coming back to Junkai Huang, his initial idea of creating a « ugly » fashion appears to be very interesting on multiple levels, but its execution was definitively failed. Not to mention that nobody is interested in his clothes anymore, and that his original message has now become illegible, inaudible. The fact remains that he made headlines for several days and as we often say « Bad press is still press ». But not sure he is recovering from it; let us be indulgent, he is still only a freshly graduated student. The fact remains that if the international community is moved by the failed work of a student, it is because the atmosphere remains very feverish regarding these issues …
















Critiques

Image : Tim Mitchell, Clothing Recycled, 2005, © Tim Mitchell | www.timmitchell.co.uk
La mode est la seconde industrie la plus polluante au monde, derrières l’industrie pétrolière. Cette affirmation on l’a doit à une étude publiée en 2016 par une équipe de chercheurs membres du Danish Fashion Institute[1]. Certains chiffres apparaissent en effet alarmants : d’après l’ONG Greenpeace, la production d’un tee-shirt demande en moyenne 2700 litres d’eau et 7000 litres pour un jeans classique quand un humain en boit environ 1000 litres par an.
Or, des vêtements, il s’en vend plusieurs milliards chaque année, puisque la production de textiles a explosé ces dernières décennies dans ce que l’on a qualifié de Fast Fashion[2], terme apparu au début des années 2000. Ce phénomène de la fast fashion apparait dès les années 1980 dans une période où la sécurité alimentaire[3] est enfin assurée et où les famines sont souvent le fruit de conflits politiques plus que d’un manque réel de nourriture. Techniquement, au regard de la production mondiale, nous sommes dès les années 1980 en mesure de nourrir la population entière – bien que cela n’empêche pas des inégalités de perdurer.
Sur ce même modèle de la production alimentaire à grande échelle et moindres coûts, les industriels du textile vont inonder les marchés européens et occidentaux de plusieurs collections de vêtements par saison et sans marques ostentatoires, à des prix défiants toute concurrence. Zara, marque appartenant au groupe Inditex, produit plus de 12 000 vêtements différents chaque année[4], et ce groupe – comme celui de h&m ou encore Asos – vaut désormais autant que les grands groupes du luxe traditionnel.
L’idée est alors de se renouveler plusieurs fois par an pour susciter le désir et donc l’achat plusieurs fois par mois. Ainsi, on fabrique vite, quitte à ce que toutes les coutures ne soient pas réalisées ou au mieux mal réalisées. On fabrique en qualité moindre, en utilisant des jerseys, popeline de coton ou du satin de polyester obligeant le consommateur à racheter les mêmes produits qui s’usent au bout de quelques utilisations. On fabrique beaucoup, voire beaucoup trop, car plus on fabrique plus le prix baisse. On fabrique à moindres coûts, dans des pays où la main d’œuvre est peu chère et où main d’œuvre peu chère rime avec conditions de travail esclavagistes.
Et pourtant c’est bien de cette même fast fashion qu’émanent les premières actions pour une mode responsable à grande échelle. Mais une mode responsable est-elle réellement possible ? N’est-ce pas qu’un effet de mode, un biais marketing ? Quel avenir pour l’industrie du textile dans le monde à terme ? Allons-nous pouvoir continuer à produire autant ? Qu’est-ce que cette question du désir, de l’achat compulsif dit-il de notre civilisation ? Est-il conciliable avec les nouveaux enjeux environnementaux amenés par l’éthique environnementale propre au XXème siècle et si oui comment ?
De cet antagonisme de départ, entre désir d’avoir plus et nécessité de produire mieux, nous allons tâcher de faire le point sur les menaces que l’industrie du textile fait peser sur les sociétés humaines ; il s’agira ensuite de faire le constat de ce qui a été fait en la matière pour réduire les effets néfastes pour l’homme de ces modes de consommation, sans omettre une analyse critique, qui nous permettra de nous prononcer sur la viabilité de ces actions. Enfin, il s’agira de mettre en perspectives ce qu’on a pu recueillir d’informations pour envisager le futur de cette industrie, entre principe de responsabilité propre à Jonas et désir baudelairien de renouvellement insatiable.
Si la crise de l’environnement, ce cri d’alarme de quelques scientifiques puis sa prise de conscience par l’opinion publique internationale par l’usage récurent des termes de Global warming a déjà quarante ans, son lien de cause à effet avec l’industrie du textile est encore aujourd’hui sous-évalué et méconnu. En effet, généralement les grandes catastrophes environnementales sont celles des naufrages de pétroliers ou des continents de plastiques s’étendant sur les mers et générant des images marquant l’esprit collectif comme des atteintes à la nature de mains d’humains.
En effet, cet « environnement » cette nature à proprement parler, a toujours inspiré la mode. L’opinion, la doxa, a encore du mal à associer l’industrie du textile, à une atteinte directe portée à la nature. Pour preuve, le défilé Dior automne-hiver 2013-2014 s’étant tenu à Paris, le 2 juillet 2012, a nécessité pas moins d’un million de fleurs marquant les esprits d’images se rapportant davantage au merveilleux qu’au désastreux ; quant au dernier défilé Chanel au Grand Palais, il s’est tenu dans un décor de forêt recomposée avec véritables chênes, feuilles mortes et mousses de sous-bois évoquant alors le parfum d’une forêt en automne et toute sa mélancolie poétique et non la disparition des insectes due à l’utilisation de pesticides toujours plus dévastateurs pour la faune comme la flore avec le non moins célèbres exemple du roundup[5].
[1] http://source.ethicalfashionforum.com/assets-uploaded/documents/The_Future_of_Fashion_-_In_Facts_Figures___The_Ethical_Fashion_Source_(20150109).pdf
[2] Muran, Lisa. « Profile of H&M: A Pioneer of Fast Fashion. » Textile Outlook International (July 2007): 11-36. Textile Technology Index. EBSCO.
[3] Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, S’entendre sur la terminologie, CSA, 39e session, 15-20 octobre 2012, 17 p
[4] Lucy Siegle, To Die For. Fourth Estate, HarperCollins, 2010.
[5] Commercialisé depuis 1975, cet herbicide américain fut un des plus populaires dans les années 1990 et le plus vendu au monde. Bien que la commission européenne ait tenté d’en interdire la vente en 2016 suite à des études prouvant sa toxicité pour l’humain comme pour les autres vivants (nature), celle-ci n’a pas pu être ratifiée manque de voix suffisantes, possiblement due au lobby du groupe Monsanto. « Le désherbant le plus vendu au monde mis en accusation », Le Monde.fr, 9 janvier 2009
![]() Fast fashion, obsolescence and upcycling:
Fast fashion, obsolescence and upcycling:
sustainable fashion is it possible?
Fashion is the second most polluting industry in the world, behind the oil industry. This statement is due to a study published in 2016 by a team of researchers members of the Danish Fashion Institute [1]. Some figures are indeed alarming: according to the NGO Greenpeace, the production of a t-shirt requires an average of 2700 liters of water and 7000 liters for a classic jeans when a human drinks about 1000 liters per year.
However, clothing, it sells several billion every year, since the production of textiles has exploded in recent decades in what has been described as Fast Fashion [2], a term that appeared in the early 2000s. fast fashion appeared in the 1980s at a time when food security [3] was finally assured and famines were often the result of political conflicts rather than a real lack of food. Technically, in terms of world production, we are able to feed the entire population since the 1980s – although this does not prevent inequalities from continuing.
On the same model of large scale food production and lower costs, textile manufacturers will flood the European and Western markets with several clothing collections by season and without ostentatious brands, at unbeatable prices. Zara, a brand owned by the Inditex Group, produces more than 12,000 different garments each year [4], and this group – like that of h & m or Asos – is now worth as much as the big groups of traditional luxury.
The idea is then to renew several times a year to arouse desire and therefore purchase several times a month. Thus, one manufactures quickly, even if all the seams are not realized or at best poorly realized. It is manufactured in lower quality, using jerseys, cotton poplin or polyester satin forcing the consumer to buy the same products that wear after a few uses. We manufacture a lot, if not much, because the more we manufacture the lower the price. It is cheaper to manufacture in countries where labor is cheap and where cheap labor rhymes with slavery conditions.
And yet it is this same fast fashion that emanate the first actions for responsible fashion on a large scale. But is responsible fashion really possible? Is not that a fad, a marketing bias? What future for the textile industry in the world eventually? Will we be able to continue producing as much? What does this question of desire, compulsive buying, say about our civilization? Is it reconcilable with the new environmental issues brought about by the twentieth century environment ethic and if yes, how?
From this initial antagonism, between the desire to have more and the need to produce better, we will try to take stock of the threats that the textile industry places on human societies; it will then be necessary to note what has been done in this area to reduce the harmful effects for man of these modes of consumption, without omitting a critical analysis, which will enable us to pronounce on the viability of these actions. Finally, it will be a question of putting in perspective what one could gather information to consider the future of this industry, between principle of responsibility proper to Jonas and Baudelairian desire of insatiable renewal.
If the crisis of the environment, the cry of alarm of some scientists and its awareness by the international public opinion by the recurrent use of the terms of Global warming is already forty years, its link of cause and effect with the The textile industry is still underrated and underrated today. In fact, generally the major environmental catastrophes are those of tanker shipwrecks or continents of plastics extending over the seas and generating images that mark the collective spirit as attacks on the nature of human hands.
Indeed, this « environment » this nature strictly speaking, has always inspired fashion. The opinion, doxa, is still struggling to associate the textile industry with a direct attack on nature. As proof, the Dior Fall / Winter 2013-2014 show, held in Paris on July 2, 2012, required no less than one million flowers marking the spirits of images more related to the wonderful than to the disastrous; as for the last Chanel parade at the Grand Palais, it was held in a setting of forest recomposed with real oaks, dead leaves and undergrowth moss evoking then the scent of a forest in autumn and all its poetic melancholy and not the disappearance of insects due to the use of ever more devastating pesticides for fauna and flora with the no less famous example of roundup [5].
[2] Muran, Lisa. « Profile of H & M: A Pioneer of Fast Fashion. Textile Outlook International (July 2007): 11-36. Textile Technology Index. EBSCO.
[3] Committee on World Food Security, Agreeing on terminology, CSA, 39th Session, 15-20 October 2012, 17 p
[4] Lucy Siegle, To Die For. Fourth Estate, HarperCollins, 2010.
[5] Marketed since 1975, this American herbicide was one of the most popular in the 1990s and the best-selling in the world. Although the European Commission tried to ban its sale in 2016 following studies proving its toxicity for humans as for other living (nature), it could not be ratified lack of sufficient voice, possibly due to the lobby of the Monsanto group. « The world’s best selling weed killer, » Le Monde.fr, January 9, 2009
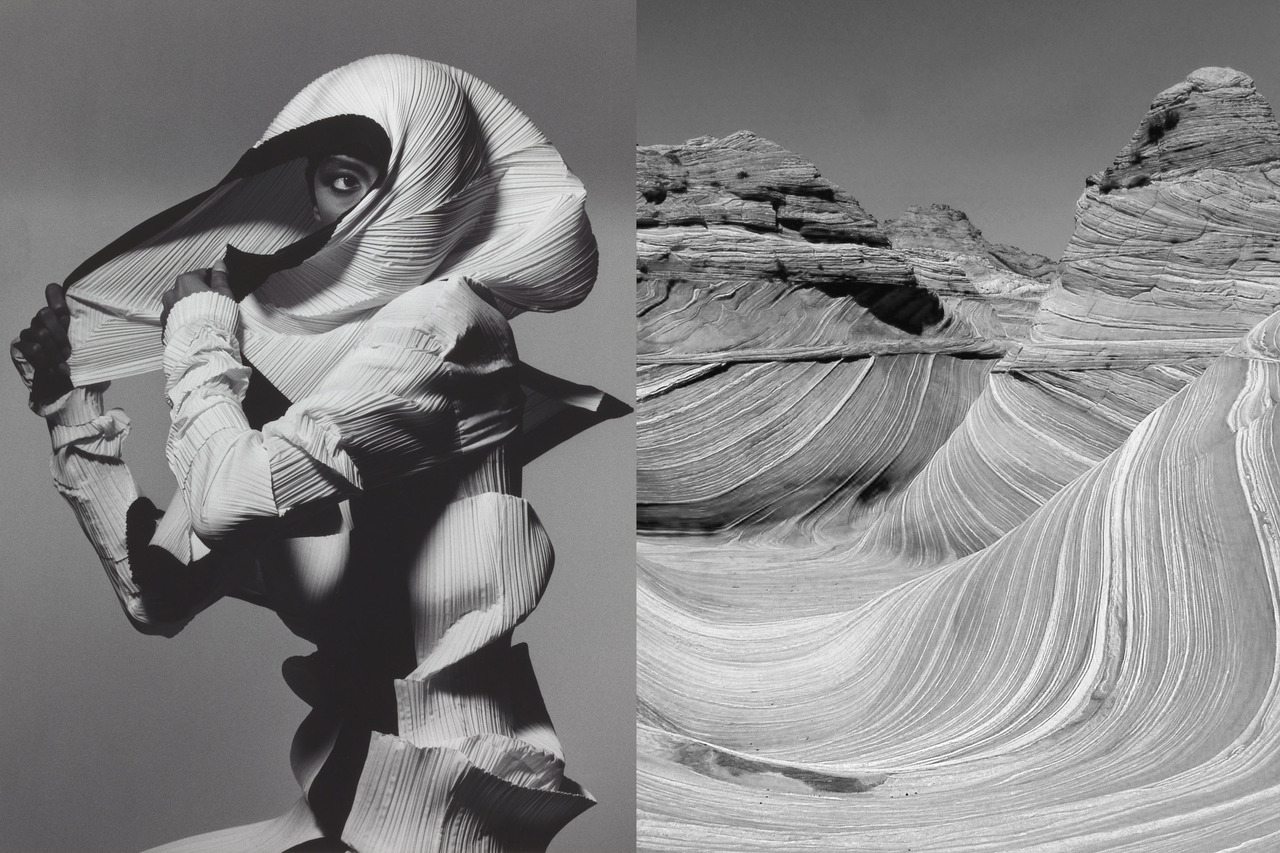

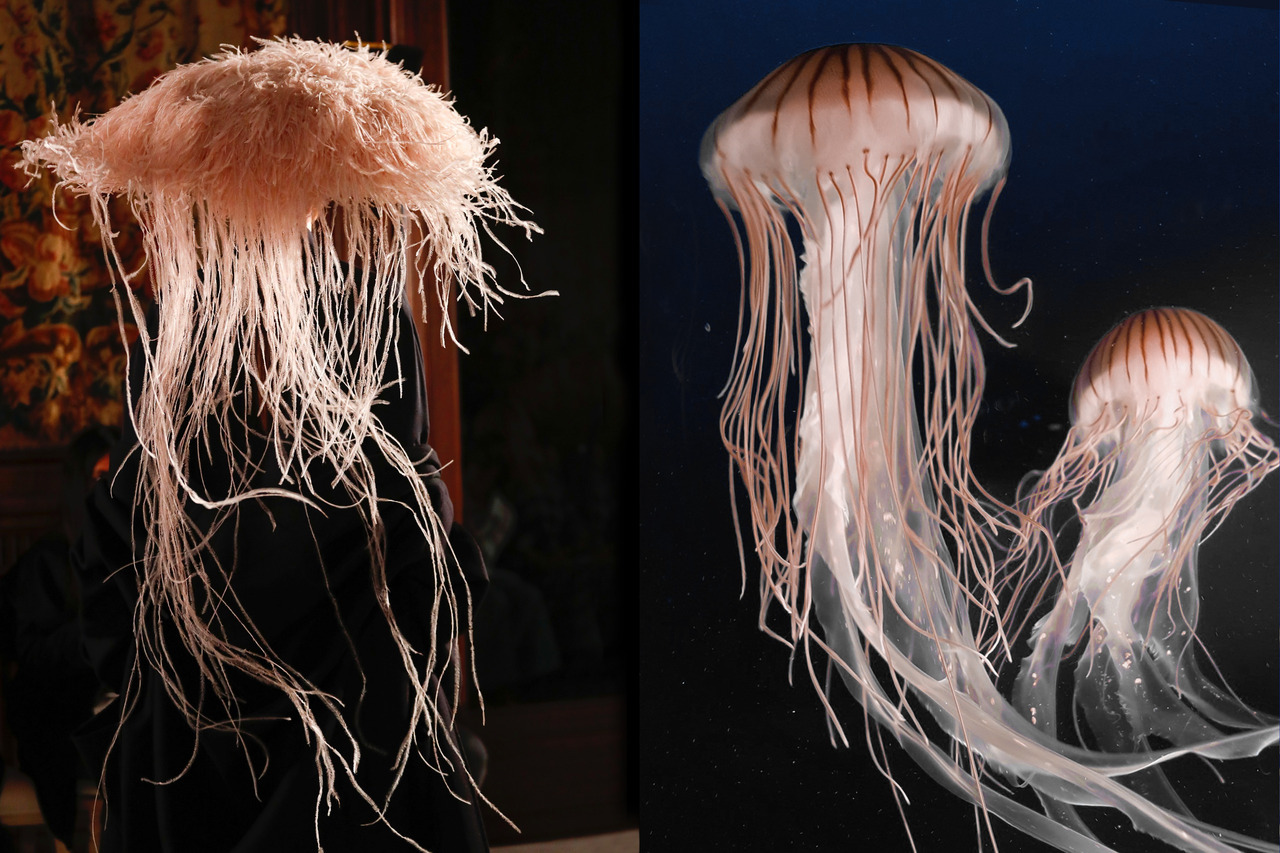

Issey Miyake Fall 1990 photographed by Irving Penn | The Wave, sandstone rock formation located in Arizona, United States
Details at Giambattista Valli Haute Couture Fall 2015 | Painting by Barbara Fox
Hat by Philip Treacy for Valentino Haute Couture Spring 2018 | Jellyfish
Details at Céline Fall 2013 | Forest with green moss and white trees
Devant cette apparente luxuriance des moyens mis à la disposition de l’industrie de la mode et ce mépris des conditions réelles de la biodiversité, il demeure que l’impact sur l’environnement de la machine textile est néfaste tant du point de vue de la fabrication que de l’utilisation. L’étude menée pour l’ADEME[1] (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) par la BIO Intelligence Service, a démontré que la vie d’un vêtement aussi banal qu’un jeans, de sa fabrication à sa fin de vie, contribuait lourdement au réchauffement climatique. Ainsi, on peut retenir de cette étude que :
- La production du coton y participe à hauteur de 15%(émissions de CO2 dans l’air lors des transports du coton 5%, émissions de N2O lors de la production d’engrais N 4%, consommation de diesel des machines 4% et consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité 2%).
- La filature de coton et son tissage : 22%(émissions de CO2 liées à la consommation de ressources fossiles pour la production d’électricité, consommation d’eau et risque toxique pour les milieux aquatiques, culture (intensive) du coton.)
- L’utilisation du jeans à 40% : (émissions de CO2 liées à la consommation de ressources fossiles (charbon, gaz, fuel) pour la production d’électricité pour d’une part la production des matières premières de la lessive (24% de l’impact potentiel total), et d’autre part l’utilisation du lave-linge (8% de l’impact total) et du fer à repasser (7% de l’impact).
Ce à quoi il convient d’ajouter la pollution photochimique, la consommation de ressources non renouvelables, l’écotoxicité sédimentaire et la production de déchets ménagers. Soit une consommation de ressources renouvelables mais aussi non renouvelables inconsidérée, une pollution mettant en branle la survie de l’espèce humaine et de l’écosystème dont il participe, mais aussi une aliénation véritable de certains humains pour les désirs des autres voire leurs propres morts pour quelques économies.
Le 24 avril 2013 au Bengladesh une usine textile, la Rana Plaza a ainsi pu entraîner la mort de 1135 personnes, femmes et ouvrières pour la plus grande majorité, dont certaines mineures. Cet événement a pu susciter l’indignation mondiale, car au milieu des ruines, on a pu découvrir par les images de reporters sur place, que ces ouvrières travaillent à la confection de vêtements Carrefour, Mango, Primark, Benetton, Auchan, Camaïeu et bien d’autres encore.
[1] https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-03/1.1.2.e-acv_exemple_6_acv_dun_pantalon_en_jean__bio_intelligence_service-ademe.pdf
![]() Issey Miyake Fall 1990 photographed by Irving Penn | The Wave, sandstone rock formation located in Arizona, United States
Issey Miyake Fall 1990 photographed by Irving Penn | The Wave, sandstone rock formation located in Arizona, United States
Details at Giambattista Valli Haute Couture Fall 2015 | Painting by Barbara Fox
Hat by Philip Treacy for Valentino Haute Couture Spring 2018 | Jellyfish
Details at Céline Fall 2013 | Forest with green moss
Faced with this apparent luxuriance of the means at the disposal of the fashion industry and contempt for the real conditions of biodiversity, the fact remains that the impact on the environment of the textile machine is harmful both from the point of view of manufacture only from use. The study conducted for the ADEME [1] (Agency for the environment and energy management) by the BIO Intelligence Service, has shown that the life of a garment as commonplace as jeans, its manufacture at the end of its life, contributed heavily to global warming. Thus, we can retain from this study that:
Cotton production accounts for 15% (CO2 emissions in the air during cotton transport 5%, N2O emissions during fertilizer production N 4%, diesel consumption of machinery 4% and consumption of fossil resources for electricity production 2%).
Cotton spinning and weaving: 22% (CO2 emissions related to the consumption of fossil resources for electricity generation, water consumption and toxic risk for aquatic environments, (intensive) cotton cultivation.)
The use of jeans at 40%: (CO2 emissions linked to the consumption of fossil resources (coal, gas, fuel) for the production of electricity for the one hand the production of laundry raw materials (24% of the total potential impact), and on the other hand the use of the washing machine (8% of the total impact) and the iron (7% of the impact).
To which should be added photochemical pollution, the consumption of non-renewable resources, sediment ecotoxicity and the production of household waste. Either a consumption of renewable resources but also non-renewable recklessly, a pollution setting in motion the survival of the human species and the ecosystem in which it participates, but also a real alienation of some humans for the desires of others or even their own dead for some savings.
On April 24, 2013 in Bangladesh a textile factory, the Rana Plaza has resulted in the death of 1135 people, women and workers for the vast majority, including some minors. This event was able to arouse worldwide indignation, because in the middle of the ruins, it was discovered by the images of reporters on the spot, that these workers are working on the making of clothes Carrefour, Mango, Primark, Benetton, Auchan, Camaïeu and well more besides.
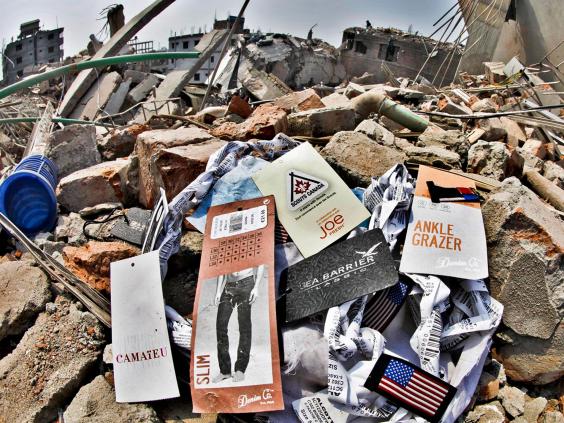
© Rashed Shumon
Ainsi, non content de s’attaquer à l’environnement, l’industrie textile est aussi responsable de l’esclavagisme de certains humains selon leur place sur le globe, parfois même de la précipitation de leur mort. Non contente d’exploiter des forces humaines d’un côté du globe, de l’autre elle torture leur corps sous la pression d’une tyrannie du paraître. Ainsi, là où l’industrie de la mode agit de manière à véhiculer qu’une forme de corps possible, qu’un genre de vêtements portables, issu de bureaux de tendances, les corps se déforme jusqu’à nier l’homéostasie d’un corps en bonne santé.[1]
Au début des années 2000, l’extrême maigreur véhicule l’idée d’un corps extrêmement maitrisé, contrôlé jusqu’à l’outrance de la peau qui se décharne pour laisser apparaître le squelette des jeunes femmes. Le corps sous-alimenté, sous la pression de ce que cette industrie véhicule par voie de publicités diverses, n’est alors plus réglé, plus apte à engendrer la vie humaine. Cette négation du biologique impacte l’environnement en ce qu’il impacte l’humain, maillon de la chaîne Nature. La taille zéro, voire triple zéro équivalant à un tour de taille de 58 cm soit l’équivalent du corps d’une fillette de 6 à 8 ans) autrefois l’apanage des rayons enfants, apparait, et l’industrie textile la véhicule niant alors le biologique chez l’humain, jusqu’à le rendre machine.
Car en effet, la prothèse, si elle est utile lorsqu’une mutilation apparait sur un corps du fait d’une grossesse compliquée, d’un accident ou d’une maladie, devient tout autre chose lorsque elle est imposée à l’humain par l’industrie, lorsqu’il s’agit d’avoir le corps adéquat aux vêtements distribués dans les grandes enseignes. Dès 2011, l’agence sanitaire américaine – Food and Drug Administration – a publié un rapport associant l’apparition du lymphome anaplasique (tumeur) à grandes cellules et la pose d’implants mammaires, tumeur difficilement soignable et conduisant à la mort.
Enfin, s’attaquant aux ressources naturelles, aux humains de manière plurielle, elle s’attaque bien entendu aussi aux animaux. Si l’industrie bovine et autres commerces destinés à nourrir les humains ravagent la communauté animal par des conditions de production indécentes où les animaux sont rendus au stade de marchandise, l’utilisation de médicaments sur les élevages contaminant l’espèce humaine, et polluant les sols, le textile n’est pas non plus en reste.
[1] Le parti-pris qui est opéré ici est celui d’une hypothèse Gaïa au sein de laquelle l’homme participe de l’environnement en en étant lui-même une partie dans ce que James Lovelock qualifiait au cours des années 1970 de superorganisme. Lawrence E. Joseph, « James Lovelock, Gaia’s grand old man », salon.com, 17 août 2000
![]() Thus, not content to attack the environment, the textile industry is also responsible for the slavery of some humans according to their place on the globe, sometimes even the precipitation of their death. Not content to exploit human forces on one side of the globe, on the other she tortures their bodies under the pressure of a tyranny of appearances. Thus, where the fashion industry acts to convey a possible body shape, a kind of wearable clothing, from office trends, the body is deformed to deny the homeostasis of a healthy body. [1]
Thus, not content to attack the environment, the textile industry is also responsible for the slavery of some humans according to their place on the globe, sometimes even the precipitation of their death. Not content to exploit human forces on one side of the globe, on the other she tortures their bodies under the pressure of a tyranny of appearances. Thus, where the fashion industry acts to convey a possible body shape, a kind of wearable clothing, from office trends, the body is deformed to deny the homeostasis of a healthy body. [1]
In the early 2000s, the extreme thinness conveys the idea of an extremely controlled body, controlled until the excess of the skin which is discharged to reveal the skeleton of young women. The undernourished body, under the pressure of what this industry conveys through various advertisements, is no longer regulated, more likely to engender human life. This negation of the biological impacts the environment in that it impacts the human link in the Nature chain. The size zero or even triple zero equivalent to a waist of 58 cm is the equivalent of the body of a girl 6 to 8 years old) formerly the prerogative of children’s rays, appears, and the textile industry the vehicle denying then the biological in humans, to make it machine.
Indeed, the prosthesis, if it is useful when a mutilation appears on a body because of a complicated pregnancy, an accident or an illness, becomes quite different when it is imposed on the human by industry, when it comes to having the right body for clothing distributed in major retailers. In 2011, the US health agency – Food and Drug Administration – published a report associating the appearance of anaplastic lymphoma (tumor) to large cells and the placement of breast implants, a tumor that is difficult to treat and leads to death.
Finally, attacking natural resources, humans in a plural way, it also attacks animals. If the cattle industry and other businesses destined to feed humans ravage the animal community by indecent production conditions where animals are at the merchandise stage, the use of drugs on farms contaminating the human species, and polluting the animals. soils, the textile is not left out either.
[1] The bias that is made here is that of a Gaia hypothesis in which man participates in the environment by being himself a part of what James Lovelock described in the 1970s as superorganism. Lawrence E. Joseph, « James Lovelock, Gaia’s Grand Old Man », salon.com, August 17, 2000

© Peta
Le commerce de la fourrure et des cuirs invite à se questionner sur le rapport de l’humain avec la nature ; d’après Peta, organisation pour la défense des animaux, les élevages d’animaux à fourrure font montre de « d’animaux aux yeux infectés, des pattes blessées par les barreaux métalliques de leur cage insalubre, des membres arrachés et purulents, des plaies béantes laissées sans traitement (parfois tellement profondes que leur cerveau est apparent) ; des petits qui partagent leur cage avec le cadavre de leur mère en putréfaction ; et des animaux dont le comportement névrotique témoigne de l’importance des dégâts psychologiques qu’ils subissent. »
A cela s’ajoute qu’afin d’éviter le plus possible la putréfaction, les producteurs les aspergent d’un cocktail de produits chimiques dangereux pour la santé des sols comme pour celles des ouvriers travaillant à la confection de ces textile : le formaldéhyde et le chrome. La Banque Mondiale a ainsi classé l’industrie de la fourrure comme une des plus dangereuses au monde du fait de la pollution aux métaux toxiques qu’elle provoque.
La question que l’on peut légitimement se poser est ainsi de savoir si l’industrie textile, devant toutes ces accusations toutes les plus diverses mais attenant toutes à l’équilibre de l’environnement, prend des mesures, et si oui, de quel ordre ?
« Nous sommes près du point de non-retour où le réchauffement climatique deviendrait irréversible. Les actions de Trump pourraient faire basculer la Terre de l’autre côté, pour devenir comme Vénus, avec des températures à plus de 250 degrés et des pluies d’acide sulfurique. »[1] C’est en ces termes que le physicien Stephen Hawking commentait la sortie des Accords de Paris par le Président Nord-Américain nouvellement élu Donald Trump.
Malgré ces propos alarmants, proféré par une sommité scientifique, on est en droit de s’interroger quant aux actions déjà entreprises et à venir par ceux qui détiennent réellement les capitaux et parmi les plus grands responsables des catastrophes environnementales : les grands groupes. Ainsi, de grands groupes comme h&m créés des lignes de vêtements équitables où le coton utilisé est biologique et à partir de fournisseurs devant s’astreindre à une charte respectant les droits de leurs travailleurs.
En 2011 h&m créé la ligne Conscious en lien avec le rapport publié en 2010 concernant la responsabilité sociale et environnementale d’H&M qui explique alors avoir poussé 68.000 cultivateurs de coton à cultiver de façon plus durable grâce à Better Cotton Initiative, avoir utilisé 1.600 tonnes de matériaux recyclés pour ses vêtements, avoir utilisé 15.000 tonnes de coton biologique, soit + 77 % par rapport à 2009 et avoir renoncé au sablage de ses jeans.[2] Cela à quoi s’ajoute une collecte de vêtement organisée par la chaîne permettant de recycler les vêtements usagés des clientes contre des bons d’achats.
Néanmoins, force est de constater que le groupe a été accusé en 2010 de vendre des tee-shirts dont l’étiquette mentionnait « coton bio » mais dont la composition révélait des traces d’OGM.[3] A ce scandale s’ajoute celui des invendus retrouvés dans une poubelle appartenant à un magasin new-yorkais lacérés, quand ils auraient pu être donnés à des associations voire recyclés par leur propre collecte dont seulement 1% des vêtements récupérés est réutilisé …[4]
[1] Propos rapportés par la BBC.
[2] Données recueillies sur www.consoglobe.com
[3] https://www.lexpress.fr/styles/mode/h-amp-m-utilise-du-coton-ogm-certifie-bio_844565.html
[4] https://www.lexpress.fr/styles/mode/h-m-jette-ses-invendus-a-la-poubelle_840523.html Sur le manque de transparence concernant les produits recyclés par la collecte du groupe h&m : https://www.greenpeace.org/archive-international/en/news/Blogs/makingwaves/hm-burning-new-clothes-fast-fashion-incineration/blog/60640/
![]() The fur and leather trade invites us to question the relationship between humans and nature; according to Peta, an organization for the defense of animals, fur farms show « animals with infected eyes, legs injured by the metal bars of their insanitary cage, torn and purulent limbs, wounds gaping left untreated (sometimes so deep that their brains are apparent); pups who share their cage with their rotten mother’s corpse; and animals whose neurotic behavior shows the extent of the psychological damage they suffer. »
The fur and leather trade invites us to question the relationship between humans and nature; according to Peta, an organization for the defense of animals, fur farms show « animals with infected eyes, legs injured by the metal bars of their insanitary cage, torn and purulent limbs, wounds gaping left untreated (sometimes so deep that their brains are apparent); pups who share their cage with their rotten mother’s corpse; and animals whose neurotic behavior shows the extent of the psychological damage they suffer. »
To this is added that in order to avoid rot as much as possible, the producers sprinkle them with a cocktail of chemicals dangerous for the health of the soil as well as for those of the workers working to make these textiles: formaldehyde and chrome. The World Bank has classified the fur industry as one of the most dangerous in the world because of the toxic metal pollution it causes.
The question that one can legitimately ask is thus whether the textile industry, faced with all these accusations all the most diverse but all attached to the balance of the environment, takes measures, and if so, how order?
“We are near the point of no return where global warming would become irreversible. Trump’s actions could tip Earth to the other side, like Venus, with temperatures above 250 degrees and rains of sulfuric acid. [1] It was in these terms that physicist Stephen Hawking commented on the exit of the Paris Agreements by the newly elected North American President Donald Trump.
Despite these alarming remarks, made by a scientific authority, we are entitled to wonder about the actions already undertaken and to come by those who really hold the capital and among the greatest responsible for environmental disasters: large groups. Large groups such as h & m have created fair trade clothing lines where the cotton used is organic and from suppliers who have to comply with a charter respecting the rights of their workers.
In 2011 h & m created the Conscious line in connection with the report published in 2010 concerning H & M’s social and environmental responsibility, which explains that it pushed 68,000 cotton farmers to cultivate more sustainably thanks to the Better Cotton Initiative, having used 1,600 tonnes of recycled materials for his clothes, having used 15,000 tonnes of organic cotton, ie + 77% compared to 2009 and having given up the sanding of his jeans. [2] This is in addition to a collection of clothing organized by the chain allowing the recycling of used clothes from customers against vouchers.
However, it is clear that the group was accused in 2010 of selling T-shirts whose label mentioned « organic cotton » but whose composition revealed traces of GMOs. [3] To this scandal is added that of the unsold items found in a trash can belonging to a lacerated New York store, when they could have been given to associations or even recycled by their own collection, of which only 1% of the recovered clothing is reused … [4]
[1] Words reported by the BBC.
[2] Data collected on www.consoglobe.com
[3] https://www.lexpress.fr/styles/mode/h-amp-m-apte-du-coton-ogm-certifie-bio_844565.html
[4] https://www.lexpress.fr/styles/mode/hm-jette-ses-invendus-a-la-poubelle_840523.html On the lack of transparency concerning the products recycled by the collection of the group h & m: https: //www.greenpeace.org/archive-international/en/news/Blogs/makingwaves/hm-burning-new-clothes-fast-fashion-incineration/blog/60640/

Photo du reportage de Marie Dorigny publié par « Life » en juin 1996
Force est donc de constater, autour de l’exemple de cette enseigne, que généralement les annonces des grands groupes concernant des mesures prises pour leurs salariés et/ ou pour l’environnement font davantage office de campagnes publicitaires visant à séduire le consommateur sensibilisé à ces problématiques. On se rappelle encore du premier grand scandale planétaire de la marque Nike qui faisait fabriquer ses produits par des enfants et des pertes retentissantes en termes de chiffres d’affaires.
Ainsi, vendre l’idée d’un intérêt pour la cause environnementale voire d’une action vertueuse pour celle-ci est généralement affaire de profits. Néanmoins, devant la pollution croissante et les ravages du gaspillage opérés par les industriels de la fast fashion, s’est développée une pratique au sein des sociétés occidentales économique et culturelle : le véganisme ou végétalisme intégral. Ce dernier se propose – afin d’enrailler l’action néfaste de l’humain sur la planète de ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation.
Ce qui signifie ne pas consommer de médicament ayant été testés sur les animaux, ne pas consommer de produit animal ni viandes ni lait ni beurre, ne pas porter des vêtements dont les fibres sont issues de l’exploitation animales comme le cuir, la laine, la soie, etc. Ce mode de vie, tâchant de limiter notre impact sur l’environnement et ses composants aurait pourtant des effets catastrophiques s’il en venait à devenir la norme. En effet, au regard de l’agriculture céréalière, il empêcherait les agriculteurs d’utiliser du fumier, issu de l’élevage principalement de viande bovine, et demanderait donc l’utilisation d’engrais généralement chimiques et dangereux.
Les cuirs dit végan commercialisé en masse, sont eux-aussi plus nocifs que les cuirs animaux puisqu’ils sont issu de l’industrie pétrolière, soit la plus polluante au monde, devant l’industrie textile. Là où certaines études démontrent que la consommation de viande rouge provoque des cancers chez l’homme, il convient en fait de rappeler que les études affirmant ces données sont menées principalement menées aux Etats-Unis et en Chine, pays où les élevages sont gavés d’antibiotiques et d’hormones, provoquant ainsi la survenue de ces cancers.
Ainsi résumé, le véganisme ne semble pas apporter de solution viable pour l’environnement. En existe-t-il ? Le cas du vintage, apparu au cours du vingtième siècle, est semble-t-il une solution qui marche. L’achat de produits de seconde main évite le jet aux ordures de vêtements qui faute d’infrastructures nécessaires et de volonté en la matière de la part des pouvoirs publics sont encore trop peu recyclés. Si le vêtement de seconde main est une solution viable, il demeure que l’industrie du textile, devant ce succès des vêtements vintages, ont pu se lancer dans la confection de pièces vendues comme telles mais fabriqués il y a peu, ne reprenant que le style ancien et suranné qui plait tant aux adeptes.
Mieux que le vintage, l’upcycling, tendance pas si neuve qu’il n’y parait, semble séduire les jeunes créateurs. Elle consiste en l’utilisation de vieux textiles ou divers matériau dans la confection de nouveaux habits. Un des pionniers en la matière est bien entendu Martin Margiela.
![]() Photo of Marie Dorigny’s report published by « Life » in June 1996
Photo of Marie Dorigny’s report published by « Life » in June 1996
It should therefore be noted, around the example of this brand, that announcements by major groups concerning measures taken for their employees and / or for the environment are more often used as advertising campaigns aimed at attracting consumers who are aware of these issues. issues. We still remember the first major global scandal of the Nike brand that had its products made by children and losses in terms of turnover.
Thus, selling the idea of an interest in the environmental cause or even a virtuous action for it is usually a matter of profits. Nevertheless, in the face of the growing pollution and the ravages of waste made by fast fashion manufacturers, a practice has developed within Western economic and cultural societies: veganism or integral veganism. The latter proposes – in order to stop the harmful action of humans on the planet to consume no product from animals or their exploitation.
Which means do not use drugs that have been tested on animals, do not consume animal products or meat, milk or butter, do not wear clothing whose fibers are derived from animal exploitation such as leather, wool, silk, etc. This way of life, trying to limit our impact on the environment and its components would have catastrophic effects if it became the norm. In fact, with regard to cereal farming, it would prevent farmers from using manure, mainly from beef, and would therefore require the use of generally chemical and dangerous fertilizers.
Vegan leathers, mass marketed, are also more harmful than animal leathers since they come from the oil industry, the most polluting in the world, in front of the textile industry. Where some studies show that the consumption of red meat causes cancer in humans, it should be remembered that the studies asserting these data are conducted mainly in the United States and China, where the farms are force-fed. antibiotics and hormones, thus causing the occurrence of these cancers.
Thus summarized, veganism does not seem to provide a viable solution for the environment. Does it exist? The case of the vintage, appeared during the twentieth century, is apparently a solution that works. The purchase of second-hand products avoids garbage garbage that lack of necessary infrastructure and willingness on the part of the authorities are still too little recycled. If second-hand clothing is a viable solution, it remains that the textile industry, faced with the success of vintage clothing, have been able to engage in the manufacture of pieces sold as such but manufactured recently, taking only the Old and old style that appeals to fans.
Better than vintage, upcycling, trend not so new as it seems, seems to seduce young designers. It consists of the use of old textiles or various materials in the making of new clothes. One of the pioneers in this area is of course Martin Margiela.

Martin Margiela, gilet, Printemps-Été 1990. Pièce réalisée à partir d’affiches publicitaires lacérées et collées sur coton. Collection du Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Ce gilet sans manches datant d’une collection printemps/ été 1990, est composé de morceaux d’affiches publicitaires récupérées dans le métro parisien. D’autres pièces étaient déjà composées de sacs plastiques attachés avec du scotch sur lesquels étaient imprimés un « 90 ». Les années 1990 ouvrent la voie à une nouvelle forme de création déjà vue dans l’art avec notamment Jacques Villeglé ou encore César, le recyclage, ou upcycling : faire de déchets de nouvelles créations. Une collection printemps/ été 2006 sera entièrement – appelée ligne zéro – réalisée en France à partir de matériaux retravaillés, récupérés aux hasards de ce qui est jeté, vintage ou tout simplement anciens.
Le couturier a pu inspirer toute une génération de jeunes créateurs sensibles aux méfaits de l’industrie textile. Se confiant au magazine Antidote, Maroussia Rebecq confiait ceci : « On a commencé en upcyclant des fripes, puis des pièces vintage, et maintenant on upcycle des stocks invendus de marques. Cela reste des leftovers, mais ils peuvent être neufs et reproductibles. » Si l’upcycling tarde encore un peu à trouver son public, contrairement au vintage rentré dans les mœurs, la jeune génération ne semble pas désespérer au regard de l’intérêt qui ne faiblit pas pour les chutes, fripes, invendus ou autres deadstocks en faveur d’un flow system.
![]() Martin Margiela, vest, Spring-Summer 1990. Piece made from advertising posters lacerated and stuck on cotton. Collection of the Palais Galliera, Fashion Museum of the City of Paris. © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
Martin Margiela, vest, Spring-Summer 1990. Piece made from advertising posters lacerated and stuck on cotton. Collection of the Palais Galliera, Fashion Museum of the City of Paris. © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet
This sleeveless vest from a spring / summer 1990 collection, is composed of pieces of advertising posters collected in the Paris metro. Other pieces were already composed of plastic bags tied with tape on which were printed a « 90 ». The 1990s opened the way to a new form of creation already seen in art with notably Jacques Villeglé or Caesar, recycling, or upcycling: to make waste of new creations. A spring / summer 2006 collection will be entirely – called zero line – made in France from reworked materials, recovered at the chance of what is thrown, vintage or simply old.
The designer was able to inspire a generation of young creators sensitive to the misdeeds of the textile industry. Speaking to Antidote magazine, Maroussia Rebecq said: « We started upcycling second-hand clothes, then vintage pieces, and now we’re upcycle unsold inventories. This remains leftovers, but they can be new and reproducible. If the upcycling still takes a little time to find its audience, unlike the vintage returned to the customs, the younger generation does not seem to despair in view of the interest that does not weaken for falls, second-hand, unsold or other deadstocks in favor of a flow system.

Copyright Andrea Crews printemps-été 2018
La mode institutionnalisée elle-même semble se convertir à cette esthétique de la seconde main. En 2000, John Galliano chez Dior créé le scandale avec une Hobo couture collection composée de vêtements aux imprimés papiers journaux, troués, déchirés, aux couleurs proches de celle d’une flaque d’eau sur un trottoir boueux. Si elle avait pu faire scandale il y a 18 ans, on a pu retrouver cette tendance récemment chez Raf Simons, sans que cela ne semble émouvoir ou irriter quiconque, tendance qui était alors considérée comme marginale dans les années 1990 du grunge.
![]() Institutionalized fashion itself seems to be converted to this second-hand aesthetic. In 2000, John Galliano at Dior created the scandal with a Hobo sewing collection composed of printed newspaper, perforated, ripped, with colors close to that of a puddle on a muddy sidewalk. If it could have been a scandal 18 years ago, Raf Simons could have found this trend recently, but it does not seem to move or irritate anyone, a trend that was considered marginal in the 1990s of grunge.
Institutionalized fashion itself seems to be converted to this second-hand aesthetic. In 2000, John Galliano at Dior created the scandal with a Hobo sewing collection composed of printed newspaper, perforated, ripped, with colors close to that of a puddle on a muddy sidewalk. If it could have been a scandal 18 years ago, Raf Simons could have found this trend recently, but it does not seem to move or irritate anyone, a trend that was considered marginal in the 1990s of grunge.

Kurt Cobain dans les années 1990. Getty image.
L’upcycling, s’il est encore l’apanage d’initiés et de labels indépendants de jeunes créateurs, est néanmoins le fruit de revendications restées sans suite, et d’une prise de pouvoir de citoyens pour l’avenir de l’environnement là où les pouvoirs publics ne semblent pas enclins à agir, malgré le principe de précaution que l’on devrait au philosophe Hans Jonas.
Son propos, adopté en 1992 seulement, au cours de la conférence sur la diversité biologique à Rio selon laquelle « en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives, visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».
Si l’on n’a pu éviter les premiers méfaits sur l’environnement, il convient de s’interroger sur notre volonté d’œuvrer ou non en faveur des générations futures ; Stephan Gardiner, un philosophe américain se demande ainsi si l’on va être à même de ne pas faire payer les générations futures pour nos erreurs actuelles, ou non ?
S’il peut paraître difficile de parler d’écologie en philosophie, notamment par le manque de vocabulaire adéquat, il demeure que c’est en son sein qu’ont pu émerger différents mouvements interpellant l’opinion publique et appelant ses congénères à rompre avec une certaine vision de l’écologie comme anthropocentrique qui doit à terme être remplacée par une écologie biocentrée. A ce propos, dès 1973, Arne Naess, philosophe norvégien publie un article dans lequel il met au jour le concept de « deep ecology » ou d’écologie profonde.
Ce qu’il tâche de faire entendre par-là, c’est que les êtres vivants quels qu’ils soient ont une valeur intrinsèque indépendante de l’utilité qu’ils représentent pour les êtres humains. Et que l’écologie telle qu’elle a pu être pensée, opérée jusqu’à aujourd’hui est une « shallow écologie », une écologie superficielle, ne s’attaquant qu’aux méfaits que la pollution produit et jamais aux valeurs qui la rendent possible.
Ainsi, il s’agit d’opérer un changement de paradigme dans les esprits dans les attitudes des humains afin de contrer le phénomène qui résulte d’une certaine forme de désinvolture quant aux actions de l’humain sur son environnement, voire d’un seul intérêt pour l’écologie lorsque celle-ci touche à l’économie. L’enracinement culturel de cette forme de la philosophie on la retrouve principalement aux Etas-Unis.
Le fondement de cette écologie profonde on le retrouve dans une critique des savoirs occidentaux jugés comme étant anthropocentrique, critique à l’œuvre chez Nietzsche, Rousseau, Thoreau et bien d’autres. A partir de ces penseurs, on va être amené à envisager une défense militante de la Terre, une opposition – que l’on retrouve chez Greenpeace – aux attaques de l’homme contre une nature considérée comme vierge et sauvage.
![]() Kurt Cobain in the 1990s. Getty image.
Kurt Cobain in the 1990s. Getty image.
Upcycling, although still the preserve of independent initiates and independent labels of young creators, is nevertheless the fruit of unfulfilled claims and citizens’ empowerment for the future of the environment. where the public authorities do not seem inclined to act, despite the precautionary principle that we should the philosopher Hans Jonas.
His remarks, adopted in 1992 only, during the conference on biological diversity in Rio that « in case of risk of serious or irreversible damage, the lack of absolute certainty should not be used as an excuse to postpone adoption of effective measures to prevent environmental degradation « .
If we have not been able to avoid the first harms on the environment, we must question our will to work or not for the benefit of future generations; Stephan Gardiner, an American philosopher wonders if we will be able to not pay future generations for our current mistakes, or not?
While it may seem difficult to speak of ecology in philosophy, especially by the lack of adequate vocabulary, it remains that it was within it that could emerge various movements challenging the public opinion and calling its congeners to break with a certain vision of ecology as anthropocentric which must eventually be replaced by a biocentric ecology. In this respect, as early as 1973, Arne Naess, a Norwegian philosopher, published an article in which he brought to light the concept of deep ecology or deep ecology.
What he strives to make clear is that living beings, whatever they may be, have an intrinsic value that is independent of the utility they represent for human beings. And that the ecology as it was thought, operated until today is a « shallow ecology », a superficial ecology, only attacking the misdeeds that pollution produces and never to the values that the make it possible.
Thus, it is a question of making a paradigm shift in people’s minds in order to counter the phenomenon that results from a certain form of casualness regarding the actions of the human being on his environment, or even a only interest in ecology when it touches the economy. The cultural rooting of this form of philosophy is found mainly in the United States.
The foundation of this profound ecology can be found in a critique of Western knowledge deemed to be anthropocentric, critical at work in Nietzsche, Rousseau, Thoreau and many others. From these thinkers, we will be led to consider a militant defense of the Earth, an opposition – found in Greenpeace – to the attacks of man against a nature considered virgin and wild.
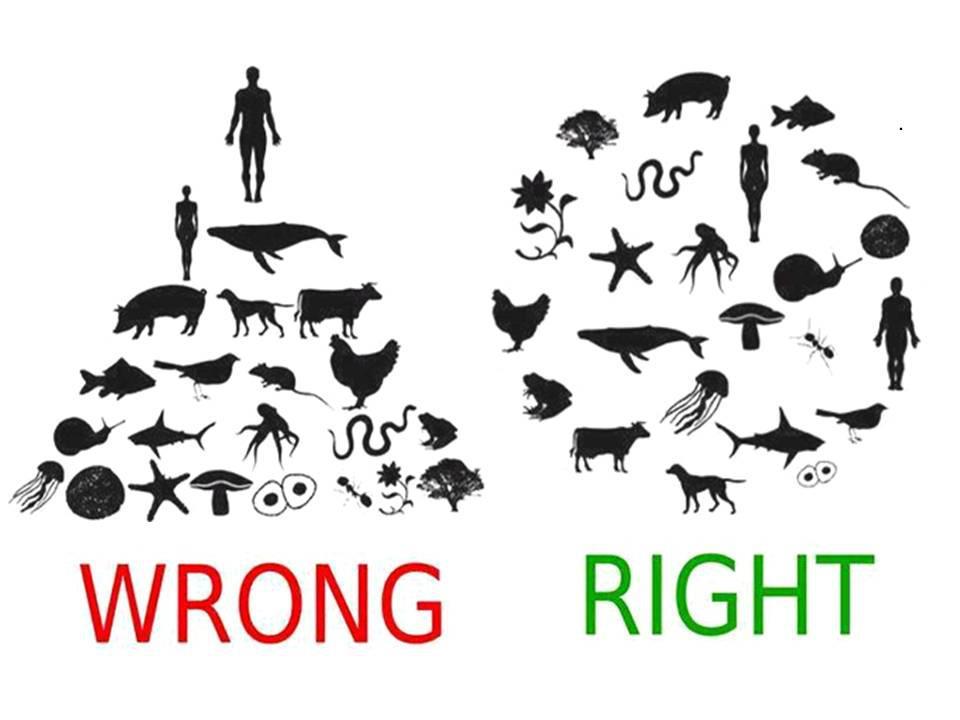
Copyright http://www.greensocietycampaign.org/beyond-green-podcast-episode-22-deep-ecology-an-ethicists-dream-or-nightmare/
La question que l’on est alors en droit de se poser est de savoir si, comme le « bon sauvage » chez Rousseau était un mythe, la nature vierge et sauvage existe-t-elle encore ? N’est-on pas là dans un forme de l’eugénisme propre au XIXème siècle qui voulait rendre la pureté à l’homme, par l’évitement de croisements « inter-espèces humaines », lorsque l’on revendique le droit de rendre les zones dégradés par l’homme, de la nature, à leur pureté originelle (wilderness) ?
Cette philosophie qui aime à se présenter comme universaliste appelle de ses vœux qu’une grande partie du globe soit immédiatement rendue inaccessible aux êtres humains. Le poète Gary Snyder a lui-même milité pour une réduction de 90% de la population humaine afin de permettre à l’environnement de retrouver sa condition originelle. Ce préservationnisme apparait radical, au regard de ce qu’une réduction de la population mondiale engendrait. On se souvient de la politique de l’enfant unique en Chine de 1979 à 2015, et des « enfants noirs » ou sans papiers, privés de droits et d’existence citoyenne (pas d’instruction, impossibilité de travailler…) mais aussi les stérilisations forcées et les avortements par la force.
A ce propos, les tenants de la deep ecology évoque généralement les philosophies orientales dont les traditions, contrairement aux traditions occidentales et principalement chrétiennes, seraient précurseurs de l’écologie profonde et bien plus proche de la nature que ne l’ont été les occidentaux. Cette association entre sagesse orientale (ancienne) et écologique (moderne) semblerait même valider la portée universelle de l’écologie profonde. Pourtant, l’importance accordée à la wilderness est véritablement néfaste lorsqu’on l’applique au tiers monde, voire aux populations les plus pauvres en général.
En Inde par exemple, les réserves naturelles, à travers le « projet tiger », considérées comme remarquables d’un point de vue environnemental par l’opinion internationale prend pourtant davantage le parti des animaux que des populations les plus pauvres : à ce titre on a pu par exemple déplacer des villages existants et rendre à l’état de nomadisme certaines populations villageoises qui de surcroit souffrait déjà de pénurie d’eau, d’énergies, de fourrages, érosion des sols, pollution de l’air et de l’eau.
Ces parcs nationaux sont de plus une attraction pour les touristes du monde entier et non pas l’idée d’une terre qui retournerait à l’état sauvage pour sauver la planète. Ainsi, personne ne voit vraiment de problème à faire des milliers de km en voitures pour aller dans des parcs nationaux. L’Inde profite donc simultanément des bénéfices matériels d’une économie qui se développe et des avantages esthétiques d’une nature vierge, sans compter sur sa population qui souffre de divers maux. L’écologie dite profonde cohabite donc avec la société de consommation sans vraiment remettre en cause ses fondements écologiques et sociopolitiques.
C’est donc bien une erreur de voir une équivalence entre protection de l’environnement et protection de la wilderness ou nature sauvage. Au regard de ce que l’on pourrait qualifier de néo-colonialisme dans cette volonté de rattacher l’écologie profonde avec les sagesses orientales, il convient de rappeler que ce besoin de trouver une filiation authentique à l’écologie profonde ne s’embarrasse pas des nuances entre les variantes de ces traditions qu’elles soient entre hindouisme, bouddhisme, taoïsme ou pire selon les peuples premiers, reprenant le mythe rousseauiste du bon sauvage, totalement fictionnel.
Ce profond mépris de la réalité historique ne s’embarrasse pas non plus des réalités de la vie des ascètes à l’image de Lao Tseu qui ne pouvaient se consacrer à leurs réflexions que parce qu’ils étaient entretenus par une société de cultivateurs dont les relations avec la nature étaient actives. Cette vision de l’Orient se définit comme une « essence » uniquement spirituelle et non rationnelle, laissant ce privilège aux occidentaux. L’orient sert finalement de véhicules aux projections occidentales.
Dans la même logique, il a été proposé par les pays des BRICKS de faire payer une dette aux pays fortement industrialisés ; lors de la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre-Mère. Si le but était de rédiger une déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, l’initiative d’Evo Morales (dirigeant syndical et président bolivien, depuis 2006, ascendance amérindienne) et avec Hugo Chávez ainsi que deux viceprésidents, celui de Cuba et celui du Burundi et des représentants officiels des quarante-sept États signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) – Brice Lalonde pour la France – soit 147 nationalités présentes. La Déclaration finale est la suivante :
« Les entreprises et les gouvernements des pays dits « les plus développés », avec la complicité d’une partie de la communauté scientifique, réduisent la question du changement climatique à une élévation de la température sans en aborder la cause, qui est le système capitaliste. Nous sommes confrontés à la crise ultime du modèle de civilisation patriarcal fondé sur la soumission et la destruction des êtres humains et de la nature qui se sont accélérées avec la révolution industrielle. »
Ainsi l’idée qui en a résulté est celle d’une dette climatique et de sommes d’argents que les pays dits « développés » devraient s’acquitter d’une justice réparatrice fiduciaire et surtout financière. Et cela sans compter sur la paupérisation croissante que cela entrainerait sur les populations de ces pays dit « développés ». En effet, un récent mouvement de jeunes américains ont dénoncés cet état de fait selon lequel seul 1% de plus riches au monde –pays développés et pays en voie de développement) s’accaparaient 82% des richesses créées notamment en 2017.[1]
Cette Conférence a donc répondu au problème du capitalisme par du capitalisme ; en effet, selon un article de Michael Löwy[2], le principal problème de l’écologie, c’est ce capitalisme non raisonné produisant plus que nécessaire comme on l’a vu avec l’exemple des ouvrières textiles indiennes, qui en plus d’être peu rémunérées et de travailler dans des conditions spartiates voire dangereuses et mortelles, fabriquent des vêtements dont certains finiront à la poubelle. De surcroit, le plus grand danger pour la Terre demeure celui de la course aux armements dans la perspective d’une destruction totale par l’arme nucléaire.
Aucun de ces problèmes ne se retrouvent dans la Conférence en question, et encore moins dans la différence entre anthropocentrisme et biocentrisme pointée du doigt par les partisans de l’écologie profonde. Quelles réponses trouver dans ce cas à la crise écologique ? Certains ont pu proposer l’intervention de scientifiques : Daniel Janzen, biologiste américain de renom a pu appeler à la création de réserves couvrant une large partie du globe dont il assurerait la gestion avec ses collègues scientifiques. : il défend l’idée que seuls les biologistes disposent des compétences nécessaires pour décider de la manière dont les terres tropicales doivent être gérées « Porte-parole du monde naturel » à les seuls à avoir l’expertise et l’autorité nécessaire pour décider.
A ce projet, force est de répondre que les OGM de Monsanto, accusés de nos jours de multiples cancers et d’extinction de certaines espèces d’insectes, a été élaboré par des scientifiques eux-mêmes, autorisant leur mise sur les marchés sans que ces derniers aient été testés sur des populations de vivants. A ces catastrophes, certains anonymes et néophytes ont pu finalement apporter des solutions viables.
L’exemple le plus fameux est celui d’Erin Brockovich, alors adjointe juridique dans un cabinet d’avocat. Après enquête, elle découvre que la pollution par le chrome hexavalent dans les eaux potables a pu entraîner diverses maladies chez les habitants des villes concernées. Instruisant le dossier, elle leur obtient un dédommagement de 333 millions de dollars de la société incriminée, la Pacific Gas ans Electric Company.
Ces « chercheurs de plein air se sont multipliés ces dernières années, à l’instar de Maria Godoy, alertant les autorités compétentes sur le dangers des pesticides en Argentine[3], qui démontrent que le problème principal de la crise écologique tient à l’exercice politique lui-même, consistant à inventer collectivement des propositions solides et cohérentes, qui doivent passer par l’émergence de conflits et la construction de rapports de force. La Conférence de Copenhague sur le climat de 2009 ne contient d’ailleurs aucun accord de réduction contraignant des gaz à effet de serre, aucune obligation pour les pays participant de le rallier non plus…
L’avenir du textile écologique semble difficile à envisager sans grandes décisions politiques. Néanmoins, certains grands groupes commencent à y apporter leur contribution, à l’instar du groupe de luxe Kering qui a contracté un partenariat en 2015 avec la société Worn Again, réutilisant les vêtements usés en séparant les fibres pour composer de nouveaux textiles. La marque japonaise de fast fashion Uniqlo quant à elle récupère les vêtements usagés afin de créer de la matière isolante.
Tous s’y mettent, mais à l’exemple d’h&m, si le sujet a convaincue l’opinion, il n’en va pas de même pour la pratique. Néanmoins, les rencontres en la matière ne cessent de se multiplier : le plus important étant le sommet de la mode de Copenhague, le forum Anti_Fashion organisées à Marseille, le Global Fashion Agenda, la semaine du développement durable en France (…)
Après des années de surconsommation en matière de textile, une conciliation s’avère possible entre mode et désir de renouvellement perpétuel à travers l’éducation du consommateur à l’achat de pièces plus chères et plus durable : Erwan Autret, ingénieur de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie auprès de l’Ademe indique que le prix reste le critère essentiel lors de l’achat. En achetant plus cher des vêtements durables, est l’un des enjeux essentiels de l’industrie textile. Une fois encore, sans législation en la matière interdisant la production de pièces dont l’obsolescence est calculée pour que la pièce dure peu, cela s’avère difficilement envisageable.
Devant des logiques de rentabilités surpuissantes contrôlant la production au sein des grands groupes, l’issue demeure dans la réutilisation de ces matériaux si vite jeté à la poubelle, dans l’utilisation de matières recyclées ou de vêtements réutilisés, à la conception et production moins polluantes. Et dans ces initiatives à petite ou grande échelle comme la marque franco-brésilienne Veja, créée en 2004, fabriquant des chaussures et des maillots de bains à partir de plastique recyclé main dans la main avec l’association Surfrider Foundation (organisme luttant pour la protection des mers, océans, rivières et littoraux).
Certaines institutions publiques s’impliquent également à l’image du Victoria and Albert Museum de Londres qui accueille en ce moment même l’exposition Fashioned from Nature prenant pour thème les relations entre la mode et la Nature, présentant des pièces issues de fabrication éco-responsable, comme la robe Calvin Klein d’Emma Watson au Met Ball en 2016.
Ce à quoi il faut ajouter la participation de Vivienne Westwood, particulièrement engagée sur ce sujet, qui déclarait en marge de sa collection automne-hiver 2013 que « La lutte n’est plus entre classes, ni entre riches et pauvres, mais entre les idiots et les éco-conscients. », ce à quoi on lui rétorquerait volontiers que la lutte pour l’environnement est nécessairement et pour les raisons explicitées plus haut, une nouvelle forme de la lutte des classes ou les populations les plus pauvres souffrent d’affections liées aux pesticides utilisés pour produire plus, ou encore de l’exclusion de leurs lieux de vie, quand le travail des enfants n’est pas de retour (…)
[1] https://www.latribune.fr/economie/les-1-les-plus-fortunes-ont-accapare-82-des-richesses-creees-l-an-dernier-765516.html Rapport issu de l’ONG Oxfam.
[2] https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2008-2-page-68.htm
[3] https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/la-revolte-argentine-contre-monsanto
The question that one is then entitled to ask is whether, like the « good savage » in Rousseau was a myth, the wild and wild nature still exists? Are we not there in a form of nineteenth century eugenics that wanted to restore purity to man, by avoiding cross-species « human cross-species », when we claim the right to render areas degraded by man, from nature, to their original purity (wilderness)?
This philosophy, which likes to present itself as a universalist, calls for a large part of the globe to be immediately rendered inaccessible to human beings. The poet Gary Snyder himself advocated for a 90% reduction in the human population to allow the environment to return to its original condition. This preservationism appears radical, considering that a reduction of the world population engendered. We remember the policy of the only child in China from 1979 to 2015, and « black children » or undocumented, deprived of rights and citizen existence (no education, unable to work …) but also the forced sterilizations and abortions by force.
In this regard, the supporters of deep ecology generally evoke Eastern philosophies whose traditions, contrary to Western traditions and mainly Christian, are precursors of the deep ecology and much closer to nature than were the Westerners. This association between Eastern (ancient) and ecological (modern) wisdom would seem to even validate the universal scope of deep ecology. However, the importance given to wilderness is truly harmful when applied to the Third World, or even the poorest people in general.
In India, for example, natural reserves through the « tiger project », which are regarded as internationally remarkable by the international community, are more likely to be favored by animals than by the poorest populations. For example, it was possible to relocate existing villages and return to the nomadic state certain village populations which, in addition, were already suffering from water scarcity, energy, fodder, soil erosion, air pollution and pollution. water.
These national parks are moreover an attraction for tourists from all over the world and not the idea of a land that would return to the wild to save the planet. So, no one really sees any problem in driving thousands of miles to national parks. At the same time, India is enjoying the material benefits of a growing economy and the aesthetic benefits of pristine nature, not to mention its population, which suffers from various ills. So-called deep ecology coexists with the consumer society without really calling into question its ecological and socio-political foundations.
It is therefore a mistake to see an equivalence between environmental protection and protection of wilderness or wilderness. In view of what might be called neo-colonialism in this desire to link deep ecology with Eastern wisdom, it should be remembered that this need to find an authentic connection to deep ecology does not bother nuances between the variants of these traditions whether they be between Hinduism, Buddhism, Taoism or worse according to the first peoples, taking up the Rousseau myth of the good savage, totally fictional.
This profound contempt for the historical reality is not bothered either by the realities of the life of the ascetics like Lao Tzu who could not devote themselves to their reflections only because they were maintained by a society of cultivators whose relationships with nature were active. This vision of the Orient is defined as an « essence » only spiritual and not rational, leaving this privilege to Westerners. The east finally serves as vehicles for Western projections.
In the same vein, it has been proposed by the BRICKS countries to pay a debt to highly industrialized countries; at the World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth. If the goal was to draft a universal declaration of the rights of Mother Earth, the initiative of Evo Morales (trade union leader and Bolivian president, since 2006, Amerindian ancestry) and with Hugo Chávez and two vice-presidents, that of Cuba and that of Burundi and the official representatives of the forty-seven signatory states of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Brice Lalonde for France – 147 nationalities present. The final declaration is as follows:
« The companies and governments of the so-called » most developed countries « , with the complicity of a part of the scientific community, reduce the issue of climate change to a rise in temperature without addressing the cause, which is the capitalist system . We are confronted with the ultimate crisis of the model of patriarchal civilization based on the submission and destruction of human beings and nature that have accelerated with the industrial revolution. «
Thus the idea that resulted is that of a climate debt and sums of money that the so-called « developed » countries should fulfill a fiduciary and especially financial restorative justice. And this without counting on the growing impoverishment that this would cause on the populations of these so-called « developed » countries. Indeed, a recent movement of young Americans have denounced this state of affairs according to which only 1% of the richest in the world – developed countries and developing countries – captured 82% of the wealth created especially in 2017. [1]
This Conference has thus responded to the problem of capitalism by capitalism; in fact, according to an article by Michael Löwy [2], the main problem of ecology is that unseasoned capitalism producing more than necessary, as we have seen with the example of Indian textile workers, who in addition to be poorly paid and to work in Spartan, even dangerous and deadly conditions, make clothes some of which will end up in the trash. In addition, the greatest danger to the Earth remains that of the arms race in the perspective of total destruction by nuclear weapons.
None of these problems can be found in the Conference in question, and even less in the difference between anthropocentrism and biocentrism pointed out by proponents of deep ecology. What answers in this case to the ecological crisis? Some have been able to propose the intervention of scientists: Daniel Janzen, renowned American biologist could call to the creation of reserves covering a large part of the globe which he would manage with his scientific colleagues. He argues that only biologists have the skills to decide how tropical lands should be managed as the « spokesman of the natural world » to the only ones with the expertise and authority to decide.
To this project, it must be said that Monsanto’s GMOs, nowadays accused of multiple cancers and the extinction of certain species of insects, have been developed by scientists themselves, allowing them to be placed on the market without these have been tested on living populations. In these disasters, some anonymous and neophytes were finally able to bring viable solutions.
The most famous example is that of Erin Brockovich, then a legal assistant in a law firm. After investigation, she discovered that the pollution by hexavalent chromium in drinking water could cause various diseases among the inhabitants of the cities concerned. On filing the case, she obtained compensation of $ 333 million from the offending company, the Pacific Gas Electric Company.
These « outdoor researchers have multiplied in recent years, like Maria Godoy, alerting the competent authorities on the dangers of pesticides in Argentina [3], which demonstrate that the main problem of the ecological crisis lies in the political exercise itself, consisting in collectively inventing solid and coherent proposals, which must go through the emergence of conflicts and the construction of power relations. The 2009 Copenhagen Climate Conference contains no binding greenhouse gas reduction agreement, nor does it require the participating countries to join it either …
The future of ecological textiles seems difficult to envisage without major political decisions. Nevertheless, some large groups are beginning to make their contribution, like the luxury group Kering, which entered into a partnership with Worn Again in 2015, recycling used clothing by separating the fibers to make new textiles. The Japanese fast fashion brand Uniqlo is recovering used clothing to create insulating material.
All of them do it, but like H & M, if the subject has convinced the opinion, it is not the same for the practice. Nevertheless, the meetings on the subject are constantly increasing: the most important being the summit of fashion in Copenhagen, the forum Anti_Fashion organized in Marseille, the Global Fashion Agenda, the week of sustainable development in France (…)
After years of overconsumption in textile, a conciliation is possible between fashion and desire for perpetual renewal through the education of the consumer to the purchase of more expensive and more durable parts: Erwan Autret, engineer of the Agency of the environment and energy management at the Ademe indicates that the price remains the essential criterion during the purchase. By buying more expensive durable clothing, is one of the key issues of the textile industry. Once again, without legislation prohibiting the production of parts whose obsolescence is calculated so that the piece lasts little, this proves difficult to envisage.
In the face of extremely powerful profitability regimes controlling production within large groups, the outcome remains in the reuse of these materials so quickly thrown in the trash, in the use of recycled materials or reused garments, the design and production less polluting. And in these small-scale and large-scale initiatives, such as the French-Brazilian brand Veja, created in 2004, manufacturing footwear and swimwear from recycled plastic, hand-in-hand with the Surfrider Foundation (an organization fighting for protection). seas, oceans, rivers and coasts).
Some public institutions are also involved in the image of the Victoria and Albert Museum in London, which is currently hosting the Fashioned from Nature exhibition on the theme of the relationship between fashion and nature, featuring pieces from the world of fashion. responsible, like Emma Watson’s Calvin Klein dress at Met Ball in 2016.
To which must be added the participation of Vivienne Westwood, particularly committed to this subject, who stated on the sidelines of her fall-winter 2013 collection that « The struggle is no longer between classes, nor between rich and poor, but between idiots. and the eco-conscious. To which it would be argued that the fight for the environment is necessarily and for the reasons explained above, a new form of class struggle or the poorest people suffer from diseases related to pesticides used to produce more, or the exclusion of their places of life, when child labor is not back (…)
[1] https://www.latribune.fr/economie/les-1-les-fest-fortunes-accapare-82-funded-funding-the-an-last-765516.html Report from the NGO Oxfam.
[2] https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2008-2-page-68.htm
[3] https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-de-la-redaction/argentine-revolution-contre-monsanto

Atelier familial en Chine. Le garçon sur la photo, dans le village de Dadun, à Xintang, gagne 0,15 yuan (1,5 centime) pour couper les fils qui dépassent d’un blue jeans. En une journée, près de 200 paires passent entre ses mains. Photos : Qiu Bo/Greenpeace
![]() Family workshop in China. The boy in the photo, in Dadun Village, Xintang, earns 0.15 yuan (1.5 cents) to cut the threads of a blue jeans. In one day, nearly 200 pairs pass in his hands. Photos: Qiu Bo / Greenpeace
Family workshop in China. The boy in the photo, in Dadun Village, Xintang, earns 0.15 yuan (1.5 cents) to cut the threads of a blue jeans. In one day, nearly 200 pairs pass in his hands. Photos: Qiu Bo / Greenpeace
Papiers
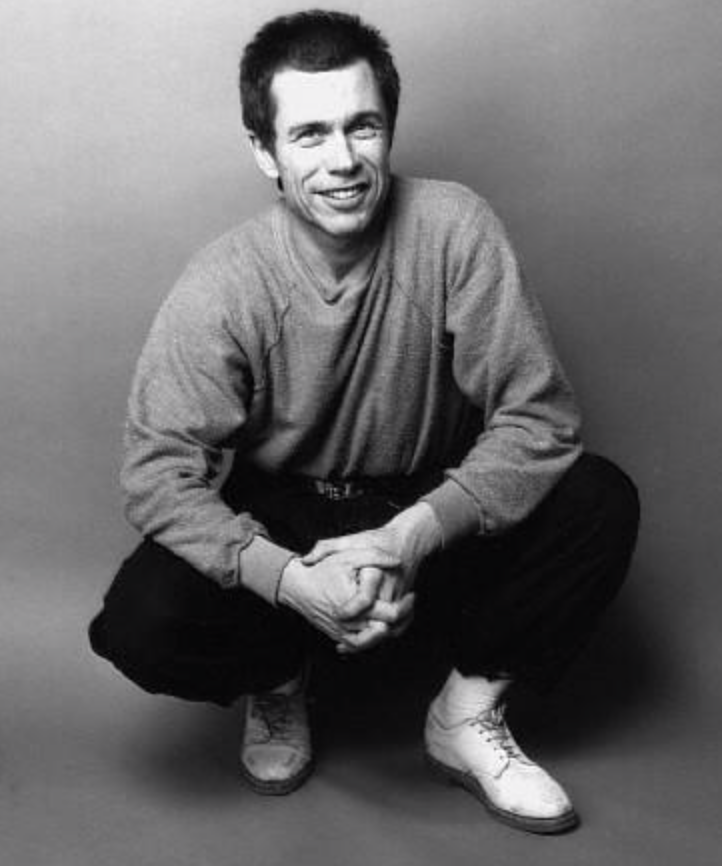
« Égoïste.
Où es-tu ?
Montre-toi misérable !
Prends garde à mon courroux, je serai implacable.
Ô rage !
Ô désespoir !
Ô mon amour trahi !
N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Montre-toi, égoïste ! »
« Selfish.
Where are you ?
Show yourself miserable!
Beware of my wrath, I will be relentless.
Thunderstorm !
O despair!
O my betrayed love!
Have I therefore lived so much only for this infamy?
Show yourself, selfish! «
![]() Would you really want Adblock to deprive you of that ?
Would you really want Adblock to deprive you of that ?
Well, usually publicity is considered annoying. But some of them have marked our minds and culture. If Art often inspires advertising, raising advertising to the rank of Art would be unwelcome today as its place has been growing with the advent of the Internet at the same time invasive and intolerable. Indeed, many software allow us to get rid of it for a time, until we come across content praising us its merits, allowing to pay authors and therefore to support a certain number of web workers.
Voudriez-vous vraiment qu’Adblock vous prive de ça ?
Généralement la publicité est considérée comme étant particulièrement pénible. Si l’Art inspire souvent la publicité, hisser la publicité au rang de l’Art serait malvenu tant sa place a été grandissante avec l’avènement de la sphère internet et tout à la fois envahissante et intolérable. En effet, nombre de logiciels très prisés nous permettent de nous en débarrasser pour un temps, jusqu’à ce que l’on tombe sur un contenu nous vantant ses mérites, à savoir rémunérer les auteurs et donc faire vivre un certain nombre de travailleurs du web.
© Jean-Paul Goude x Corbis image
© Jean-Paul Goude x Chanel




![]() Back to the add spot. Very theatrical, this advertising spot was filmed in Rio de Janeiro. This publicity required the construction of a reproduction of the Carlton hotel in Cannes in a Brazilian desert, and a production team as large as for the shooting of a movie. Of course, only the facade of the hotel has been reproduced. Jean-Paul Goude, the director, called Michel Rose in collaboration with Yves Bernard, both set designers also known for advertising for other brands like Dim (French lingerie). Three hundred workers were mobilized for the construction of this facade of the stucco palace and those, for almost four weeks.
Back to the add spot. Very theatrical, this advertising spot was filmed in Rio de Janeiro. This publicity required the construction of a reproduction of the Carlton hotel in Cannes in a Brazilian desert, and a production team as large as for the shooting of a movie. Of course, only the facade of the hotel has been reproduced. Jean-Paul Goude, the director, called Michel Rose in collaboration with Yves Bernard, both set designers also known for advertising for other brands like Dim (French lingerie). Three hundred workers were mobilized for the construction of this facade of the stucco palace and those, for almost four weeks.
Le spot de pub présenté ici est d’un genre très rare : très théâtral, presque cinématographique, ce spot a été tourné à Rio de Janeiro. Cette publicité a nécessité la construction d’une reproduction de l’hotel Carlton de Cannes dans un désert du Brésil, et une équipe de production aussi importante que pour le tournage d’un film. Bien entendu, seule la façade de l’hotel a été reproduite. Jean-Paul Goude, le réalisateur, a fait appel à Michel Rose en collaboration avec Yves Bernard, tous deux scénographes, aussi connu (pour le dernier) pour les publicités pour d’autres marques à l’instar de Dim. Trois cents ouvriers ont été mobilisés pour la construction de cette façade du palace en stuc et ceux, pendant près de quatre semaines.

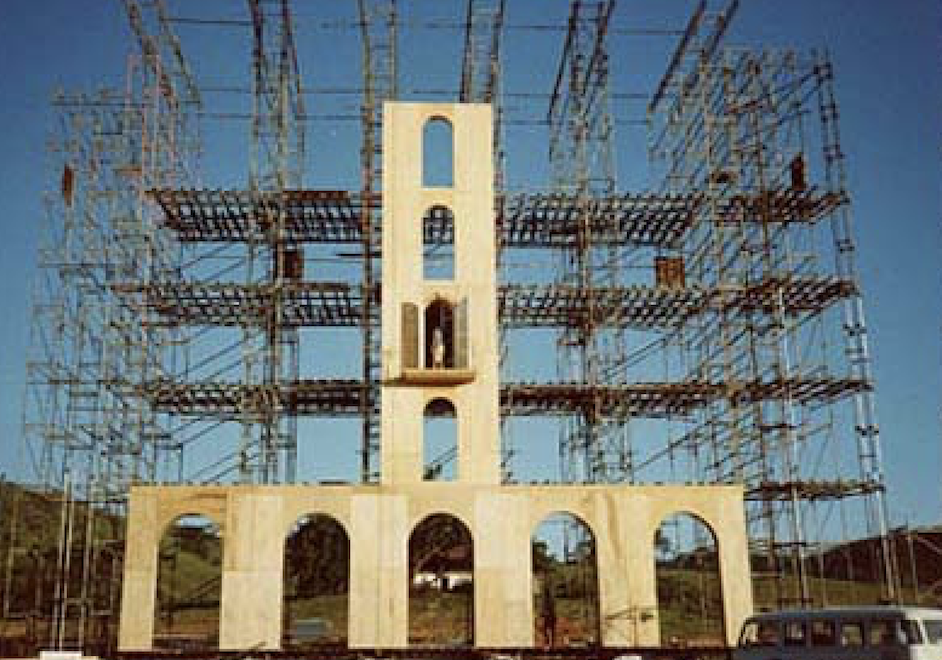


![]() The chosen music – very dramatic – is an extract from « Romeo and Juliet », ballet for symphonic orchestra by Russian composer Sergei Prokofiev (1935). The song in question is called « The Dance of the Knights » (Act 1, scene 13). The text is a very elaborate pastiche of the tragic « Cid » by Corneille, the original of which is as follows (Act 1, Scene 4): « Thunderstorm ! Oh despair! Oh enemy old age! Have I lived so long only for this infamy? respect all Spain admires, My arm, which so many times saved this empire, So many times strengthened the throne of its king, Betray therefore my quarrel, and does nothing for me? «
The chosen music – very dramatic – is an extract from « Romeo and Juliet », ballet for symphonic orchestra by Russian composer Sergei Prokofiev (1935). The song in question is called « The Dance of the Knights » (Act 1, scene 13). The text is a very elaborate pastiche of the tragic « Cid » by Corneille, the original of which is as follows (Act 1, Scene 4): « Thunderstorm ! Oh despair! Oh enemy old age! Have I lived so long only for this infamy? respect all Spain admires, My arm, which so many times saved this empire, So many times strengthened the throne of its king, Betray therefore my quarrel, and does nothing for me? «
La musique choisie – très dramatique – est un extrait de « Roméo et Juliette », ballet pour orchestre symphonique du compositeur russe Sergei Prokofiev (1935). Le morceau en question s’intitule « La Danse des chevaliers » (Acte 1, scène 13). Le texte est un pastiche très élaboré du tragique « Cid » de Corneille dont l’original est le suivant (Acte 1, Scène 4) : « O rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Mon bras qu’avec respect tout l’Espagne admire, Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, Tant de fois affermi le trône de son roi, Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ? »Ô mon amour trahi ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Montre-toi, égoïste ! »
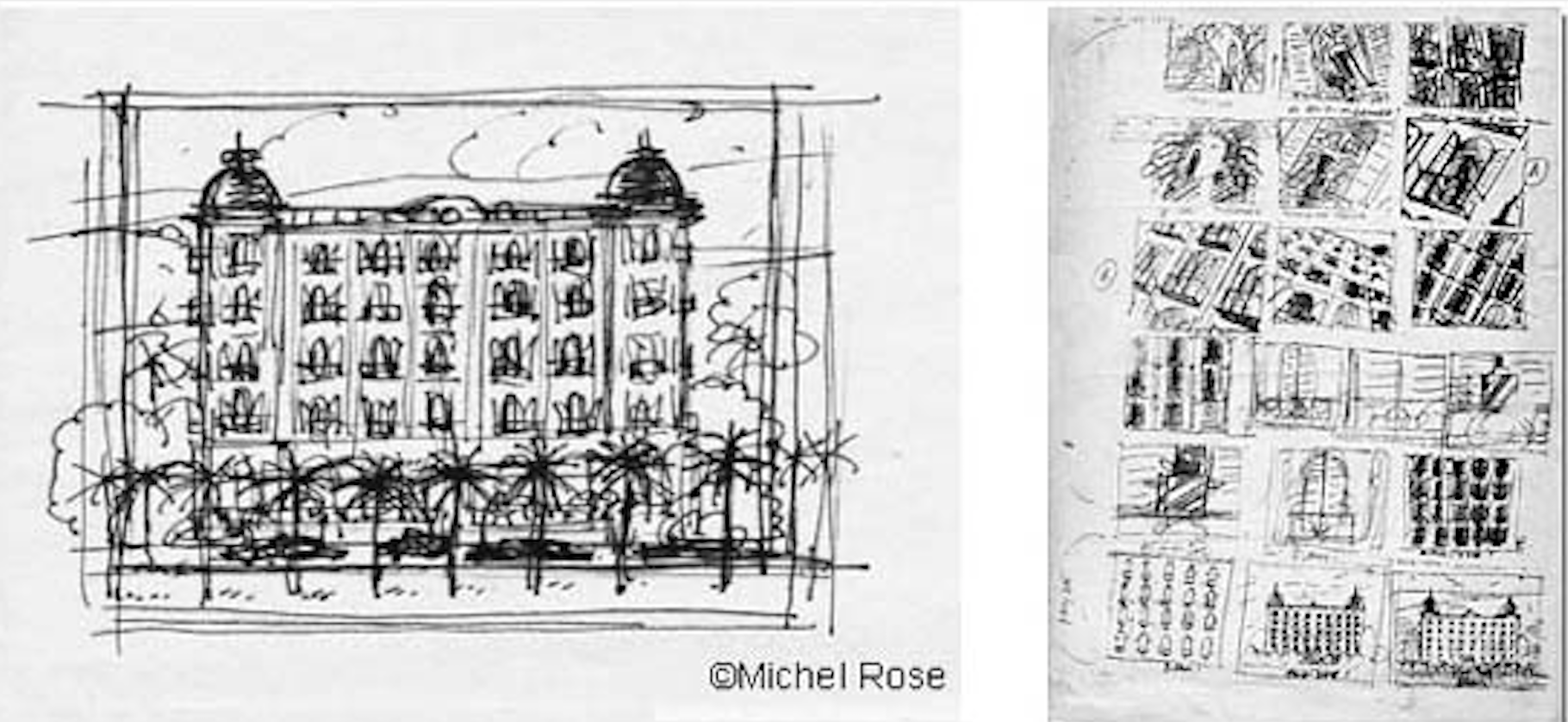
![]() Jean-Paul Goude was inspired by a news item for this spot, he says : « If the film is successful, it is probably because it is inspired by a personal project, in this case a 52-minute musical film intended for a television channel inspired by Farida, my partner at the time, who had written an extraordinary poem entitled « The Woman with the Nose Cut », the project chronicled a particularly dramatic news item which she had witnessed when she was still living at Les Minguettes in Lyon: a drunken and jealous macho had cut the nose of his beloved wife to punish her for her infidelity. Immigrants North Africans women, witnesses of the tragedy, insulted the criminal while slamming the shutters to the rhythm of the ambient music. The TV project of Farida unfortunately died quickly. I resuscitated it for Egoïste by replacing our Maghrebians with a cohort of angry top-models leaning on the balconies of a palace of La Riviera to denounce male selfishness. The film was shot 10 kilometers from Rio, in the open countryside, in a fully reconstructed cinema setting like the Carlton in Cannes. No question at the time of computer effects, so very little postproduction. As such, Egoïste undoubtedly remains the last advertising film of an era and my favorite short film « . (1)
Jean-Paul Goude was inspired by a news item for this spot, he says : « If the film is successful, it is probably because it is inspired by a personal project, in this case a 52-minute musical film intended for a television channel inspired by Farida, my partner at the time, who had written an extraordinary poem entitled « The Woman with the Nose Cut », the project chronicled a particularly dramatic news item which she had witnessed when she was still living at Les Minguettes in Lyon: a drunken and jealous macho had cut the nose of his beloved wife to punish her for her infidelity. Immigrants North Africans women, witnesses of the tragedy, insulted the criminal while slamming the shutters to the rhythm of the ambient music. The TV project of Farida unfortunately died quickly. I resuscitated it for Egoïste by replacing our Maghrebians with a cohort of angry top-models leaning on the balconies of a palace of La Riviera to denounce male selfishness. The film was shot 10 kilometers from Rio, in the open countryside, in a fully reconstructed cinema setting like the Carlton in Cannes. No question at the time of computer effects, so very little postproduction. As such, Egoïste undoubtedly remains the last advertising film of an era and my favorite short film « . (1)
Above and below, Goude’s sketches for the advertising spot
(1) https://www.lepoint.fr/musique/egoiste-la-claque-publicitaire-de-prokofiev-23-08-2022-2487016_38.php
Jean-Paul Goude s’est inspiré d’un fait divers, il se confiait ainsi à son propos : « Si le film est réussi, c’est probablement parce qu’il s’inspire d’un projet personnel, en l’occurrence un film musical de 52 minutes destiné à une chaîne de télévision. Inspiré par Farida, ma compagne à l’époque, qui avait écrit un poème extraordinaire intitulé « La Femme au nez coupé », le projet chroniquait un fait divers particulièrement dramatique dont elle avait été le témoin lorsqu’elle habitait encore aux Minguettes à Lyon : un macho ivre de jalousie avait coupé le nez de sa femme bien-aimée pour la punir de son infidélité. Penchées aux fenêtres de leur HLM, des ménagères d’origine maghrébines, témoins de la tragédie, insultaient le criminel tout en claquant les volets sur le rythme de la musique ambiante. Le projet TV de Farida étant malheureusement mort aussi vite que je l’avais présenté, je l’ai ressuscité pour Egoïste en substituant nos Maghrébines à une cohorte de top-modèles en colère penchés aux balcons d’un palace de La Riviera pour dénoncer l’égoïsme masculin. Le film fut tourné à 10 kilomètres de Rio, en rase campagne, dans un décor de cinéma entièrement reconstitué à l’image du Carlton de Cannes. Pas question à l’époque de trucages sur ordinateur, donc très peu de postproduction. A ce titre, Egoïste reste sans doute le dernier film publicitaire d’une époque et mon bref-métrage préféré ». (1)
Ci-dessus et dessous, les croquis de Goude pour le spot publicitaire
(1) https://www.lepoint.fr/musique/egoiste-la-claque-publicitaire-de-prokofiev-23-08-2022-2487016_38.php
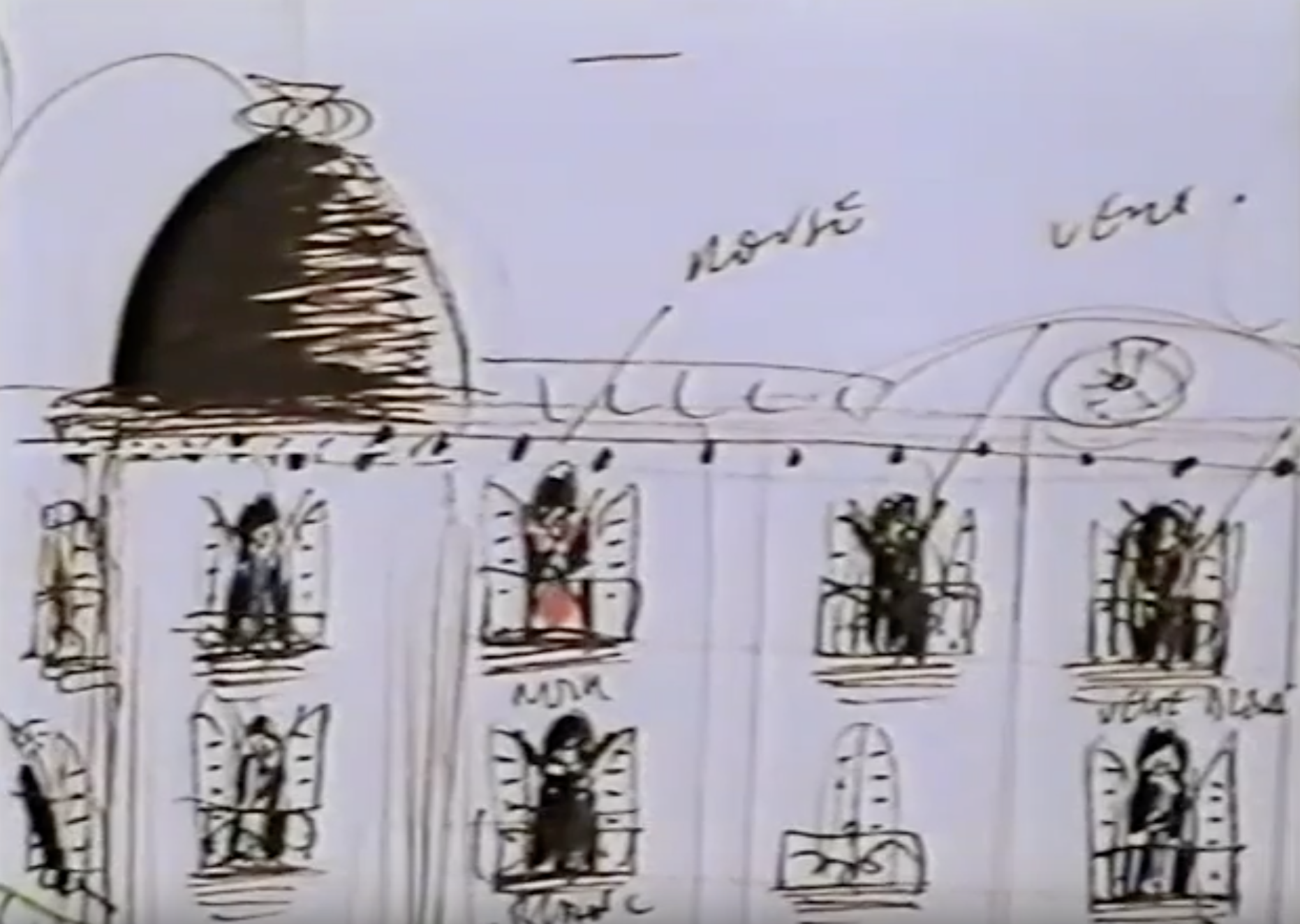
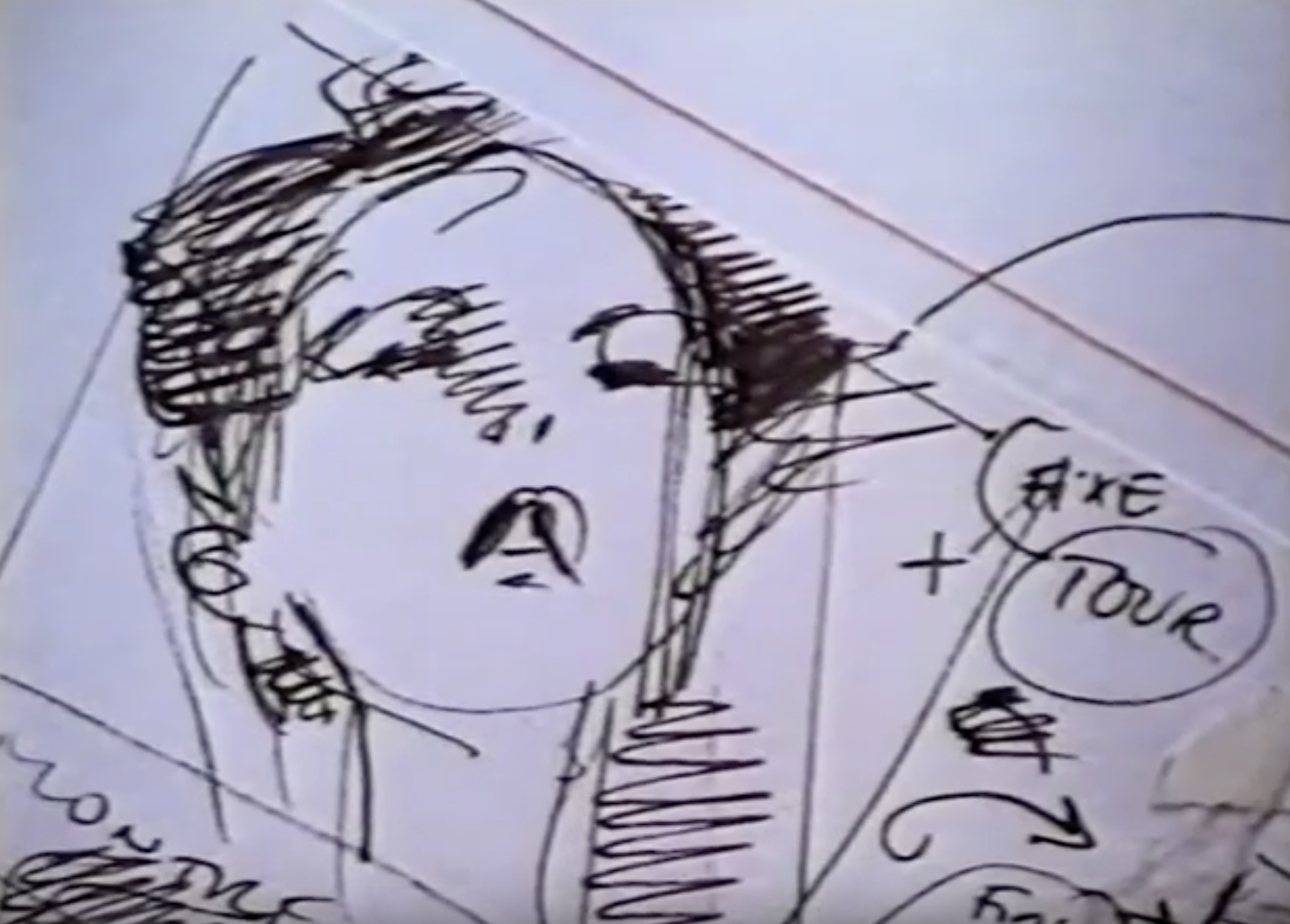

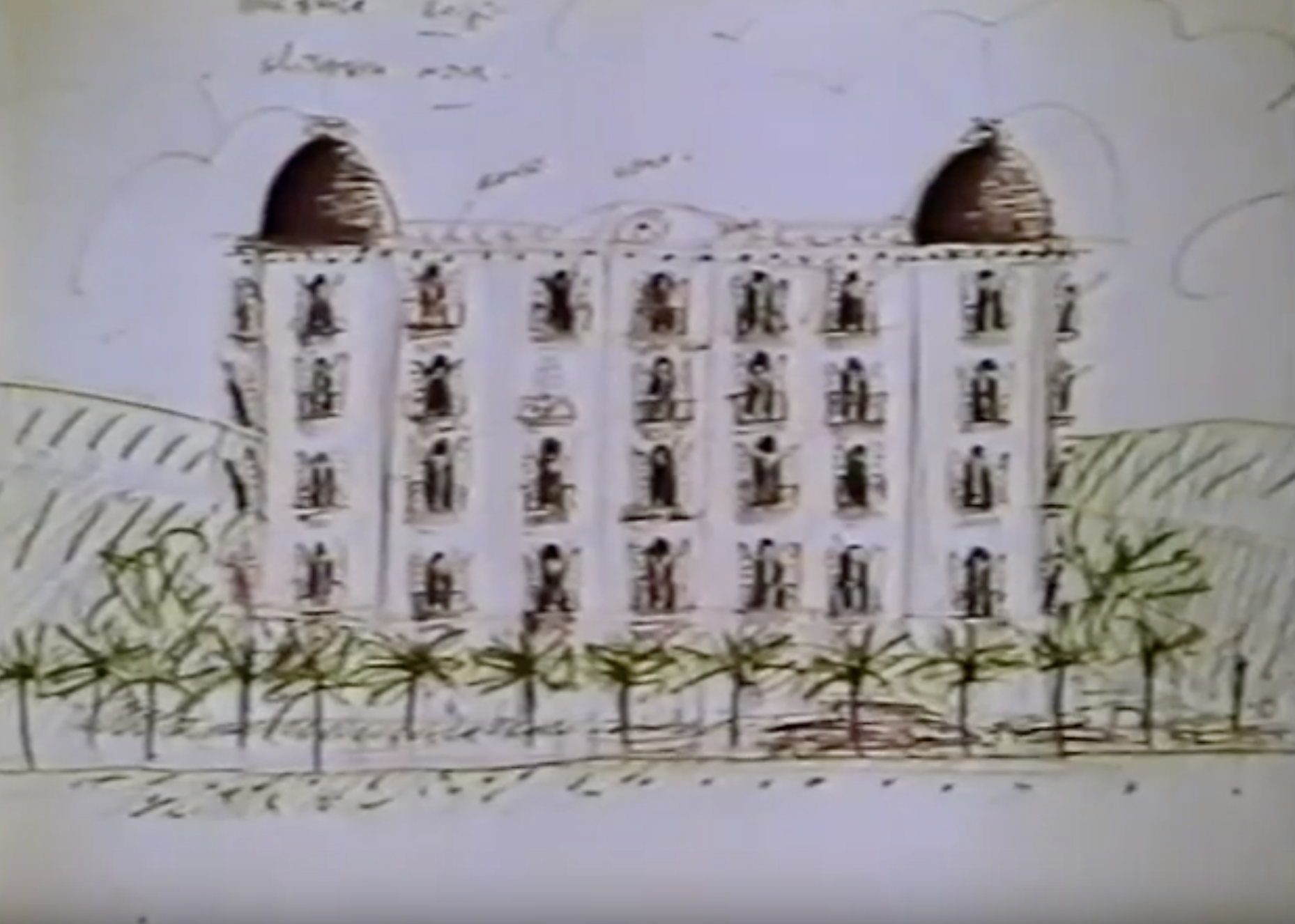
![]() A chilling fact in the yardstick of this advertising spot for which Jean-Paul Goude obtained a Golden Lion in Cannes during the international advertising festival in 1990 after which he went on to produce for the perfume Coco (Chanel) another spot just as remarkable, with Vanessa Paradis. A captivating storytelling, a surprising scenography, a creation of titanic decorations, a masterful soundtrack, an eminently pastiche text, so many artistic artifices which take us away from the venality of a simple advertisement to fill the imagination with an aesthetic delight which touches all senses, and lastly that of smell which it delays the spectator to test, to feel after feeling this much.
A chilling fact in the yardstick of this advertising spot for which Jean-Paul Goude obtained a Golden Lion in Cannes during the international advertising festival in 1990 after which he went on to produce for the perfume Coco (Chanel) another spot just as remarkable, with Vanessa Paradis. A captivating storytelling, a surprising scenography, a creation of titanic decorations, a masterful soundtrack, an eminently pastiche text, so many artistic artifices which take us away from the venality of a simple advertisement to fill the imagination with an aesthetic delight which touches all senses, and lastly that of smell which it delays the spectator to test, to feel after feeling this much.
Un fait divers glaçant donc à l’aune de ce spot publicitaire pour lequel Jean-Paul Goude obtint un Lion d’or à Cannes lors du festival international de la publicité en 1990 après lequel, il va réaliser pour le parfum Coco (Chanel) un autre spot tout aussi remarquable, avec Vanessa Paradis. Un storytelling captivant, une scénographie surprenante, une création de décors titanesque, une bande son magistrale, un texte éminemment pastiché, autant d’artifices artistiques qui nous éloignent de la vénalité d’une simple publicité pour emplir les imaginaires d’un ravissement esthétique qui touche tous les sens, et en dernier lieu celui de l’odorat qu’il tarde le spectateur de tester, de sentir après avoir autant ressenti.




![]() So why can’t we consider it as a work of art? Art, even in the 20th century, is still highly codified. And one of these codes is very strict: art must be disinterested. It was Emmanuel Kant – German philosopher – who told us this in the 18th century. According to Kant « beauty is the object of selfless and free satisfaction ». (2) What is beautiful in itself has its own end. To be more clear, this passage from The Condition of Modern Man by Hannah Arendt can enlighten minds quick to see art everywhere around them: « Among the objects that give human artifice the stability without which men would find no homeland there, there are some which have absolutely no use and which moreover, because they are unique, are not exchangeable and therefore challenge equalization by means of a common denominator such as money; if you put them on the market you can only set their prices arbitrarily. What is more, the relationship we have with a work of art certainly does not consist in « using it »; on the contrary, to find its proper place in the world, the work of art must be carefully removed from the context of everyday objects. It must also be removed from the needs and demands of daily life, with which it has as little contact as possible. »
So why can’t we consider it as a work of art? Art, even in the 20th century, is still highly codified. And one of these codes is very strict: art must be disinterested. It was Emmanuel Kant – German philosopher – who told us this in the 18th century. According to Kant « beauty is the object of selfless and free satisfaction ». (2) What is beautiful in itself has its own end. To be more clear, this passage from The Condition of Modern Man by Hannah Arendt can enlighten minds quick to see art everywhere around them: « Among the objects that give human artifice the stability without which men would find no homeland there, there are some which have absolutely no use and which moreover, because they are unique, are not exchangeable and therefore challenge equalization by means of a common denominator such as money; if you put them on the market you can only set their prices arbitrarily. What is more, the relationship we have with a work of art certainly does not consist in « using it »; on the contrary, to find its proper place in the world, the work of art must be carefully removed from the context of everyday objects. It must also be removed from the needs and demands of daily life, with which it has as little contact as possible. »
(2) Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger. Vrin, 1993.
(3) Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne. Pocket, 1999.
Alors pourquoi ne peut-on pas le considérer comme une oeuvre d’art ? L’art, même au XXIème siècle est toujours très codifié. Et un de ces codes, est très strict : l’art doit être désintéressé. C’est Emmanuel Kant – philosophe allemand – qui nous le dit dès le XVIIIème siècle. Selon Kant « le beau est l’objet d’une satisfaction désintéressée et libre »(2). Est beau ce qui porte en soi sa propre fin. Pour être plus clair, ce passage de La Condition de l’homme moderne d’Arendt peut éclairer les esprits prompts à voir de l’art partout autour d’eux : « Parmi les objets qui donnent à l’artifice humain la stabilité sans laquelle les hommes n’y trouveraient point de patrie, il y en a qui n’ont strictement aucune utilité et qui en outre, parce qu’ils sont uniques, ne sont pas échangeables et défient par conséquent l’égalisation au moyen d’un dénominateur commun tel que l’argent ; si on les met sur le marché on ne peut fixer leurs prix qu’arbitrairement. Bien plus, les rapports que l’on a avec une œuvre d’art ne consistent certainement pas à « s’en servir » ; au contraire, pour trouver sa place convenable dans le monde, l’œuvre d’art doit être soigneusement écartée du contexte des objets d’usage ordinaires. Elle doit être de même écartée des besoins et des exigences de la vie quotidienne, avec laquelle elle a aussi peu de contacts que possible. »
(2) Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger. Vrin, 1993.
(3) Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne. Pocket, 1999.
![]() All that is produced for money, for marketing, is vile. Money is only a tool for simplifying exchanges, when Art is an absolute, a sacred that one could not demean to something as trivial as exchanges. Money has with it a whole history dating back several millennia of moral condemnation if not a religious or philosophical condemnation with Marx for example for whom money is an alienation. Obviously Art sells, and Art sometimes costs a certain price to be created, designed. However, for the time being, in a world where the last century has seen the advent of a decline in religion in modern societies, Art has taken the place of the sacred and cannot tolerate being described by its mercantile value, its market value. Many works also resist the desire of some to assess the monetary value of a work. And many people continue to refuse these values, speaking of « priceless » works. Finally, of course advertising is annoying and has never been so annoying in History. But it all depends on how you look at it. Untimely and unwanted, it seems unbearable. Otherwise, it speaks of the past, of the present too, of our lifestyles and acts as a mirror of a barely sublimated lifestyle …
All that is produced for money, for marketing, is vile. Money is only a tool for simplifying exchanges, when Art is an absolute, a sacred that one could not demean to something as trivial as exchanges. Money has with it a whole history dating back several millennia of moral condemnation if not a religious or philosophical condemnation with Marx for example for whom money is an alienation. Obviously Art sells, and Art sometimes costs a certain price to be created, designed. However, for the time being, in a world where the last century has seen the advent of a decline in religion in modern societies, Art has taken the place of the sacred and cannot tolerate being described by its mercantile value, its market value. Many works also resist the desire of some to assess the monetary value of a work. And many people continue to refuse these values, speaking of « priceless » works. Finally, of course advertising is annoying and has never been so annoying in History. But it all depends on how you look at it. Untimely and unwanted, it seems unbearable. Otherwise, it speaks of the past, of the present too, of our lifestyles and acts as a mirror of a barely sublimated lifestyle …
Beneath : an other add by Jean-Paul Goude
Tout ce qui est produit pour l’argent, pour la commercialisation, est jugé vil. L’argent n’est qu’un outil de simplification des échanges, quand l’Art est un absolu, un sacré que l’on ne pourrait rabaisser à quelque chose d’aussi trivial que des échanges. L’argent a avec lui toute une histoire vieille de plusieurs millénaires de condamnation morale si ce n’est une condamnation religieuse ou philosophique notamment avec Marx pour qui l’argent est une aliénation. Evidemment l’Art se vend, et l’Art coûte parfois un certain prix à être créé, conçu. Pour autant et pour l’heure, dans un monde où le siècle dernier a vu l’avènement d’un recul du religieux dans les sociétés modernes, l’Art a pris la place du sacré et ne saurait tolérer qu’on le décrive par sa valeur mercantile, sa valeur sur le marché. Nombre d’oeuvres résistent d’ailleurs à cette volonté qu’ont certains d’évaluer la valeur monétaire d’une oeuvre. Et nombre de personnes continuent de refuser ces valeurs, parlant d’oeuvres « inestimables ». Pour finir, bien-sur que la publicité est agaçante et ne l’a jamais autant été dans l’histoire puisqu’elle n’a jamais été aussi présente. Mais tout dépend de la façon dont vous la regardez. Intempestive et non désirée elle apparaît insupportable. Autrement, elle parle du temps passé, du temps présent aussi, de nos modes de vie et fait office de miroir d’un style de vie à peine sublimé…
Au-dessus : un autre spot publicitaire par Jean-Paul Goude
Critiques




Les défilés croisières sont désormais, l’apanage des grandes Maisons. Gucci ne pouvait donc pas échapper à la règle. C’est dans les années 1990 que la marque renoue avec son empreinte originelle à savoir, une mode éclatante voire criarde, mais jamais vulgaire, une accumulation d’influences toutes plus diverses pour une silhouette finalement, au tournant des années 2015-2020, assez pointue, voire intello. Mais se revendiquant d’une intellectualité différente que celle des adeptes des minimalismes d’alors du type de Yamamoto, ou encore d’aujourd’hui, de Margiela & l’Arte povera.
Ce défilé croisière, idéal pour les clientes, permettant de faire le pont entre les sempiternelles collections automne/ hiver & printemps/ été, réuni en quelques passages tout l’ADN de la Maison Gucci : un esprit baroque, second degré, dans une opulence d’artefacts. Après le passage retentissant de Tom Ford dans les 1990, c’est aujourd’hui Alessandro Michele qui se retrouve à la tête de la direction artistique et cela depuis 2015.
Fondée en 1921, la marque Gucci fait toujours tout fabriquer en Italie. A l’origine spécialisée en maroquinerie de luxe, l’ADN de la Maison se développe autour du domaine équestre ; le mors et l’étrier en deviennent l’emblème. Très vite, et dès 1930, la marque se diversifie dans les chaussures, gants, caleçons (…) et survit aux pénuries de matières premières de la période fasciste en diversifiant ses matériaux. C’est à cela que l’on doit le sac « Bamboo », doté d’une anse en bambou et d’un cuir de sanglier.
Les produits Gucci sont des créations qui se veulent intemporelles et éternelles. Gucci tâche saison après saison d’incarner le bon goût, partageant avec Vuitton ou encore Hermès l’univers élitiste de l’équestre. Pour autant, les années Tom Ford ont laissé une empreinte indéniable et célébré une femme sexy avec peu de subtilité et beaucoup de subversion.
Ainsi, la question que tous se pose dorénavant est de savoir si la silhouette proposée par Michele renoue avec cette volonté d’élégance et de raffinement, où est-ce qu’à l’instar d’un Tom Ford Michele fait de sa collection le manifeste d’un certain état des genres sexués ? L’adjectif « pop » issu de « popular », utilisé par le présent designer pour décrire son travail, s’applique-t-il à cette collection ?




Défilant dans la Galerie Palatine, au sein du Palais Pitti, la collection Cruise 2018 d’Alessandro Michele s’inspire de la Renaissance italienne. C’est la première fois qu’un défilé de mode se tient dans ce lieu, qui pour l’occasion recevra plus de 2 millions d’euros de la part de Gucci pour la restauration des jardins, et on ne peut que l’en féliciter au regard de la situation économique de l’Italie actuelle (…)
Cet attrait de la marque pour des lieux emblématiques de la culture ne date pas de ce show : en effet Gucci a déjà collaboré avec le Palais Strozzi à Florence, le Micheng Art Museum de Shanghai, la Chatsworth House en Angleterre et le LACMA à Los Angeles. Rien que l’année dernière, la Maison a révélé sa collection croisière dans le Cloître de l’abbaye de Westminster. Cette volonté de s’ancrer saison après saison dans des lieux emblématiques de la culture ne fait que confirmer ces liens devenant de plus en plus étroit entre l’art et la mode.
Michele, backstage, se livrant sur la collection, confiait que d’après lui, « le tout début de l’esthétique européenne a commencé à Florence », ce à quoi on pourrait bien entendu lui rétorquer que l’art florentin Renaissant tient pour beaucoup à l’époque Hellénistique… De cette vision quelque peu fantasmée de Florence on retiendra qu’il demeure effectivement quelque chose de propre à l’antique, considéré aujourd’hui comme classique des classiques. Mais à oser la comparaison entre la Napa Valley et Florence comme il le fait, nous n’irions sans doute pas jusque-là… On imagine que l’enthousiasme de la création prenant forme l’a sans doute dépassé (…)
“Dans cet endroit ce n’est pas le passé que l’on doit voir, mais plutôt la Napa Valley d’aujourd’hui, et son effervescence créative.” Michele.
Le Palais Pitti où s’est donc tenu le show, a cela de particulier qu’il illustre parfaitement le passage du Moyen Âge à la Renaissance. En effet, au cours du Moyen-âge, les châteaux étaient d’austères bâtisses édifiées pour l’autodéfense d’un territoire ou d’un pays et la protection de la population environnante. Une fois la guerre de cent ans enterrée, on passe, au siècle suivant, au règne des châteaux-palais, moins utilitaires, mais plus esthétiques, dévoilant d’une façon toute autre la richesse et donc la puissance de leurs propriétaires. C’est là que l’on peut voir un parallèle avec ces vêtements conçus non plus pour le confort mais pour l’esthétique pure, l’ornementation, le commentaire sur soi aux autres, au monde.
Retournons au défilé. L’ambition première d’Alessandro Michele était de faire le défilé au Parthénon athénien : « au commencement tout a commencé autour de la Méditerranée, les cultures grecques comme romaines. » Ne pouvant pas avoir Athènes, c’est vers Florence qu’il s’est tourné, la ville où l’argent et le pouvoir étaient réunis. Son style décalé et maximaliste ne pouvait trouver meilleur écrin que le Palais Pitti florentin, où la collection – inspirée de la Renaissance italienne – trouve le ton juste entre broderies, perles et ornementations multiples, et rappels fréquents à la modernité dans laquelle s’inscrit son travail : soit polos WASP, blouson aviateur début de siècle, couleurs blocks, imprimés 1960’s (…)
Au cours de la Renaissance, les vêtements sont souvent en velours ou en soie, matériau noble et coûteux. Les hommes de la haute société portent des collants et des fraises, le baroque donnent le ton au costume. Entre 1625 et 1670, le costume use d’imagination et de virtuosité : absence de mesure, recherche de mouvement, d’opposition, de liberté. Ainsi on évite la froide retenue réformiste et celle de la Contre-Réforme : on puise dans la profusion de détails, dans l’outrance qui ira jusqu’à la préciosité, à l’instar de Michele qui prend le parti de l’abondance.
La symétrie et l’équilibre ne sont plus de mise, ni alors, ni avec Michele, qui entremêle les vestiaires féminin et masculin, use et abuse des couleurs en faisant fît de leurs possibles complémentarités, et n’hésite pas à associer à des matières nobles autres joggings de coton. L’anachronisme fait autorité et suggère une forme de liberté de ton propre au fouillis.
« J’aime la culture populaire, c’est la raison pour laquelle j’apprécie tout particulièrement la Renaissance, qui est à mon sens très pop. « Pop » cela signifie que c’est compris par tous. » Michele.
C’est à cela, au baroque, que la silhouette Gucci doit son éclectisme, riche d’un syncrétisme propre à celui qui voyage, s’instruit et s’imprègne. Les Européens de la Renaissance eux, n’avaient pas pleinement conscience de leur identité culturelle. Selon l’historien anglais John Hale, ce fut à cette époque que le mot Europe entra dans le langage courant et fut doté d’un cadre de référence solidement appuyé par des cartes et d’un ensemble d’images affirmant son identité visuelle et culturelle.
Elément crucial lorsqu’on s’aperçoit qu’aujourd’hui, on peut s’habiller de la même façon à Londres comme à Milan. L’identité culturelle d’aujourd’hui en Europe ce sont des siècles d’histoire homogénéisés par des modes de vie qui s’interpénètrent et s’assimilent du nord au sud, de l’ouest à l’est, par les moyens de communication qui sont les nôtres.




Là où l’on pourrait frôler le mauvais goût, Alessandro a eu l’ingéniosité de prendre du recul quant à cette multiplicité de références toutes plus conséquentes les unes que les autres ; ainsi, si la collection dans son ensemble peut paraître légitimement fouillie, en réalité elle permet de remettre en question l’idée de goût : si l’on est à la limite de ce qu’un tel qualifierait de mauvais goût, c’est notamment pour amener le regardeur à s’interroger : le moins est-il le mieux, le rare est-il toujours beau ? Quelles références sont les miennes ? Pourquoi porter aujourd’hui ce que j’ai détesté hier ?
Nous sommes certainement au moins autant les légataires d’une histoire du vêtement et de ses codes, que ceux qui imposent et revendiquent une nouvelle manière d’appréhender notre époque. Le style d’Alessandro Michele se ressent dès l’arrivée des premières silhouettes, masculines et féminines, toujours ultra-colorées (bleu, vert, orange, rouge, violet) et riches en motifs, broderies, et autres décorations. Le directeur artistique de la maison joue la carte des mélanges : genres, matières, imprimés ou ornements. La collection relie les débuts de Gucci à l’histoire de la ville. Renommée pour sa délicatesse, la dentelle est l’emblème de la mode à la Renaissance. Cette veste en dentelle conçue par Michele rebrodée de fleurs et de feuilles rend hommage au passé tout en affichant des lignes contemporaines.
Le designer continue d’explorer la faune et la flore qu’il a fait siennes – roses roses, sur des robes plissées, poissons (symboles christiques?) sur tee-shirt on ne peut plus basique… Le chanteur Francesco Bianconi a défilé en costume avec un imprimé de tapisserie orné de roses rouges. L’excentricité est de mise : pantalon de jogging 1990’s porté avec une chemise à volants, manteau matelassé bordeaux, imprimé dragon sur col de veste rouge – Chinatown dans les 1980’s. L’excentricité, selon Michele, n’est pas un accident mais une façon de s’approprier une époque et d’exprimer une individualité, ce à quoi on pourrait ajouter de ne pas se laisser enfermer dans une tendance, un style, mais de les épouser toutes, se démarquant par ce biais de la mass mode.
Côté pièces, la maison propose de nombreuses robes fluides, longues et colorées, semblant avoir été conçues pour des déesses, mais aussi des robes en brocart ou en mousseline de soie, qui contrastent avec les mini shorts en denim ornés de motifs, les robes en cuir, ou encore les joggings iridescents. Des styles qui se complètent finalement plus qu’ils ne s’affrontent comme le montre un ensemble composé d’un jogging vintage surmonté d’un long manteau matelassé rose. On retrouve également le Logo GG utilisé pour la première fois dans les années 70. La collection Cruise 2018 rend hommage aux origines de Gucci en réintroduisant ce motif GG dans le prêt-à-porter, qui contraste avec un fond arc-en-ciel en harmonie avec la nouvelle esthétique de la Maison, et appuie cette atmosphère d’intemporalité.
Les pièces sont marquées de l’estampille Renaissance, de cette inspiration au cœur de la création du designer : la cape en fourrure de vison marron – pour ne citer qu’elle – présente dans sa doublure en soie à imprimé rose une broderie « Venere », en référence à la déesse romaine Vénus. La palette est vive et dynamique, avec un accent porté sur le rose encore (décliné en plusieurs harmonies) et l’or, bien sûr, très présent.
Côté détails, on retrouve beaucoup de nœuds, comme autant de citations et d’emprunts aux époques passées à décoder, sur le prêt-à-porter mais aussi sur les accessoires, et des fleurs, faisant écho aux motifs de la collection. Les couvre-chefs sont aussi présentés en nombre, plus excentriques que jamais, comme ces couronnes de lauriers qui viennent habiller la tête des mannequins, ou encore ces cagoules entièrement recouvertes de perles. Certains modèles défilent d’ailleurs avec des colliers de perles qui entourent non pas leur cou mais leur visage.
« Je pensais injecter du rock ‘n’ roll dans la collection, en pensant à des visages comme [Simonetta] Vespucci (muse de Botticelli, que l’on peut voir sur la toile des quatre saisons). Elle était rock’n’roll à l’époque. » Un modèle portait ses cheveux à la manière de Vénus (peinte par Botticelli), des perles et des couronnes de laurier très fines encadraient les visages des modèles alors qu’elles entraient, vêtus de robe courte en brocart avec un col roulé ou une robe en mousseline de soie plissée dans différentes nuances de rose. « J’aime le rose, c’est très puissant. Cela te fait te sentir douce et sexy, même si tu es un homme ». Michele
Les vestiges de l’ancien thème classique, ces couronnes dorées, ces diadèmes en argent au motif de lyres, les turbans léopard, foulards, bandeaux laineux, côtoient autres lunettes teintées quelque peu ringardes dirait-on aujourd’hui, les perles tissées dans les tresses de cheveux, un hommage certain à la perle irrégulière du baroque. L’œil italianisant de Michele pour l’excès et l’extravagance rôde sans entrave à travers les siècles, des impressions psychédéliques sur tailleurs aux robes de chambre Renaissance devenues seventies.




Cette saison, il y avait également des collants pailletés et imprimés au logo GG, des chaussettes, sur lesquelles on pouvait voir des impressions de tête de loup, motif spirituel repris par certains bikers américains aux tribus indiennes et donc repris par Michele ici. Sans compter ces slogans Guccy, Guccification, et Guccifiez-vous. A l’image du logo omniprésent, tout sauf discret, et filé sur des jupes midi, des pantalons pour hommes, ainsi que des bombers et des fourrures, faisant office de véritables « hiéroglyphes, pop symboles » dans l’esprit de Michele. L’ambition de la Maison est donc de « Gucchifier ». Il y a la volonté de jouer avec les codes, de faire de reprises de reprises et de l’auto-parodie, consciente.
Ce qui empêche de tomber dans une lecture premier degré est l’étrangeté sous-jacente: il y a quelque chose d’inquiétant dans ces silhouettes qui défilent. Teints grisés, œil vide, ils ressemblent à s’y méprendre à ces hommes robotisés que l’on voit dans le film « Bienvenu à Gattaca ». Peut-être n’y a-t-il pas de grandes profondeurs politiques, mais il y a un sous-texte que le public n’a pas vu, car ils étaient littéralement assis dessus. Michele avait les lignes de « A Song For Bacchus », un poème écrit au 15ème siècle par Lorenzo de Medici, brodé sur les sièges sur lesquelles ils étaient assis :
Chants de Carnaval de Lorenzo de’ Medici
Combien belle est la jeunesse : Elle ne cesse de fuir.
Qu’à son gré chacun soit en liesse, Rien n’est moins sûr que demain.
C’est Bacchus et Ariane, Beaux et brûlants l’un pour l’autre : Leur bonheur est d’être ensemble, Car le temps s’enfuit, trompeur.
Ces nymphes et tout le monde Ne cessent d’être en gaîté. Qu’à son gré chacun soit en liesse, Rien n’est moins sûr que demain.
Il s’agit donc de célébrer la vie, et les vies, de ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, et dont on hérite une part de notre culture, avant que l’on disparaisse à notre tour. Là est sans doute puisé ce caractère orgiaque, cette volonté de tout voir tout faire tout porter avant d’être emporté. Inspiré par le Carnaval de Florence où il a l’habitude de se rendre, Laurent de Médicis sacrifiait bien volontiers tout lyrisme au ton enjoué de la plupart de ces ballades. Ici, on peut lire un hymne à la vie : il compose d’abord dans le style comico-réaliste, parodique et caricatural, faisant écho au fouillis de Michele.
Avec cet aphorisme, inspiré de Médicis, Alessandro Michele a résumé sa collection croisière Gucci, présentée lundi soir à la galerie Palatine du Palais Pitti, qui, bien sûr, combinait des éléments chers au designer – ses riches broderies et décorations, ainsi que cette opulence, tant dans les couleurs que dans les matériaux, cette profusion de codes que l’on retrouve exemplifiée sur Elton John, l’un de ses invités de premier rang, qui portait une veste sombre mais pailletée. Pailletée et munie d’une broderie de lézard multicolore sur l’un des bras, le lézard étant le dérivé du serpent dans la symbolique aztèque, qui a la particularité d’être considéré comme un ami de la maison, on aura compris que certains invités répondent au designer.
Pour finir, les chanceux qui étaient invités au défilé ont eu la surprise de repartir avec une boîte conçue comme un souvenir de Florence, une boîte sur laquelle était estampillée des feuilles d’orties, accompagnée d’un chapeau de la marque dans un sac de jute : « C’est une belle boîte, mais vous ne savez pas si c’est un poison, un médicament ou un parfum. Cela vient de Nouvelle-Zélande, et c’était ce qu’il y avait de plus exotique à porter à la Renaissance. C’était très rare, mais à cette époque, vous pouviez le trouver à Florence, ce qui ne manque pas d’illustrer la richesse de cette époque. »




C’est au sein de la sublime Galerie Palatine du Palais Pitti qu’Alessandro Michele avait choisi de faire défiler sa collection croisière 2018. Les différentes silhouettes Gucci témoignent une fois de plus de la folie créative du directeur artistique de la maison qui parvient malgré le tourbillon de matières, de couleurs et d’influences à conférer à la collection une harmonie baroque, donc irrégulière mais non moins exigeante.
Quoi qu’il en soit, il convient de relever qu’Alessandro, avec l’aide de son PDG Marco Bizzari, a su faire preuve d’habileté quand il a s’agit de marquer un retour définitif à l’artisanat italien, allant jusqu’à créer des coopératives ouvrières spécialisées en maroquinerie. Sous l’impulsion d’Alessandro Michele, directeur artistique, Gucci a redéfini le luxe de sa Maison tout en renforçant sa position parmi les maisons de couture les plus convoitées au monde, s’inspirant sans doute des « petites mains » que l’on retrouve chez LVMH et chez Chanel. Le cadre a pu aider, même si l’idée d’un défilé en plein hangar aurait pu également s’y prêter, tant il fait sens.
Tant en termes de confection, que de sens donné à la collection, Michele a su capter l’esprit de son temps, qui n’a guère plus envie d’être encastré dans un style, un mouvement, mais de les embrasser tous, dans une harmonie hétéroclite. Si à première vue les silhouettes apparaissent un peu fouillies dans les termes, foutraque dans le sens qu’on peut lui conférer, en y réfléchissant un peu plus, on s’aperçoit qu’elle représente la quintessence de notre époque : une profusion difficile à maîtriser, riche de symboles et de codes qu’un spécialiste seul peut déchiffrer tant le tout est intellectualisant à outrance.
Pas vraiment populaire, mais pop au sens de polyphonique, polysémique et exaltant. Hommes et femmes défilent ensembles, et la femme n’est plus l’avatar – ou du moins le seul avatar – de ce que l’on mitraille du regard et objectise. Féminin et masculin sont encore un peu moins des genres en couture, mais davantage des problématiques de mesures : largeur d’épaule, courbure de la veste. En somme, il nous a été présenté un débordement maitrisé, une harmonie convaincante, desquelles s’exhalait une appétence pour le bel anachronisme.








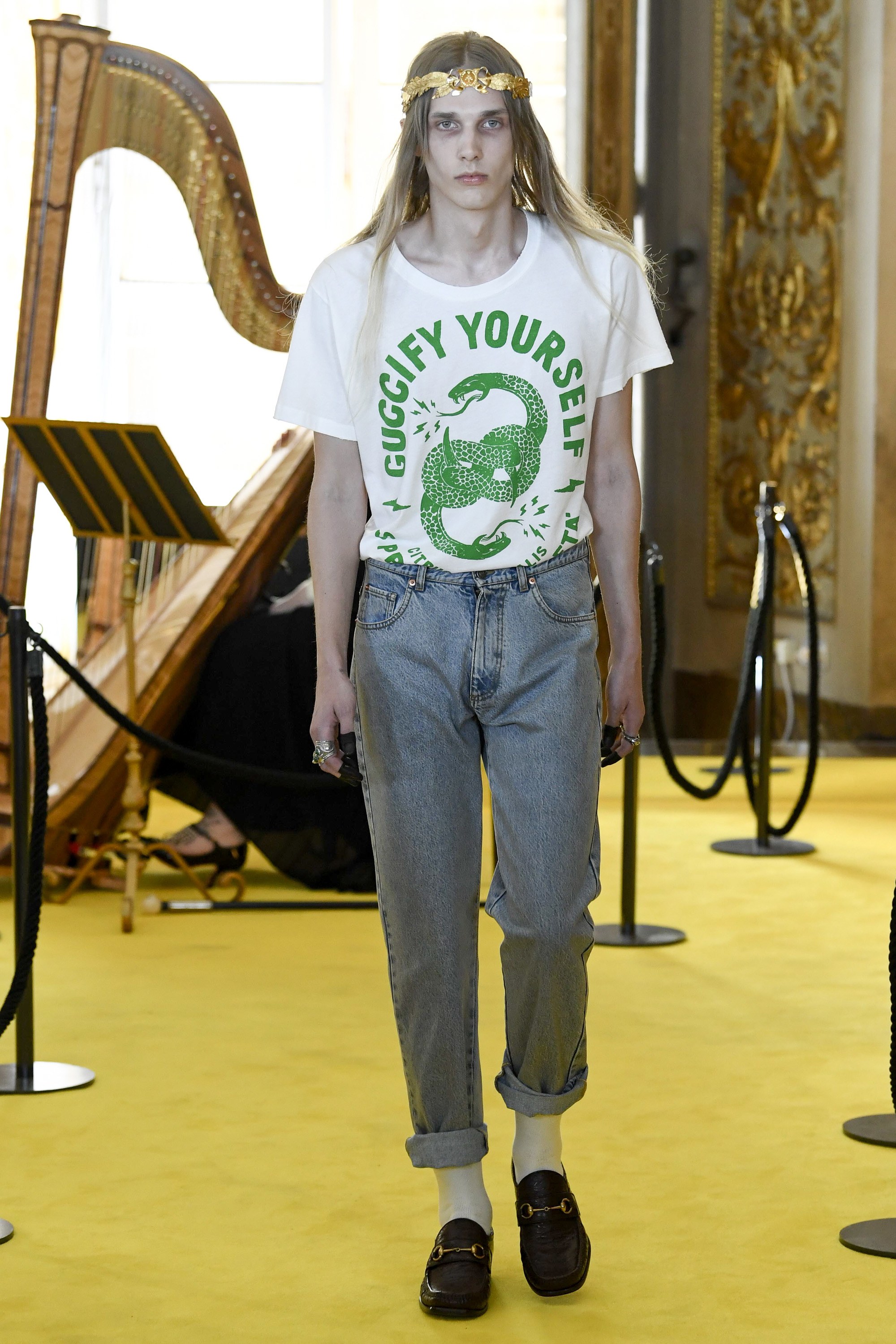



![]() The taste of beautiful anachronism
The taste of beautiful anachronism
Cruises shows are now the prerogative of Maisons de couture. Gucci does not want to step down. It’s in the 1990s that the brand returns to its original imprint, a dazzling fashion, but never vulgar, an accumulation of all kinds influences, at the turn of the years 2015-2020, quite sharped, even intellectual. But claiming an intellectual difference as followers of minimalism like Yamamotos, or today Margiela.
This cruise show, ideal for customers, to bridge the autumn/winter & spring/summer collections, gathered in few passages all the DNA of the Gucci House : a baroque spirit, second degree, with opulent artefacts. After the resounding passage of Tom Ford in the 1990s, it’s now Alessandro Michele who has been at the head of the artistic direction since 2015.
Founded in 1921, the Gucci brand still manufactured everything in Italy. At the origin of luxury leather goods, the DNA of the House develops itself around the equestrian world ; bit and stirrup become emblems. Very quickly, and as early as 1930, the brand diversified into shoes, gloves, underpants (…) and survived the shortages of raw materials of the fascist period by diversifying its materials. This is what we owe the « Bamboo » bag, with a bamboo handle and boar leather.
Gucci products are creations that focuses on being timeless and eternal. Gucci’s task season after season is to embody good taste, sharing with Vuitton or Prada the elitist world of equestrianism. However, Tom Ford years have left an undeniable impression and celebrated a sexy woman with few subtlety and a lot of subversion.
Thus, the question that all raises is to know if the silhouette proposed by Michele renews with this will of elegance and refinement, or if itis like in Tom Ford years, a manifesto of a certain state of gender? Does the adjective « pop » of « popular » apply to this collection?
Strolling through the Palatine Gallery in the Pitti Palace, Alessandro Michele’s Cruise 2018 collection is inspired by the Italian Renaissance. This is the first time that a fashion show is being held in this place, which for the occasion will receive more than 2 million euros from Gucci for the restoration of gardens, that we can only congratulate in view of the economic situation in Italy today (…)
This attraction of the brand for emblematic places of culture does not date from this show: in fact Gucci has already collaborated with the Strozzi Palace in Florence, the Micheng Art Museum in Shanghai, Chatsworth House in England and LACMA in Los Angeles. Just last year, the House revealed its cruising collection in the Cloister of Westminster Abbey. This desire to anchor season after season at emblematic places of culture only confirms these links becoming closer and closer between art and fashion.
Michele, backstage, indulging on the collection, confided that « The very beginning of European aesthetics began in Florence, » to which we could of course retort that the Florentine Renaissance art come very much from the Hellenistic era … From this somewhat fantasized vision of Florence we will remember that there’s indeed something unique to the antique, considered today as classic classics. But to dare the comparison between Napa Valley and Florence as he does, we probably would not go so far … We imagine that the enthusiasm of creation taking shape probably exceeded him (…)
« This place is not about the past, it’s like Napa Valley now, with everything happening. » Michele
The Palazzo Pitti, where the show was held, has the particularity that it perfectly illustrates the transition from Middle Ages to Renaissance. Indeed, during Middle Ages, castles were austere buildings built for the self-defense of a territory or a country and the protection of the surrounding population. Once the hundred-year-old war was buried, the next century was spent in the reign of palaces, less utilitarian, but more aesthetic, revealing in another way wealth and power of their owners, where one can see a parallel with these clothes conceived no more for the comfort but for pure aesthetic, ornamentation, comment on oneself to the others, to the world.
Let’s go back to the show. Alessandro Michele’s first ambition was to make the show at the Athenian Parthenon: « In the beginning everything started around the Mediterranean, Greek as well as Roman cultures. » Not having Athens, he turned towards Florence, the city where money and power were prolifique. His quirky and maximalist style could not find a better setting than the Florentine Pitti Palace, where the collection inspired by Italian Renaissance finds the right tone between embroidery, pearls and multiple ornamentation, and frequent reminders of modernity in which his work is written: either WASP polos, bomber of beginning of XX century, block colors, 1960’s printed (…)
And indeed, during the Renaissance, clothes are often made of velvet or silk, a noble and expensive material. Men of high society wear tights and strawberries, baroque set the tone for suits. Between 1625 and 1670, costume uses imagination and virtuosity: lack of measurement, search for movement, opposition, and freedom. Thus one avoids the cold restraint of Reform and that of the Counter-Reformation: one draws on the profusion of details, in the excess that will go to the preciousness.
Symmetry and balance were no longer appropriate, neither with Michele, who mixes female and male locker rooms, uses and abuses colors by making their possible complementarity, and does not hesitate to associate with noble materials like jogging cotton. Anachronism is authoritative and suggests a form of freedom of your own clutter. « I like popular culture, which is why I particularly enjoy the Renaissance, which I think is very pop. « Pop » means it’s understood by everyone. A. Michele.
This is why, in Baroque, the Gucci silhouette owes its eclecticism, rich of a syncretism peculiar to the one who travels, educates and impregnates himself. The Europeans of the Renaissance were not fully aware of their cultural identity. According to the English historian John Hale, it was at this time that the word europe entered into everyday language and had a frame of reference firmly supported by maps and a set of images asserting its visual and cultural identity.
Crucial element when one realizes that today, one can dress the same way in London as in Milan. Cultural identity of today in Europe is centuries of history homogenized by ways of life that interpenetrate and assimilate from north to south, from west to east, by means of communication that are ours.
Where one could be closed to bad taste, Alessandro had the ingenuity to take a step back with regard to this multiplicity of references all more important than the others ; thus, if the collection as a whole may seem legitimate clutter, in reality it allows to question the idea of taste: if one is at the limit of what can be qualified as bad taste, it’s especially to make the viewer question himself: the less is it the better, the rare is it always beautiful? Which references are mine? Why should I wear today what I hated yesterday?
We are certainly at least as much the legatees of a history of clothing and its codes, as those who impose and claim a new way of apprehending our era. The style of Alessandro Michele is felt from the arrival of first silhouettes, male and female, always ultra-colored (blue, green, orange, red, purple) and rich in patterns, embroidery, and other decorations. The artistic director of the house plays the card of mixtures: genres, materials, prints or ornaments. The collection linked Gucci’s debut to the history of the city. Renowned for its delicacy, lace is the emblem of fashion in Renaissance. This lace jacket embroidered with flowers and leaves, pays tribute to the past while displaying contemporary lines.
The designer continues to explore fauna and flora that he has made – pink roses, pleated dresses, fish on T-shirt … Singer Francesco Bianconi paraded in costume with a tapestry print adorned with red roses. The eccentricity is the order of the day: 1990’s jogging pants worn with a ruffled shirt, burgundy quilted coat, dragon printed on red jacket collar – Chinatown in the 1980’s. Eccentricity, according to Michele, is not an accident but a way of appropriating an epoch and expressing an individuality, to which one could add not to be locked in a trend, a style, but marrying them all, standing out through the mass mode.
As for the rooms, the house offers many flowing, long and colorful dresses that seem to have been designed for goddesses, but also brocade or chiffon dresses, which contrast with mini denim shorts decorated with patterns, leather dresses, or iridescent jogging. Styles that complement each other more than they clash as shown in a set consisting of a vintage jog surmounted by a long quilted pink coat. There’s also the GG Logo used for the first time in the 70’s. The 2018 Cruise collection pays tribute to the origins of Gucci by reintroducing GG motif in ready-to-wear, which contrasts with a rainbow background in harmony with the new aesthetic of the House, and supports this atmosphere of timelessness.
Pieces are marked with Renaissance stamp, this inspiration at the heart of the designer’s creation: the brown mink fur cape – to name only one – has « Venere » embroidery in its pink print silk lining, in reference to the Roman goddess Venus. The palette is lively and dynamic, with a focus on the rose (declined in several harmonies) and gold, of course, very present.
In regards to details, we find many nodes, on ready-to-wear but also on accessories, and flowers, echoing grounds of the collection. The headgear is also presented in numbers, more eccentric than ever, like the laurel crowns that come to dress heads of models, or these hoods entirely covered with pearls. Some models have it with pearl necklaces that surround not their neck but their faces.
« I was thinking of injecting rock ‘n’ roll into the collection, thinking of faces like [Simonetta] Vespucci (Botticelli’s muse, which can be seen on canvas of the four seasons). She was rock’n’roll at the time. A model wore her hair in the style of Venus (painted by Botticelli), pearls and laurel wreaths framed the faces of the models as they entered, dressed in short brocade dress with a turtleneck or a dress chiffon pleated in different shades of pink. « I like pink, it’s very powerful. It makes you feel sweet and sexy, even if you are a man. » Michele
Remains old classical theme, these gilded crowns, these silver tiaras with lyres, leopard turbans, scarves, woolly headbands, rub shoulders with other slightly dull tinted glasses, pearls woven into braids, a certain tribute to the irregular pearl of Baroque. Michele’s italianizing eye for excess and extravagance prowls unhindered through the centuries, psychedelic impressions on tailors to the vestiges of old classic theme, these golden crowns, these silver diadems with lyres, leopard turbans, scarves, woolly headbands, rub shoulders with other glasses tinged somewhat nerdy, pearls woven into the braids of hair, a tribute to the irregular baroque pearl.
This season, he had glittery tights and printed with GG logo, socks, on which we could see impressions of wolf head, symbol borrowed from American Indians by bikers, then reinterpreted here by Michele. Not to mention these slogans : Guccy, Guccification, and Guccify yourself. Like the omnipresent logo, all but unobtrusive, and spun on midi skirts, men’s trousers, as well as bombers and furs, acting as real « hieroglyphs, pop symbols » in Michele’s mind. The ambition of the House is to « Gucchifier ». There’s will to play with codes and to make self-parody, conscious.
What prevents it from falling into a reading first degree is the underlying strangeness: there’s something disturbing, almost of order of the undead, in these silhouettes. Gray-skinned, empty-eyed, they look just like robots men we see in the film « Welcome to Gattaca ». Maybe there are not great political depths, but there’s a subtext that public did not see because they were literally sitting on it. Michele had the lines of « A Song For Bacchus », a poem written in the 15th century by Lorenzo de Medici, embroidered on the seats on which they sat:
Carnival songs by Lorenzo de ‘Medici
How beautiful is the youth: She keeps running away. That, at pleasure, everyone is jubilant,
Nothing is less certain than tomorrow. It’s Bacchus and Ariadne, Fine and burning for each other:
Their happiness is to be together, Time runs away, deceptive. These nymphs and everyone don’t stop being cheerful.
That, at pleasure, everyone is jubilant, Nothing is less certain than tomorrow.
It’s therefore a question of celebrating lives and lives of those men and women who have come before us, and of whom we inherit a part of our culture, before we disappear in our turn. There’s no doubt that this orgiastic character, this desire to see everything to wear before being carried away. Inspired by the Carnival of Florence, where he is accustomed to surrender, Laurent de Medici willingly sacrifices all lyricism to the cheerful tone of most of these ballads.
With this aphorism, inspired by the Medici, Alessandro Michele summed up his Gucci cruises collection, presented Monday evening at the Palatine gallery of the Pitti Palace, which, of course, combined elements dear to the designer – his rich embroidery and decorations, as well as this opulence in both colors and materials, this profusion of codes found exemplified on Elton John, one of his first guests, who wore a dark but glittery jacket sequined with multicolored lizard embroidery on one of the arms, the lizard being the derivative of serpent in azteque symbolism, which has the distinction of being considered a friend of the house, it will be understood that some guests respond to the designer.
Finally, the lucky ones who were invited to the show had the surprise to leave with a box conceived as a souvenir of Florence, a box on which was stamped sheets of nettles, accompanied by a hat of the mark in a bag of jute: « It’s a beautiful box, but you don’t know if it’s a poison, a medicine or a perfume. It comes from New Zealand, and it was the most exotic thing to wear in the Renaissance. It was very rare, but at that time you could find it in Florence, which does not fail to illustrate the richness of this time. «
It’s in the sublime Palatine Gallery of Pitti Palace that Alessandro Michele chose to scroll through his 2018 cruise collection. The different Gucci silhouettes once again testify the creative folly of the artistic director of the house who manages despite the swirl of materials, colors and influences to confer to the collection a baroque harmony, therefore irregular but not less demanding.
Be that as it may, it should be noted that Alessandro, with the help of his CEO Marco Bizzari, has been able to be clever when it comes to marking a definitive return to Italian crafts, ranging to create workers’ cooperatives specialized in leather goods. Under the leadership of Alessandro Michele, Artistic Director, Gucci has redefined luxury of his House while strengthening its position as one of the most coveted couture Houses in the world, no doubt inspired by the « petites mains » that one found at LVMH and at Chanel. The executive could help, even if the idea of a show in the middle of hangar would have worked, as long as it makes sense.
Michele, both in terms of clothing and meaning given to the collection, has captured the spirit of his time, which hardly wants to be embedded in a style, a movement, but to embrace them all, in a heterogeneous harmony. If at first glance silhouettes appear a little fuzzy in terms, foutraque in sense that we can confer, thinking a little more, we realize that it represents quintessence of our time: profusion difficult to master, rich in symbols and codes that only a specialist can decipher as the whole is intellectualizing to excess.
Not really popular, but polyphonic pop, polysemic and exhilarating. Men and women on the same show, together, as women are no longer avatar – or at least the only avatar – of what one grazes the eye and objects. Feminine and masculine are still less of a kind in sewing, but more problematic measures: shoulder width, curvature of the jacket. In short, we were presented with a controlled overflow, a convincing harmony, from which exhaled an appetite for beautiful anachronism.




















































































Galerie

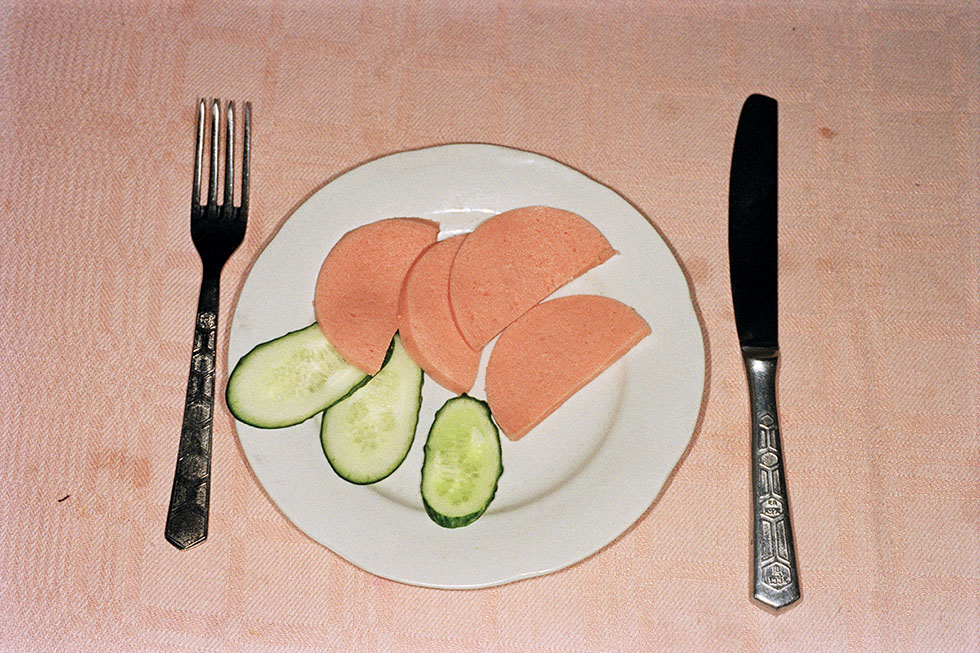
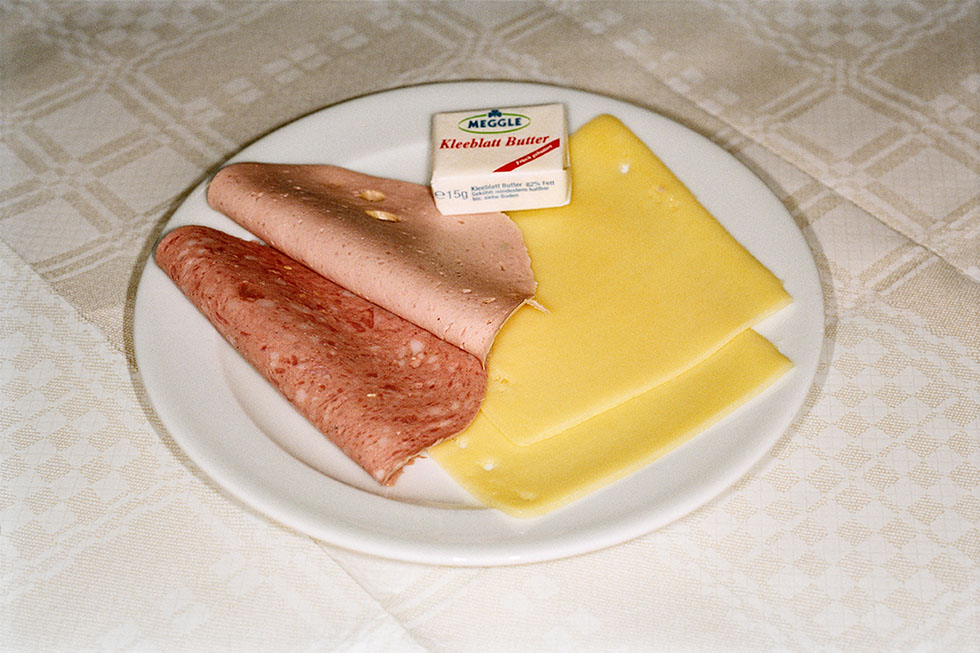




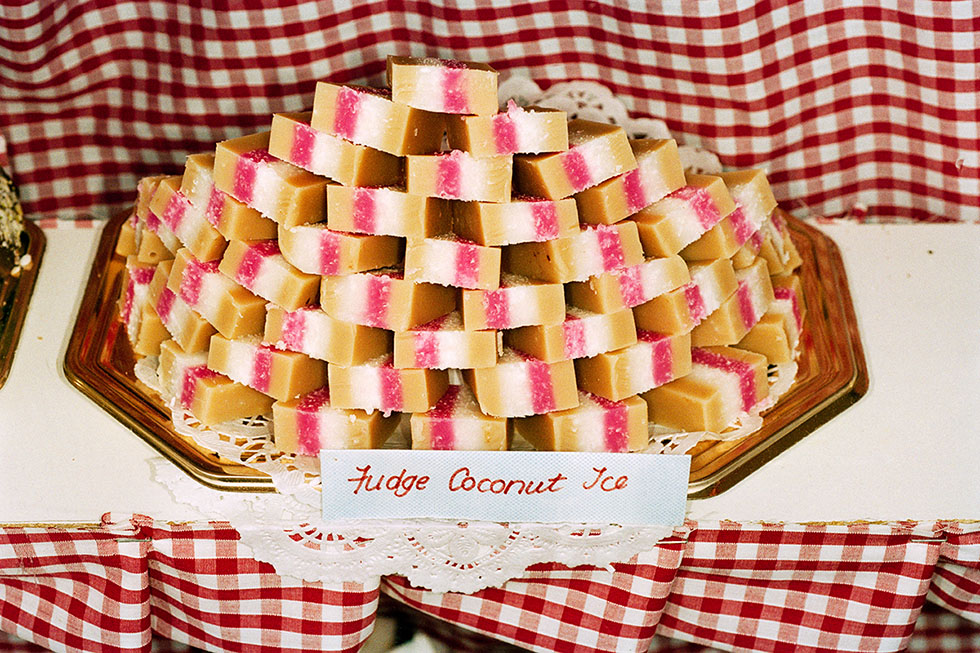









Martin Parr
Photographier le vulgaire
Photographe britannique membre de la coopérative Magnum Photos (1), Martin Parr n’en finit plus d’intéresser le monde de l’art. Ses travaux dressent le portrait peu flatteur et parfois ironique mais relativement réaliste de ses sujets, anonymes et si communs, inventoriant les habitudes de vie des britanniques de l’ère Thatcher – et post Thatcher (2).
Une certaine vision de cette société où la consommation de masse et ses excès deviennent le sujet principal, et où Parr se laisse quelquefois aller à des retouches particulièrement significatives, d’un mode de vie où entre la représentation – dans la publicité par exemple – et la réalité, s’immisce un décalage, parfois grossier.
Pratique relativement récente, la photographie n’apparaît qu’au XIXe siècle en France, ouvrant la voie à de nouvelles expérimentations en art et à la reconsidération d’un médium déjà vieux de 40 000 ans : celui de la peinture. En deux siècles à peine, la photographie aura subi un certain nombre de bouleversements caractéristiques de l’ère industrielle, post industrielle puis technologique.
En effet, l’objet de la représentation stricte du réel telle que l’œil le perçoit, va passer de la peinture à la photographie, la première ayant été distancée – et de loin – par les progrès en la matière. Puis va passer des mains de l’expert scientifique à celles de l’artiste, puis d’absolument tous, quidam comme expert, scientifiques et artistes, jusqu’à devenir un acte aussi consacré qu’ordinaire.
Si la photographie depuis deux siècles a pu être le lieu de l’expérience, de la science et de l’exploration, s’éloignant ainsi d’une volonté descriptive et objective du réel, ici même et avec Martin Parr, elle en redevient le prétexte ouvrant alors la voie à un travail situé entre documentaire, inventaire, passant en revue les modes de vie actuels, communément qualifiés de consommation de masse et dont la Guerre Froide (3) nous partage l’héritage.
Prétexte à plaisanteries et railleries en tous genres, le résultat de cette œuvre documentaire est incontestablement esthétique, volontairement haptique et kitsch tout à la fois. Il se situe exactement à la lisière entre travail plastique et désir de témoigner d’une période donnée. Ces images une fois classifiées témoignent d’un nouvel espace propre à la collection dont la source est le réel et son instantanéité, l’ordinaire et la répétition, la classe moyenne et ses travers.
Cette esthétique populaire a été rendue possible par l’équipement de chacun, adultes & enfants, en matériel de capture photographique, de ces éléments mémoriels qui témoignent jour après jour d’une réalité indicielle où les détails pris sur le vif et particulièrement répétitifs sont autant d’éléments faisant état d’une époque et de ses modes de vie, et des individus qui la composent.
La photographie embrasse alors le vulgaris, vulgus (4) vulgaire soit la foule, dans son entièreté, la réalité prenant la forme de l’itératif et du débordement, fonctionne alors comme un espace propre à l’uniformisation des modes de vie et rejoint donc la spécificité de l’archive. La particularité de Parr étant alors de se situer entre sériosité documentaire et parti pris pour une distanciation quelque peu ironique. Le réel est converti en document et les habitus (5) comme les excès dont il témoigne quelque peu moqués.
À la fois photographie indicielle et mémorielle, le travail de Martin Parr est celui d’un archiviste qui se plaît à voguer entre collectionnisme et lois des séries, anthropologie des modes de vie occidentaux et esthétisation kitsch propre à l’art du tout début du XXIe siècle, il est le reflet de ce paradigme propre à la photographie, instrument d’étude, de connaissance, de création et loisir à portée de tous.
(1) Agence créée après 1945 à New-York par Robert Capa, Henri Cartier Bresson, David Seymour et George Rodger, qui changera à jamais les conditions de propriété intellectuelle du photographe devenu auteur. Pour aller plus loin : https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1996_num_52_1_3577
(2) De la première ministre britannique Margaret Thatcher en poste de 1979 à 1990.
(3) Pour aller plus loin : Jean Baudrillard, La Société de consommation. Folio Essais, 2008 sur ce qu’il considère comme le plus bel objet de consommation, soit, le corps (troisième partie, p. 219). Mais aussi Emily S. Rosenberg, « Le modèle américain » de la consommation de masse », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 108 | 2009, mis en ligne le 01 avril 2012, consulté le 13 novembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/1809 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.1809 notamment sur la rivalité consumériste des deux blocs.
(4) Du latin vulgaris, de vulgus, « foule, commun des hommes », « multitude ». https://fr.wiktionary.org/wiki/vulgaire
(5) Notion que l’on doit principalement à Pierre Bourdieu et qui témoigne des habitudes et appartenances sociales. Pour aller plus loin : Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, 1979.









![]() Martin Parr
Martin Parr
Photographing vulgarity
British photographer and member of the Magnum Photos cooperative (1), Martin Parr is still interesting the Art world. His work paints an unflattering and sometimes ironic but relatively realistic portrait of his subjects, anonymous and common people, inventorying the lifestyles of British people in the Thatcher era – and post-Thatcher (2).
A certain vision of this society where mass consumption and its excesses become the main subject, and where Parr sometimes indulges in particularly significant alterations, of a way of life where representation – in advertising for example – and reality, a discrepancy intrudes, sometimes coarse.
A relatively recent practice, photography only appeared in the 19th century in France, opening the way to new experiments in art and the reconsideration of a medium already 40,000 years old: that of painting. In barely two centuries, photography will have undergone a certain number of upheavals characteristic of the industrial, post-industrial and then technological era.
Indeed, the object of the strict representation of reality as the eye perceives it, will pass from painting to photography, the first having been left behind – and by a long way – by progress in the field. Then it will pass from the hands of the scientific expert to those of the artist, then absolutely everyone, both individual and expert, scientists and artists, until it becomes an act as consecrated as ordinary.
If photography for two centuries has been the place of experience, science and exploration, thus moving away from a descriptive and objective desire for reality, here itself and with Martin Parr, it once again becomes a pretext to open the way to a work located between documentary, inventory, reviewing current lifestyles, commonly described as mass consumption and whose legacy the Cold War (3) shares with us.
A pretext for jokes and taunts of all kinds, the result of this documentary work is undeniably aesthetic, deliberately haptic and kitsch all at the same time. It is located exactly on the border between plastic work and the desire to bear witness to a given period. These images, once classified, attest of a new space specific to the collection whose source is reality and its instantaneity, the ordinary and repetition, the middle class and its failings.
This popular aesthetic was made possible by equipping everyone, adults and children, with photographic capture equipment, these memorial elements which testify day after day to an indexical reality where the details taken on the spot and particularly repetitive are as much elements reporting an era and its ways of life, and the individuals who make it come up.
Photography then embraces the vulgaris, vulgar vulgus (4) or the crowd, in its entirety, reality taking the form of the iterative and the overflow, then functions as a space specific to the standardization of lifestyles and therefore joins the specificity of the archive. Parr’s particularity then being to position himself between documentary seriousness and a bias towards a somewhat ironic distancing. Reality is converted into a document and habitus (5) and excesses to which it attests are somewhat mocked.
Both indexical and memorial photography, Martin Parr’s work is that of an archivist who enjoys navigating between collecting and the laws of series, the anthropology of Western lifestyles and kitsch aestheticization specific to the art of the very beginning of the 21st century. century, it is the reflection of this paradigm specific to photography, an instrument of study, knowledge, creation and leisure accessible to all.
(1) Agency created after 1945 in New York by Robert Capa, Henri Cartier Bresson, David Seymour and George Rodger, which will forever change the intellectual property conditions of the photographer turned author. To go further: https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1996_num_52_1_3577
(2) From British Prime Minister Margaret Thatcher in office from 1979 to 1990.
(3) To go further: Jean Baudrillard, The Consumer Society. Folio Essays, 2008 on what he considers to be the most beautiful object of consumption, namely, the body (third part, p. 219). But also Emily S. Rosenberg, “The American model” of mass consumption”, Cahiers d’histoire. Critical History Review [Online], 108 | 2009, posted online April 1, 2012, accessed November 13, 2023. URL: http://journals.openedition.org/chrhc/1809 ; DOI: https://doi.org/10.4000/chrhc.1809 particularly on the consumerist rivalry of the two blocs.
(4) From Latin vulgaris, from vulgus, “crowd, common of men”, “multitude”. https://fr.wiktionary.org/wiki/vulgar
(5) Notion that we owe mainly to Pierre Bourdieu and which reflects social habits and affiliations. To go further: Pierre Bourdieu, La Distinction. Social critique of judgment, Minuit, 1979.
















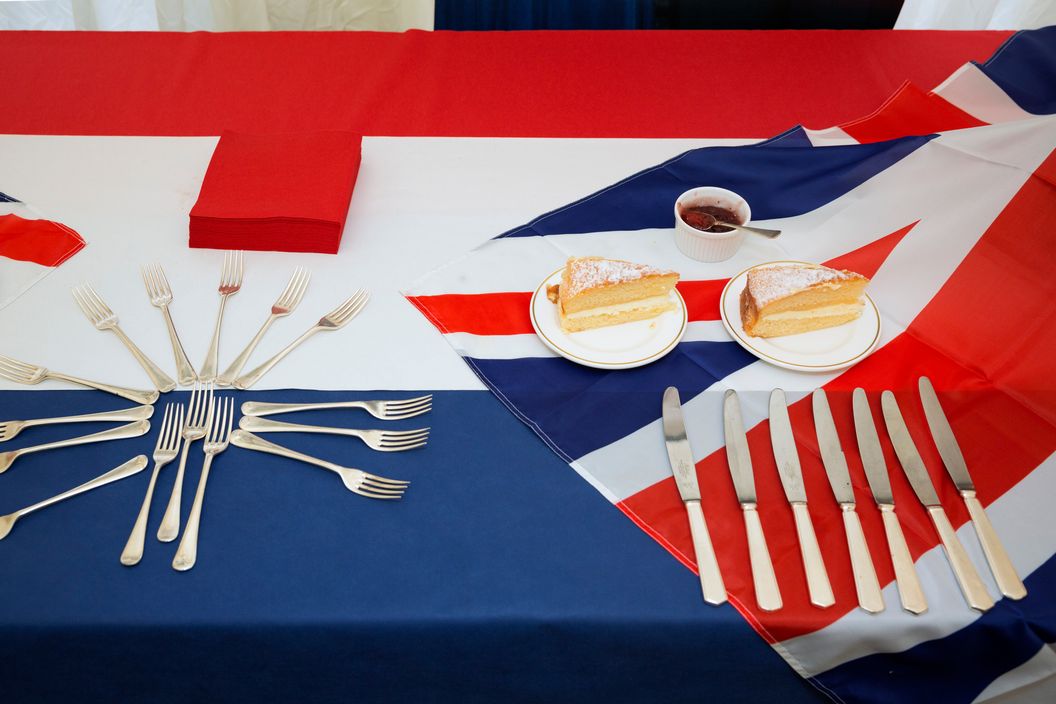








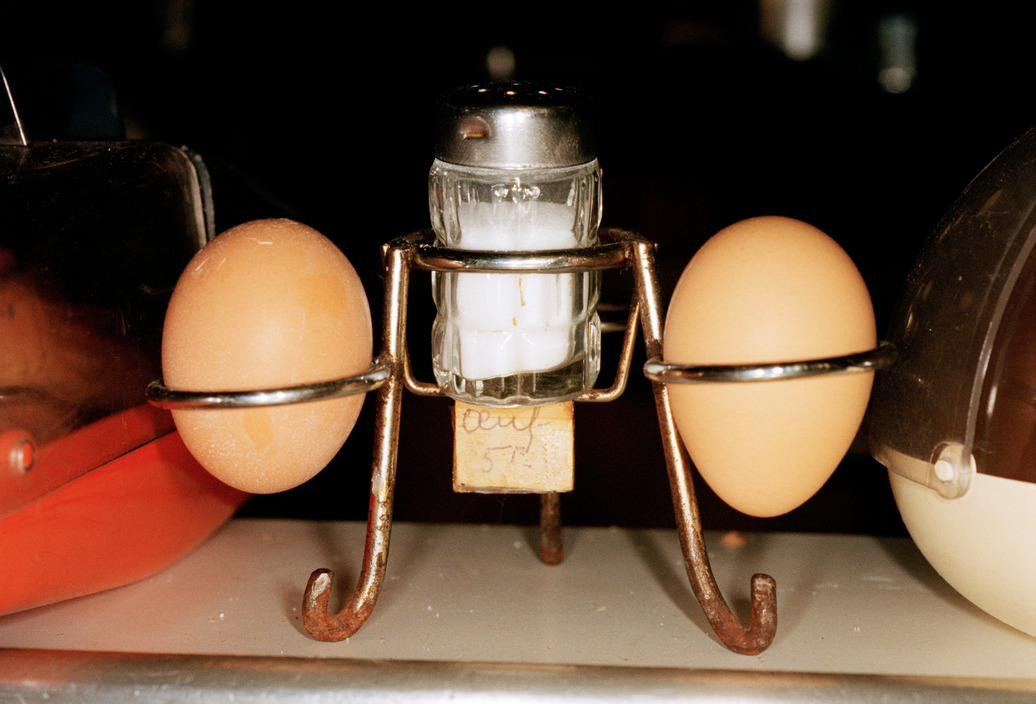







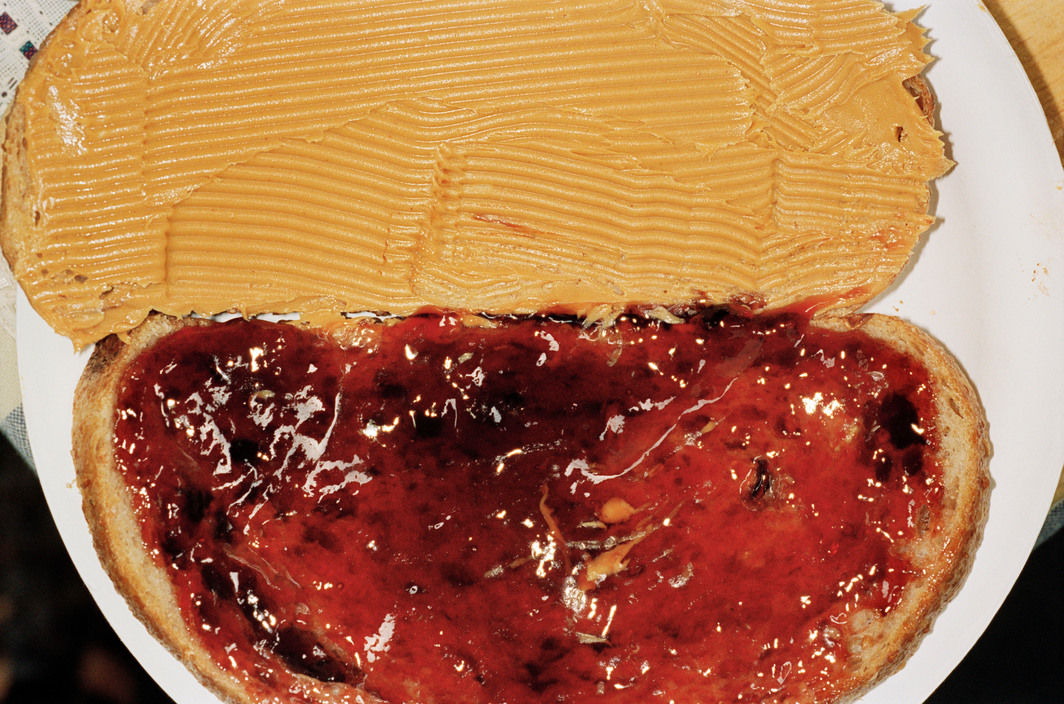

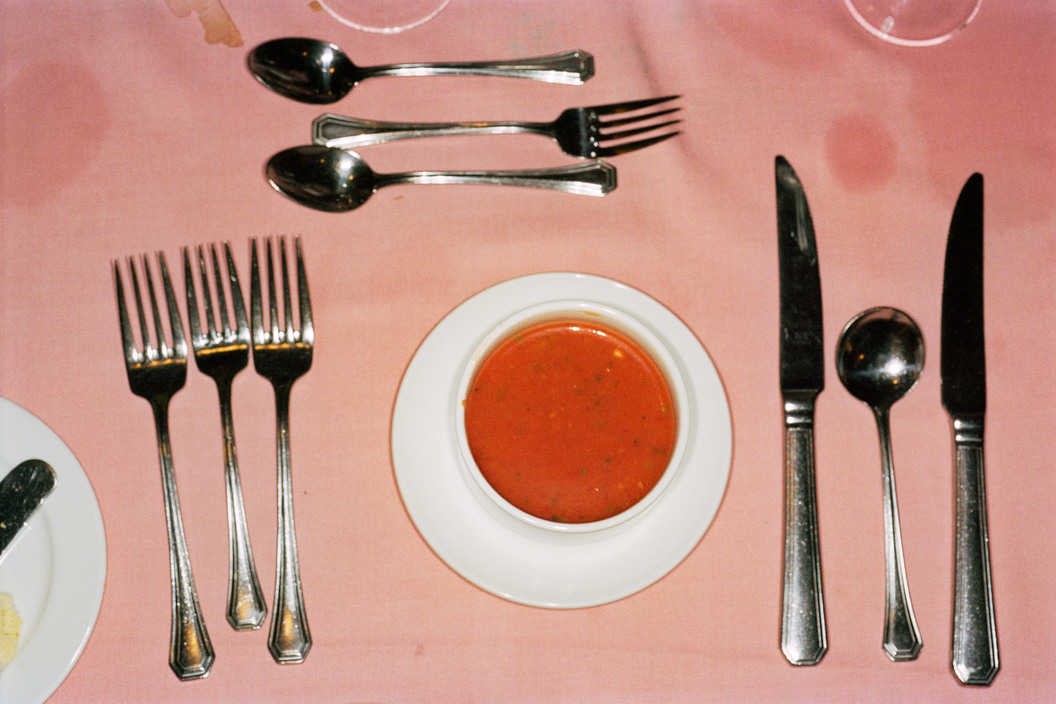






















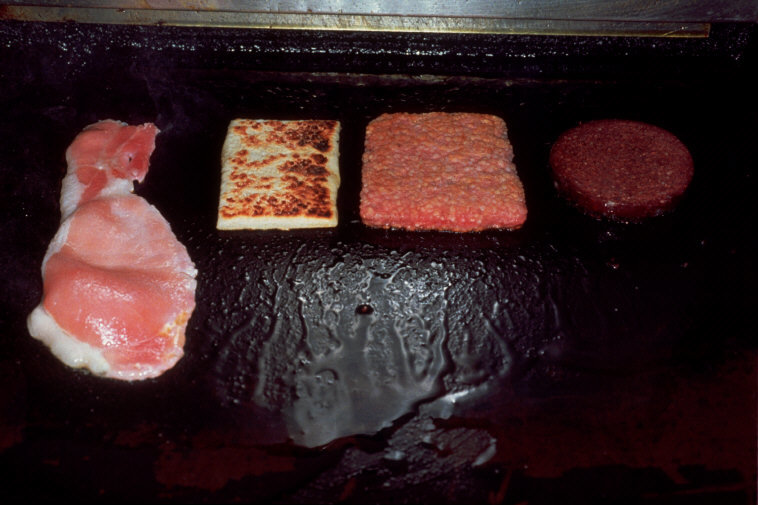

Papiers
« Je me suis intéressé au flou qui existe entre la réalité et la fiction, la nature et l’artifice, la beauté et la décadence. »
« I looked at the blurred lines between reality and fiction, nature and artifice, and beauty and decay. »
Gregory Crewdson





Né à Brooklyn en 1962, ce virtuose de la photographie réinvestit dans son travail, et non sans un certain brio, anecdotes névrotiques et récits oniriques des patients de son psychanalyste de père.
Non content de travailler le registre cinématographique, s’entourant d’équipes de cinéma, production et postproduction, son travail évoque vraisemblablement la peinture réaliste, d’Edward Hopper principalement, partageant avec le peintre un silence expressif, duquel émanent tensions, angoisses et mouvements de l’âmes, et au cinéaste David Lynch bien entendu – pour son imagerie quelque peu surréaliste et surtout onirique, où la narration est parfois difficilement lisible mais très esthétique.
Car si le conscient reconstitue – autant que faire se peut – l’image du rêve, ne lui restant à l’esprit qu’une ou deux images, accompagnée d’une atmosphère, du sentiment quelconque du rêveur au réveil , Crewdson ici reproduit chaque élément à la manière d’une scène de studio de cinéma, depuis l’image telle que l’artiste la conçoit jusqu’au tableau final, ayant nécessité une équipe digne des plus grands studios de cinéma.
Dans les compositions de l’artiste, tout est construit, voire reconstruit : les villes, ses rues, ses bois, les façades ou intérieurs des logements jusqu’à la lumière du ciel, chaque élément est recomposé depuis des souvenirs d’enfance de l’artiste, de ces récits tel qu’enfant il les entendaient furtivement à travers la porte du cabinet de son père, jusqu’aux seules images mentales qui ont pu résister au temps et qu’il choisit aujourd’hui de représenter. Décors, effets spéciaux, éclairages, se prêtent à cet exercice, documentant à travers une esthétique cinématographique la quiétude et l’inquiétude du monde du rêve.
La profusion de détails – faisant figure de preuves – et d’éléments informatifs, tranche littéralement avec la photographie à laquelle nos yeux sont accoutumés, à savoir des espaces épurés et lisse, des images saisies au vif et des personnages en mouvement là où chez Crewdson ces figures hiératiques invitent au décryptage et au songe éveillé. Ses photographies sont d’un autre genre. Elles sont l’irreprésenté par excellence, le fuyant, passant des vapeurs d’un sujet endormi à la fugacité de son éveil et de sa vision quittant peu à peu l’oeil de l’esprit appesanti pour renouer avec la concrétude de l’existence éveillée.
![]() Born in Brooklyn in 1962, this virtuoso of photography reinvests in his work, and not without a certain brio, neurotic anecdotes and dreamlike tales of the patients of his father psychoanalyst.
Born in Brooklyn in 1962, this virtuoso of photography reinvests in his work, and not without a certain brio, neurotic anecdotes and dreamlike tales of the patients of his father psychoanalyst.
Not content with working on the cinematographic register, surrounded by film, production and post-production teams, his work evokes presumably realistic painting, mainly by Edward Hopper, sharing with the painter an expressive silence, from which emanates tensions, anxieties and movements of the souls, and to the filmmaker David Lynch of course – for his somewhat surreal and above all dreamlike imagery, where narration is sometimes difficult to read but very aesthetic.
For if consciousness reconstructs the image of the dream with difficulty, remaining to mind only one or two images, accompanied by an atmosphere, any feeling of the dreamer upon awakening, Crewdson here reproduces absolutely every element in the manner of a scene from a film studio, from the image as the artist conceives it to the final table, requiring a team sign of the largest film studios.
In the artist’s compositions, everything is built and even reconstructed: the cities, its streets, its woods, the facades or interiors of the dwellings until the light of the sky, each element is reconstituted from childhood memories of the artist, from these narratives such as a child he could have heard furtively through the door of his father’s psychoanalysis cabinet, to the mental images that have been able to resist time and which he now chooses to represent. Decorations, special effects, lighting, lend themselves to this exercise, documenting through a cinematic aesthetic, the tranquility and anxiety of the dream world.
The profusion of details – evidence as evidence – and informative elements, literally contrasts with the photograph to which our eyes are accustomed, namely clean and smooth spaces, seized images and moving characters where on Crewdson’s works, these hieratic figures invite the deciphering and the awakened dream. His photographs are of a different kind. They are the irrepresented, fleeing from the vapors of a sleeping subject to the fugacity of his awakening and his vision gradually leaving the eye of the weighed mind to reconnect with the concreteness of an awaken existence.

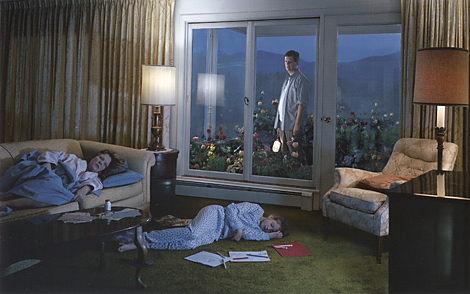








Généralement réalisées en studio, ces photographies ne sont donc en rien improvisées : les scènes sont travaillées comme de véritables compositions picturales, où chaque détail possède son sens, de manière intrinsèque mais aussi extrinsèque, au sens où le moment choisi, celui du rêve et de la situation chimérique représentée, éveille chez le regardeur un élan certain vers une volonté d’identification, une mémoire, une projection, depuis le travail de l’artiste jusqu’aux tréfonds de l’intime.
L’univers onirique de ces séries photographiques est le lieu de la narration certes, mais aussi et surtout d’un certain malaise propre au rêve et à son image, entre aurore, nuit et crépuscule, entre matinées ensommeillées d’angoisses, sommeil profond et éveil délicat. Il n’est qu’à prêter attention aux visages des figurants, tour à tour fantomatiques, absents, hagards, pour sentir le malaise envahir n’importe quel regardeur. Malaise qui rend avide de déchiffrer l’enjeu, tantôt pour se libérer d’un conflit latent, tantôt pour saisir l’essence de la composition.
Une composition donc et non une complète narration, un instant figé sur la surface photosensible de l’appareil, faisant miroir à ces autres images fugaces figées dans l’oeil d’une mémoire qui semble plus trahir l’éveillé que le renseigner. Images qui parviennent donc furtivement à la conscience une fois sortie de la torpeur de ce long sommeil, et desquelles il s’agit de se délivrer, de donner sens ou d’oublier, prenant alors le risque que les scènes réapparaissent la nuit venant. Des images où les détails fusent mais interrogent davantage qu’ils n’informent. Laissant alors au regardeur ou au rêveur, le soin de ressasser jusqu’au sens occulté par l’éveil.
« Comme une histoire figée à jamais entre l’avant et l’après, demeurée toujours irrésolue. » Gregory Crewdson
Crewdson donne à voir, et d’une fabuleuse manière, une Amérique de la middle classe, en proie aux rêves les plus fantaisistes et non moins lugubres, où le bleu du ciel noircit par la nuit fait référence à cet ailleurs que constitue le sommeil. Où ces nuits inquiétantes, ces rêves difficilement descriptibles de rêveurs anonymes, que l’oreille de son père avait déjà probablement du chercher à détailler. Ces récits de patients, dont les rêves traquaient alors l’essence de la névrose, dans ces détails insignifiants mais non moins virulants dont le photographe s’empare dans ces compositions.
Cet ésotérisme de l’image, dans la lignée de Jeff Wall, aux mises en scènes au moins aussi minutieuses, exigeantes et précautionneuses, témoignent d’une intensité bien spécifique au monde du rêve, de la névrose, accentuée par un certain mystère émanant de ces constructions bien particulières que sont les photographies de Gregory Crewdson.
© Photographies Gregory Crewdson
![]() Generally, these photographs are in no way improvised: the scenes are worked as real pictorial compositions, in which every detail has its meaning, intrinsically but also extrinsically, in the sense that the chosen moment, that of the dream and the chimerical situation represented, arouses in the viewer a certain impulse towards a desire for identification, a memory, a projection, from the work of the artist to the depths of the intimate.
Generally, these photographs are in no way improvised: the scenes are worked as real pictorial compositions, in which every detail has its meaning, intrinsically but also extrinsically, in the sense that the chosen moment, that of the dream and the chimerical situation represented, arouses in the viewer a certain impulse towards a desire for identification, a memory, a projection, from the work of the artist to the depths of the intimate.
The oneiric universe of these photographic series is the place of narration, but also and above all, a certain uneasiness peculiar to the dream and its image, between dawn, night and twilight, between sleepy moments of sleep, deep sleep and delicate awakening. It is only to pay attention to the faces of the extras, alternately ghostly, absent, haggard, to feel the discomfort invade any looker. This discomfort makes us eager to decipher the stakes, sometimes to free ourselves from a latent conflict, sometimes to grasp the essence of the composition.
A composition, therefore, not a complete narrative, a moment fixed on the photosensitive surface of the camera, mirroring those other fleeting images frozen in the eye of a memory that seems to betray the awakened rather than to inform it. Images that reach the consciousness once they are out of the torpor of this long sleep, and from which it’s a question of freeing ourselves, of giving meaning or of forgetting, taking then the risk that the scenes reappears at night coming. Images where details spark but interrogate more than they inform. Leaving then to the viewer or to the dreamer, the care of reasserting until the hidden sense, by the awakening.
« Like a story that is forever frozen in between moments, before and after, and always left a kind of unresolved question. »
Gregory Crewdson
Crewdson shows, in a fabulous way, an America of the middle class, a prey to the most fanciful and no less lugubrious dreams, where the blue sky blackens by night refers to that elsewhere that constitutes sleep. Where these disturbing nights, these dreams, hardly descriptive of anonymous dreamers, which the ear of his father had probably already had to seek to detail. These narratives of patients, whose dreams were then tracing the essence of neurosis, in these insignificant but no less virulent details of which the photographer seizes in these compositions.
This esoteric image, in the line of Jeff Wall, with at least as meticulous, exacting and precautionary staging, testifies to intensity very specific to the world of dreams and neurosis, accentuated by a certain mystery emanating from these particular constructions, which are the photographs of Gregory Crewdson.
© Photographs Gregory Crewdson










Papiers




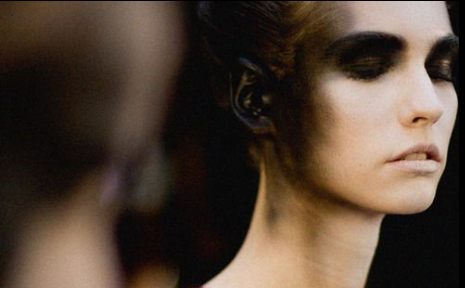












Après avoir travaillé chez Givenchy, Jean-Paul Gaultier ou encore Torrente, Julien Fournié pour ce troisième défilé impose sa présence parmi les grandes maisons de couture parisiennes. Le jeune Fournié se plait à défendre une couture que l’on se prend à porter aisément. En octobre dernier, il dévoilait déjà des silhouettes frêles et graciles. Fidèle à ses « femmes fragiles et vulnérables » il offre un travail considérable pour une jeune maison qui vient à peine d’éclore.
Son identité s’affirme notamment par la reprise de codes qui étaient déjà présents lors des deux premières présentations, s’intéressant aux textures, à la chromatique, à la plasticité de certaines pièces ou encore à façon dont les silhouettes se meuvent une fois parées de ces vêtements. Vêtements qui justement prennent l’apparat d’une seconde peau, épousant les courbes du corps sans l’obstruer, mais au contraire en le renforçant ici et là, jusqu’à remplacer certains éléments anatomiques : en effet, une des robes a cela de particulier que le mamelon y est sculpté à même le vêtement, dessinant le sein à même le vêtement, dévoilant l’intimité.
La collection composée de raphia, plumes, mousseline, satin, organza, fourrure – pour les plus patents – servent des volumes veloutés de légèreté. Les jupes sont asymétriques, les pantalons ont la fluidité des sarouels, réinterprétés ici, les fourreaux sont près du corps. On retrouve la finesse et la délicatesse du textile. Les organzas chair de l’hiver précédent se sont cendrés de tonalités diverses. On retrouve des constantes de matières du premier show de 2009 à ce troisième défilé : les tissus sont fluides et délicats, la soie et le cuir s’entrelacent, ce dernier allant jusqu’à adopter la délicatesse de la soie.
Des variantes : des éléments de modernité font leur apparition tels le zip – à la Val Piriou – et l’incontournable des années 1980 à savoir le bomber, très féminisé pour l’occasion – épaules rondes, finesse des tissus accompagnants nonchalamment les courbes du corps. On découvre des pièces plus coutures également aux tracés impeccables, comme créées à partir d’un moule, constituant ainsi une ravissante déclinaison et une parfaite cohérence stylistique de la collection.
Quant à la mise en scène qu’il n’osait qu’à peine mettre en avant auparavant, elle est désormais assumée. Les corps expriment quelque chose de l’atmosphère Fournié, les bras sont tournés vers l’extérieur mais dans une position de complainte et de rigidité propre à la mélancolie. Les mannequins ne défilent pas, elles glissent lentement sur le sol, se laissant envahir par une certaine lenteur propre à la neurasthénie. Posture, démarche, maquillage, tout concoure à l’expression saturnienne de cette collection, de cette Maison, qui conserve une cohérence d’esprit autant que de style, de présentation en présentation.
Là où un timide pansement ornait le visage de certaines filles au défilé précédent, exaltant la fragilité du corps féminin, tout comme ses imperfections et sa vulnérabilité – bien que le choix des modèles alors ne semblant pas suivre cette cohérence d’une atmosphère inquiétante, le choix ayant été très classique – ici, ce sont des accents volontairement tragiques qui font figure : parmi ces accents le maquillage a importé considérablement : visage de noir et de blanc, halo de tristesse rappelant ce personnage de la mythologie européenne, Pierrot la Lune, innocent, pâle et mélancolique. La dramaturgie propre à chacun de ces éléments apparait particulièrement cohérente, bien maîtrisée, réussie même.
Là est la démonstration de ces interrogations récurrentes selon lesquelles il s’agirait de savoir si le vêtement ne suffit plus, ou non. A cela on peut avancer que le défilé n’est jamais une simple présentation de pièces, mais plutôt la représentation d’un esprit, d’un univers propre à une Maison, la distinguant en tâchant de laisser une empreinte pérenne dans l’esprit du contemplatif. Ce questionnement demeure crucial au XXIème siècle, il est à analyser fermement, et strictement ; le discours du couturier ou designer, selon le terme que ces derniers s’octroient, est souvent cardinal ; car l’idée qui émane de leurs choix discursif est plus forte que le descriptif simplement visuel, de ces halos et paumes de mains cendrées et tournées vers le ciel, à la manière d’une madone, ou de ces décors, aménagements de lieux, ou attitudes représentatives.
Galliano en a fait tout un art, de ces extravagances, corollaires de chaque collection. Sa théâtralité, parfois décriée – rappelons que Saint Laurent s’ulcérait de voir autant de déguisement travestir la couture – a conquis le public de cette fin XXème, rendant les rédactrices hystériques à l’idée de ne pas y faire acte de présence, et les publics envoûtés par tant de prodigalité dans la fantaisie. Suggérer un imaginaire, le pousser jusqu’à son paroxysme… Fournié s’inscrit dans la droite ligne des plus grands, et de ce qui se fait actuellement. Sa collection trouve ses sources au cœur du martyre et de la souffrance. Est-ce au vêtement d’exhorter le mal de sortir de la chair ? Pourquoi pas. La mode a toujours eu une place ambivalence dans la création, qualifiée tour à tour d’artisanat, d’art à proprement parler, d’art appliqués… On ne saurait trop dogmatiser, davantage encore dans une époque prônant la transversalité. Pour l’heure, le travail de Julien Fournié apparait très intéressant, encore un peu timide, et très jeune. Mais prometteur.
Julien Fournié Premiers Modèles Hiver 2009 from Julien Fournié on Vimeo.
![]() Paris. Haute couture. Fall-winter 2010/2011 « The bitter standard. « Julien Fournié.
Paris. Haute couture. Fall-winter 2010/2011 « The bitter standard. « Julien Fournié.
After working at Givenchy, Jean-Paul Gaultier or Torrente, Julien Fournié for his third show imposes his presence among the major fashion houses in Paris. The young Fournier is pleased to defend couture which is easy to carry. Last October, it already revealed silhouettes frails and gracefuls. Faithful to these « fragile and vulnerable women », he offers a considerable amount of work for a young house that has just emerged.
His identity is affirmed by the repetition of codes that were already present in the first two shows, interested in textures, chromaticity, plasticity of some pieces or even in ways in which silhouettes move once adorned with these clothes. Clothes that take the appearance of a second skin, adhering to the curves of the body without obstructing it, but rather reinforcing it here and there, replacing some anatomical elements: indeed, one of the dresses has this particularity that the nipple is sculpted in clothe, drawing the breast, revealing the intimacy.
The collection composed of raffia, feathers, chiffon, satin, organza, fur – for the most patents – serve velvety volumes of lightness. Skirts are asymmetrical, pants have the fluidity of sarouels, reinterpreted here, scabbards are skinny. We find the delicacy of the textile. Organzas, in flesh color, of the previous winter have been cindered with various tones. There are material constants of the first show of 2009 at this third show: fabrics are fluid and delicate, silk and leather intertwine, leather goes so far, adopting the delicacy of silk.
Variations: elements of modernity are emerging such as the zip – from Val Piriou – and the must-have of the 1980s, namely the bomber, very feminized for the occasion – with round shoulders, delicate fabrics accompanying nonchalantly curves of the body. We discover more seamed pieces also with impeccable tracks, as created from a mold, thus constituting a delightful declination and a perfect stylistic coherence of the collection.
As for the staging he hardly dared to put forth before, it’s now assumed. Bodies express something of the Fournié atmosphere, arms are turned outwards but in a position of lament and rigidity peculiar to melancholy. Models don’t parade, they slide slowly on the ground, allowing themselves to be invaded by some slowness proper to neurasthenia. Posture, gait, make-up, all contribute to the Saturnian expression of this collection, this House, which retains a coherence of mind as much as style, presentation to presentation.
Where a timid dressing adorned faces of some girls at the previous show, exalting fragility of female body, as well as its imperfections and vulnerability – although the choice of models then did not seem to follow this coherence in a disturbing atmosphere, a choice that has been very classical – here are deliberately tragic accents. Among these accents make-up has imported considerably: face of black and white, a halo of sadness recalling this character of European mythology, Pierrot la Lune, innocent, pale and melancholic. Dramaturgy proper to each of these elements appears particularly coherent, well controlled, even successful.
This is the demonstration of recurring questions that is a matter of knowing whether the garment is no longer sufficient or not. It may be argued that the show is never a simple presentation of clothes, but rather the representation of a spirit, a universe proper to a house, distinguishing it by striving to leave a lasting imprint in the spirit of contemplative. This questioning remains crucial in the 21st century, it must be analyzed firmly, and strictly. Words of the couturier (or designer, according to the term which the latter assumes), is often cardinal, since the idea that emanates from their discursive choices is stronger than the descriptive simply visual, of these halos and palms of hands ash and turned towards the sky, like a Madonna, or these decorations, or attitudes.
Galliano has made it an art, of these extravagances, in each of his collections. His theatricality, sometimes decried – remember that Saint Laurent was ecstatic to see so much disguise disguising couture – conquered the public of this late twentieth century, making hysterical fashion editors to the idea of not making an act of presence, and the audience bewitched by so much prodigality in fantasy. Suggesting an imaginary, pushing it to its climax … Fournié is in line with the biggest, and of what is being done. His collection finds inspiration in the heart of martyrdom and suffering. Is it to the garment to exhort evil to come out of the flesh? Why not. Fashion has always had an ambivalent place in creativity, described in turn as crafts, fine arts, design … We can’t too dogmatize, even more in an era advocating transversality. For the moment, the work of Julien Fournié appears very interesting, still a little shy, and very young. But promising.
Galerie




Fidèle à l’esprit du couturier défunt, pour ce printemps/ été 2016 Sarah Burton s’est attaché à cette histoire commune entre la France et l’Angleterre, celle de ces immigrés Huguenots (1) fuyant à la hâte l’hexagone suite à la révocation de l’Edit de Nantes (2), et s’installant alors dans le Londres du XVIIe siècle. Cette collection à l’empreinte historicisante apparait très éthérée ; les silhouettes sont graciles, les tons poudrés et les robes à la coupe fin d’ère victorienne ne font pas impasse sur de légers volants de dentelle et de tulle.
Le maquillage, les accessoires se font également très discrets : le luxe est dans la légèreté et s’oppose clairement au style Empire en vogue alors en France. Pourquoi fin d’ère victiorienne ? La fin de style victorien se caractérise par des bustiers plus longs, des traines qui disparaissent et des jupes plus étroites. Les cols sont droits, montants, et ressemblent de plus en plus à de véritables vestes, annonçant alors la mode Belle Époque alors émergeante. Un entre deux, une passation.
Suivent des silhouettes moins virginales et plus fermement masculines : jeans et redingotes, les premiers ornés des fleurs qui parsemaient les jardins certes modestes mais dont les allées végétales étaient très appréciées. « Leurs jardins étaient de véritables joyaux dans ce qui était alors un Londres très pauvre. On les qualifiait de “Ligne de beauté”, car tout y était fait en forme de S », explique Sarah Burton (backstage).
Ces silhouettes donc, toujours aussi romantiques – mais d’un romantisme plus revendicatif, faisant irrémédiablement penser à la période révolutionnaire qui se construit alors en France, dévoilent ainsi des torses nus aux seins presque invisibles et aux chaines épaisses – comme une image de ces chaînes qu’il faudra bientôt briser, des redingotes militaires rouge sang, nombres de pantalons – dont les poches sont pleines de graines & de bulbes, s’apprêtant à ensemencer les jardins de l’East End – mais aussi de cuir léger comme de la soie mais pas pour autant moins solide. « Je voulais que ce soit tangible et convaincant, féminin, mais aussi fragile et solide tout à la fois », SB backstage. (3)
Peut-être là une analogie entre la femme protestante, ayant à repartir de zéro et tout reconstruire, dans une douleur toute romantique et nostalgique à la fois, un regard quelque peu dans le passé, un arrachement soudain et douloureux à une terre natale, entre la France et l’Angleterre. Un syncrétisme dans la tenue qui révèle des influences doubles. Et Burton, se voyant confier les rênes d’une maison dont le souvenir de son créateur est encore frais ; de ces années de succès avec Alexander Mcqueen, de ses propres débuts à la toute fin de ses études, auprès de son fondateur.
(1) Les Huguenots étaient les protestants du royaume de France et de Navarre, longtemps persécutés par les catholiques au cours du XVIe siècle qui auront donc été forcés de fuir. Pour aller plus loin : Hugues Daussy, Le parti huguenot : chronique d’une désillusion (1557-1572), Genève, Librairie Droz, coll. « Titre courant » (no 41), 2015
(2) On mentionne toujours la dite Révocation de l’Édit de Nantes mais il s’agit de l’édit de Fontainebleau du 18 octobre 1685 signé par Louis XIV (qui révoque l’édit de Nantes). Pour aller plus loin : Didier Boisson, Hugues Daussy, Les protestants dans la France moderne, Paris, Belin, 2006
(3) https://madame.lefigaro.fr/defiles/alexander-mcqueen/printemps-ete-2016/pret-a-porter-0/98730
![]() Faithful to the spirit of the late fashion designer, for this spring summer 2016 Sarah Burton focused on the common history between France and England. Indeed, Huguenot (1) immigrants hastily fled the hexagon after the revocation of the Edict of Nantes (1), and then settled in the XVIIth century’s London. This collection with historicizing footprint appears to be very ethereal; silhouettes are slenders, powdered colors and dresses in the late Victorian era do not skip flying light lace and tulle.
Faithful to the spirit of the late fashion designer, for this spring summer 2016 Sarah Burton focused on the common history between France and England. Indeed, Huguenot (1) immigrants hastily fled the hexagon after the revocation of the Edict of Nantes (1), and then settled in the XVIIth century’s London. This collection with historicizing footprint appears to be very ethereal; silhouettes are slenders, powdered colors and dresses in the late Victorian era do not skip flying light lace and tulle.
Makeup, accessories are also very discreet: luxury is in lightness and is clearly opposed to the Empire style then in vogue in France. Why late Victorian era ? Late Victorian style was characterized by longer bustiers, disappearing trains, and narrower skirts. The collars are straight, high, and look more and more like real jackets, announcing the then emerging Belle Époque fashion. One between two, a handover.
Follow less virginal and more firmly masculine silhouettes: jeans and coats, the former – jeans – are decorated with flowers that few centuries ago, had embellished the admittedly small gardens. In this garden vegetable aisles were much appreciated. « Their gardens were real gems in what was a very poor London. They are described as « Beauty Line » because everything was made S-shaped « says Sarah Burton (backstage).
These figures therefore, always so romantic – but a more assertive romantic, hopelessly reminiscent of the revolutionary period that is built then in France, and reveals naked torsos with no almost invisible breasts and thick chains – such as a picture of these chains which are going to be broken soon, military coats with blood red, lots of trousers – whose pockets are full of seeds & bulbs, preparing to sow East End gardens – but also light leather like silk but not any less strong. « I wanted it to be real and convincing, feminine, but also fragile and strong at the same time, » according to SB backstage. (3)
Perhaps there is an analogy between the Protestant woman, having to start from scratch and rebuild everything, in a pain that is romantic and nostalgic at the same time, a look somewhat into the past, a sudden and painful tearing away from a native land, between France and England. A syncretism in the outfit which reveals dual influences. And Burton, being entrusted with the reins of a house whose memory of its creator is still fresh; of these years of success with Alexander Mcqueen, from his own beginnings to the very end of his studies, with its founder.
(1) The Huguenots were the Protestants of the kingdom of France and Navarre, long persecuted by the Catholics during the 16th century who were therefore forced to flee. To go further: Hugues Daussy, The Huguenot party: chronicle of disillusionment (1557-1572), Geneva, Librairie Droz, coll. “Running title” (no. 41), 2015
(2) We always mention the so-called Revocation of the Edict of Nantes but it is the Edict of Fontainebleau of October 18, 1685 signed by Louis XIV (which revokes the Edict of Nantes). To go further: Didier Boisson, Hugues Daussy, Protestants in modern France, Paris, Belin, 2006
(3) https://madame.lefigaro.fr/defiles/alexander-mcqueen/printemps-ete-2016/pret-a-porter-0/98730